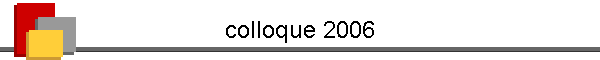
Nouveau site : http://www.educationetdevenir.fr/
 | |
| Qui sont les élèves aujourd’hui ? | |
| Croiser les regards en vue de la réussite scolaire | |
| 31 mars, 1 er et 2 avril 2006. | Rouen |
|
En partenariat avec l'ESEN
|
|
|
| Rappel : pour agrandir une photo, cliquer dessus ; pour enregistrer une photo : clic droit et "enregistrer sous..." | |||||
 |  |  |  |  |  |
| CRDP de Mont-Saint-Aignan | GR.ETA.. | ||||
| Quelques uns des (gentils) organisateurs |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Jean-Paul BROONEN |  |  |  |  |
 | Réception à l'hôtel de ville |  |  |  |  |
| Table Ronde | |||||
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Roger ESTABLET | |||||
 |  |  |  |  |  |
| Jean-Luc FAUGUET | Un petit mot d'Y. Robert |  |  |  | |
 |  |  |  |  |
| Pauses | |||||
 |  |  |  |  |  |
| Alain MICHEL |  |  |  |  |  |
| Conclusion et fin |  |  |  |  |  |
| Une trentaine de ces photos sont dues à Gérard Duchemin, Directeur du CRDP de Rouen |
| En attendant les Actes du colloque quelques documents consultables sur des sites et/ou téléchargeables | |||||||||
Anne BARRERE |
LE BOSSEUR, LE FUMISTE, LES TOURISTES ET LE FORÇAT Formes du travail lycéen et pratiques d'évaluation Anne Barrère Professeur en sciences de l’éducation, Lille III
XYZep revue du centre Alain Savary
| ||||||||
Roger ESTABLET |
Le niveau monte Roger Establet
Le rendement académique au baccalauréat C. Baudelot et R. Establet
Conférence de Roger Establet jeudi 13 octobre 2005 (Notes) : L’école capitaliste en France, 1971. Radiographie du peuple lycéen (2005)
Radiographie du peuple lycéen Roger Establet (coord), Jean-Luc Fauguet, Georges Felouzis, Sylviane Feuilladieu, Pierre Verges Paris, ESF, 2005. Accès aux données du questionnaire Meirieu : accès aux données
| ||||||||
Jean-Luc FAUGUET |
| ||||||||
|
Nous avons encore en tête un modèle de l'école selon lequel, pour des enfants enfermés dans leurs particularismes, l'école est le lieu d'entrée dans l'universel, dans le domaine de la raison. Le maître se trouve dans un rôle de médiateur entre des êtres définis par leurs particularismes et l'universalité des principes. Il n'entre pas dans le secret des différences individuelles, sociales, culturelles,
Mais dans un monde où les structures primaires se délitent et où la population est imprégnée d'une culture de masse, l'école ne peut plus revendiquer d'être le seul passeur du monde privé au monde public.
La démocratisation quantitative du système scolaire n’a pas remis en cause l'uniformisation progressive des structures scolaires, de la formation et de l'origine des personnels et a promu une image de l'élève idéal. Le traitement uniforme d'élèves divers revient à lourdement pénaliser les plus défavorisés. Un enseignement uniforme n'est pas démocratique.
En dépit d'un apparent consensus sur les objectifs les plus généraux, la nécessaire diversification s'est heurtée à de nombreux obstacles qui ont empêché l'accueil et l'identification non discriminants de la diversité des publics. Nous ne manquons pas de diagnostics, établis par les experts les plus habiles, mais aucun de ces diagnostics n'aura été véritablement travaillé pour dégager des plans d'action locaux adaptés.
Une diversification effective en vue d'une démocratisation qualitative de l'école suppose de changer de visée. Il ne s'agit sans doute pas de renoncer au rationalisme mais d'abandonner peut-être la lunette cartésienne qui modélise le "sujet du savoir" et de s'engager dans une approche plus systémique de la complexité du sujet en devenir. Un sujet multiple, équivoque, "plurivoque". L'universalité ne réside plus dans le formatage d'une ressemblance mais dans la capacité, en dépit des différences reconnues, à construire ensemble une formation commune et une vie possible. Il faut d'abord apprendre à regarder, à connaître pour instruire. Il faut croiser les regards.
Mais aussi :
Intégrer tous les enfants demande de savoir établir les distinctions utiles. Ne faut-il pas, en diversifiant les modes d'intervention et les intervenants, renforcer la continuité entre la scolarisation et l’expérience adulte, préparer les jeunes à entrer dans des modes de formation non scolaires, et à valider les acquis de leur expérience ?
Mieux connaître les élèves pour les entraîner vers la réussite, accueillir la diversité, les particularismes et les conduire ensemble vers une communauté, produire de l'universel, ne correspond peut-être plus à la définition traditionnelle de la laïcité. S'agit-il de revendiquer une laïcité a priori ou de travailler à une laïcité en construction ?
|
|
|
En
partenariat avec L’E.S.E.N. |
|||
| |||
Le colloque a pour objectif de croiser les regards des acteurs autour de l’élève, mais aussi de croiser les résultats de la recherche et les témoignages issus de « terrain ».
La première demi-journée, vendredi après-midi, est consacrée, après les discours d’accueil, à une approche universitaire :
Ä Anne Barrère, professeur de sociologie à l’université de Lille, présentera qui sont nos élèves aujourd’hui,
Ä Jean-Paul Broonen, professeur à l’université de Liège, insistera sur les mécanismes de la motivation.
Le samedi matin est consacré au témoignage d’acteurs (médecin psychiatre, chargé d’action culturelle, parent d’élève, CPE, professeur, proviseur, élève, représentant d’entreprise) rassemblés autour d’une table ronde animée par Claude Rebaud, proviseur du lycée d’Andrézieux – Bouthéon, ancien président d’E&D.
Ä Roger Establet, sociologue et auteur bien connu, fera à la lumière de sa réflexion une synthèse commentée des propositions de la table ronde.
Le samedi après-midi est réservé au travail en ateliers, où chaque participant au colloque pourra s’exprimer. L’atelier organisera ses débats autour de la brève intervention d’une personne ressource et les résumera sous forme d’une question et/ou d’une proposition.
La journée se termine par un programme de visites (au choix) à Rouen et une soirée festive animée par un orchestre de jazz autour de spécialités normandes.
Le dimanche matin Jean-Luc Fauguet, co-auteur avec Roger Establet de « Radiographie du peuple lycéen », fera ses propres propositions à partir des conclusions des ateliers du samedi.
Le colloque se terminera par une conférence d’Alain Michel, président de l’Institut européen d’Education et de Politique sociale, qui se demandera comment intégrer dans une laïcité qui se veut unificatrice les approches différenciées que le colloque aura permis de dégager.
| |||
|
Vendredi 31 Mars CRDP de Mont Saint Aignan |
|||||||||
|
À partir de 14h accueil des participants
19h Réception à la mairie de Rouen
20h Repas au Collège Barbey d’Aurévilly à ROUEN
21h Assemblée Générale au Collège Barbey d’Aurévilly à ROUEN |
|||||||||
|
Samedi 1 avril CRDP de Mont Saint Aignan |
|||||||
12h30 Repas au Collège Jean de la Varende à Mont St Aignan
Salles du GRETA Rouen Tertiaire (face au CRDP)
17h30 Visites
19h 30 Soirée festive au Lycée Camille St Saëns de Rouen (face au Palais de Justice) |
|||||||
|
Dimanche 2 avril CRDP de Mont Saint Aignan |
|||||
12h Repas |
|||||
| ATELIERS |
| Atelier 1 (Lille) – Comment regarder les élèves ? | |
|
Les regards des acteurs autour de l'élève sont déformés, saturés d'attentes et de représentations. L'élève n'est apprécié qu'à l'aune d'un ensemble de performance dans un champ de référence convenu et limité. Il n'y a pas de place pour l'inattendu. Les occasions institutionnelles de percevoir l'élève à partir d'une plus grande pluralité de points de vue, quand elles existent, sont souvent très fructueuses mais restent largement insuffisantes et insatisfaisantes. Comment organiser nos pratiques pour modifier cette vision monoculaire et innover ? |
|
|
Atelier 2 A (Lyon) - Du singulier à l'universel |
|
|
Les élèves à "besoins pédagogiques particuliers" représentent une chance pour les autres et peut-être pour le système lui-même. En détectant les potentialités de chacun, en activant des dispositifs, en créant de nouvelles procédures de valorisation, est-il possible de stimuler l'émergence des talents sous des formes nouvelles ? Les élèves nous regardent dans tous les sens du terme. Cette réciprocité est-elle exploitée ou au contraire s'en défie-t-on ? Comment appréhender le regard de l'élève et en faire un élément de la construction des apprentissages ? |
|
| Atelier 2 B (Lyon) - Les élèves nous regardent aussi | |
|
Les élèves nous regardent dans tous les sens du terme. Cette réciprocité est-elle exploitée ou au contraire s'en défie-t-on ? Comment appréhender le regard de l'élève et en faire un élément de la construction des apprentissages ? |
|
|
Atelier 3 (Aix-marseille & Nice) – Risques et dérives |
|
|
La classe n'est pas un divan. Le regard psychologique ne constitue-t-il pas dans l'espace "laïque" une intrusion intolérable dans la sphère intime de l'apprenant ? L'appel aux experts pour instaurer une grille de lecture à multiples entrées sur l'individu ou le groupe ne comporte-t-il pas à l'opposé une dérive techniciste et même une sorte de panoptisme quasi totalitaire ? Passer les élèves au crible de l'ensemble de ses déterminations (psychologiques, sociologiques, économiques, historiques, scolaires, etc…), cela ne pourrait-il pas entraîner des formes de catégorisation a priori ? Des phénomènes d'attentes encore plus pervers ? Des mots clefs : intrusion, toile d'araignée, interprétation, analyse, modélisation, systématisation, inefficacité, consumérisme, contrainte, divergence, uniformisation, homogénéisation. |
|
|
Atelier 4 (Grenoble) – Une pratique à faire évoluer. Le conseil de classe vu par les différents acteurs et partenaires de l'Ecole. (Avec la participation d'un sociologue) Les objectifs de l'atelier : Un état des lieux, des propositions concrètes. |
|
|
Comment rendre les conseils de classe plus efficaces comme instance d'évaluation. Evaluer quoi ? Comment ? Dans quel but ? Quels dispositifs nouveaux imaginer pour les conseils ? Un autre regard, d'autres modalités : quels changements, en amont, dans les pratiques des enseignants ? |
|
|
Atelier 5 (Amiens – bordeaux – Dijon) – Croiser les regards dans de nouveaux dispositifs pédagogiques. |
|
|
Il existe déjà de nombreuses expériences qui montrent qui montrent l'intérêt et l'efficacité du croisement des regards dans les pratiques pédagogiques (TPE, PPCP, Projets culturels, ateliers de pratiques, sorties, IDD…) Ces pratiques permettent à l'élève de sortir du cadre, de se découvrir lui-même, de rencontrer des situations inattendues de réussite. Elles permettent aux enseignants d'accueillir la nouveauté, de faire varier le calibrage de leurs mesures par la variété des contextes d'apprentissage. Comment avancer dans cette voie ? Quelle part pour la direction des établissements pour valoriser et promouvoir ces pratiques, pour donner aux acteurs plus d'autonomie et favoriser les innovations ? |
|
|
Lors des Journées des militants (dites Journées d'Automne), Françoise Lorcerie, chercheuse du CNRS, est venue, le 30 septembre 2005, présenter les résultats d'une enquête sur "les identités sociales des lycéens marseillais". Elle a eu l'extrême amabilité de nous autoriser à mettre en ligne le résumé de cette enquête scientifique. Dans sa présentation, elle a souligné la spécificité de Marseille : il n'est donc pas possible d'extrapoler les conclusions de ce travail. Il se pourrait, cependant, qu'il bouscule quelques idées toutes faites. |
|
| Voir aussi, plus bas, une contribution de Jean-Paul Delahaye
|
|
|
Cités cosmopolites. Sur les identités sociales des lycéens marseillais Rapport d’enquête réalisé avec le soutien du FASILD* – (janvier 2005, 309 p.) par Françoise Lorcerie** CNRS – IREMAM, Aix-en-Provence |
|
|
RESUME
|
L’étude explore la variabilité des identités sociales des lycéen(ne)s, l’invariant étant constitué par le fait d’être scolarisé en lycée à Marseille. Pour cerner la variation identitaire dans notre population, nous avons recueilli de l’information à la fois sur les appartenances assignées à nos enquêtés et sur celles qu’ils endossent ; et nous avons cherché à cerner les attitudes associées à ces appartenances, sur des questions sollicitant la catégorisation sociale des identités collectives, comme l’islam, l’intégration, le racisme, l’immigration, la citoyenneté, etc. Nous nous intéressons spécialement aux dimensions politiques des identités sociales des lycéen(ne)s, dans leurs associations aux dimensions non politiques de ces identités.
Protocole Les catégories retenues comme susceptibles d’induire des différences identitaires sont les grandes variables de la sociologie classique : - le genre, la classe sociale des parents, l’âge, - ainsi que : l’origine ethnique et nationale (déclarée) des parents, la religion (déclarée), - la carrière scolaire, la situation du lycée fréquenté dans la segmentation particulière de la ville de Marseille (quartiers nord vs quartiers sud) (sur ce facteur, Centi, 1996). L’enquête tente de saisir l’effet relatif de ces variables dans divers champs sélectionnés pour leur pertinence a priori pour une approche de la citoyenneté et des appartenances : - l’auto-identification, - le rapport au politique, - le rapport au fait migratoire et au racisme, - l’expérience scolaire et la vie hors du lycée. Des questions ouvertes répandues dans le questionnaire permettent d’accéder sur certains points, comme : - la position à l’égard de l’islam, - la signification conférée à la citoyenneté, - l’attitude à l’égard des sanctions, à une information plus complexe. Sept lycées publics (trois lycées professionnels, quatre lycées généraux et technologiques) ont été sélectionnés en veillant à diversifier les situations scolaires : lycée « de prestige », « bon » lycée, « nouveau lycée » (Dubet, 1991), plus un LGT qu’on peut qualifier de lycée « d’immigrés » en raison de la proportion exceptionnelle d’enfants d’immigrés qu’il accueille ; lycées professionnels tertiaires ou industriels. Le questionnaire a été administré dans les salles de classe par divisions entières en dehors de la présence des enseignants. 1129 questionnaires ont été recueillis. Bien que les filles soient plus nombreuses que les garçons dans la population d’enquête, la représentativité (estimée à partir des données INSEE et Rectorat) paraît assez satisfaisante. 49% de nos enquêté(e)s vivent dans des familles de statut socio-économique défavorisé et quelque 70% sont de condition modeste. Par ailleurs, 50 % environ ont un lien familial avec l’Afrique (Maghreb, Afrique subsaharienne, Océan Indien), sans compter les enfants de rapatriés, qui forment environ 12% du total. Les questionnaires ont été exploités à l’aide du logiciel Modalisa, en mobilisant notamment trois outils que propose ce logiciel : l’indice PEM, pourcentage de l’écart maximum (local ou global, développé par Philippe Cibois), qui permet d’estimer la force de l’attraction entre deux modalités dans un tableau de tri croisé, en étant peu sensible aux variations des effectifs ; le ‘profil de modalité’, qui recense les écarts à l’indépendance significatifs entre les modalités d’une variable de référence et les modalités des autres variables sélectionnées, au besoin l’ensemble des variables du questionnaire, permettant de dessiner les faisceaux d’attractions entre modalités qui spécifient respectivement les sous-populations distinguées ; enfin la carte factorielle des liens entre variables, qui situe sur un graphique factoriel les variables (d’une sélection de variables) les unes par rapport aux autres en prenant en compte l’ensemble des attractions (mesurées par le PEM ou un autre indice) en fonction de leur force relative, montrant leurs proximités mutuelles et leur force discriminante dans l’ensemble.
Principaux résultats Les résultats sont détaillés dans trois chapitres (le sommaire est donné plus bas), consacrés respectivement à : - l’incidence des variables sociales sur les identités ; - l’incidence des variables scolaires ; - et une synthèse des résultats sur les questions centrales de l’étude : rapport à la religion, à la citoyenneté, perception des problèmes liés à l’islam, au racisme, à l’immigration. En prolongement, on trouvera un matériau complémentaire dans les annexes. Pour résumer brièvement les grandes tendances qui se dégagent de l’ensemble, l’étude montre qu’il n’y a pas de frontière identitaire forte entre groupes « minoritaires » d’un point de vue ethnique (c’est-à-dire ceux que la catégorisation ethnique place en position socialement désavantageuse) et groupes « majoritaires » (Jenkins, 1997 ; Lorcerie, 2003), ni entre quartiers Nord et quartiers Sud, ni même entre classes sociales distantes. Les identités sociales des lycéens ont des frontières floues, elles sont plutôt fluides que nettement délimitées. En tout état de cause, elles sont moins discriminantes que les conditions sociales objectives, décrites par le statut socio-économique, l’origine nationale des parents, et le lieu de résidence. Cela ressort bien des cartes factorielles des liens entre variables. On voulait mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une pluralité des identités sociales en fonction de la position sociale, du genre et des origines ethniques, modulés par la position scolaire. Nous trouvons à l’arrivée un tableau beaucoup moins structuré que nous ne l’attendions, avec, en même temps qu’une pluralité, une plurivocité marquée des appartenances. Les contenus identitaires (l’expérience scolaire, la satisfaction de la vie, le sentiment de citoyenneté, etc.) sont essentiellement variables au sein de chaque catégorie, et pas seulement entre catégories. Il n’y a pas d’effet de mosaïque. Il y a sans doute des « noyaux » de particularisme, tant chez ceux qui s’identifient comme « français » que chez ceux qui s’identifient par la religion (le plus souvent des musulmans) ou par la couleur de la peau : nous avons tenté de les cerner dans l’étude à partir des profils de modalités. Mais les groupes ainsi construits sont étroits. Toutes les frontières testées sont poreuses et les significations des appartenances apparaissent variables. Tout se passe comme si l’on se trouvait dans une configuration d’« intégration pluraliste » généralisée (Higham, 1975). Avec néanmoins des tendances communes marquées. L’attachement à Marseille émerge comme une dimension subjective commune, sans qu’il s’agisse d’en faire un trait spécifiquement marseillais et « immigré », puisque l’attachement des jeunes au local se vérifie aujourd’hui partout et chez tous (Entzinger, 2003 ; Galland, 2001). Plus globalement, l’enquête dessine une configuration identitaire dominante que l’on peut nommer un cosmopolitisme.
Un cosmopolitisme Le terme de cosmopolitisme désigne ici une orientation identitaire que l’on peut caractériser ainsi : une familiarité et une solidarité au moins imaginaire, parfois concrète, avec l’au-delà de la mer, une pratique du lien humain qui relativise les frontières nationales en même temps que les frontières sociales, sans ignorer qu’elles existent. Cosmopolite est donc pris ici en un sens descriptif (psycho-social et politico-culturel), il ne s’agit pas de l’idéal éthico-politique (Calhoun, 2003). Au vu de notre enquête, le mot « post-national », avancé par Habermas, manque de pertinence. Personne chez nos jeunes enquêtés ne doute de l’existence du cadre national, ils en attendent parfois beaucoup ; simplement ce cadre interfère avec d’autres cadres, les uns locaux, les autres plus larges, balisés par les mobilités transnationales et les échanges de toutes sortes. Le terme de cosmopolitisme permet, nous semble-t-il, de saisir certains traits de la recomposition des modes d’intégration nationale qui s’effectue à Marseille parmi les jeunes, dans le contexte de la « globalisation ». En fait, nos lycéen(ne)s sont favorables à un « nationalisme cosmopolite, libéral et socialiste ». Certains philosophes pensent que c’est là d’ailleurs une façon réaliste – peut-être la seule – d’adhérer aujourd’hui au cosmopolitisme (Nielsen, 2003). Ils/elles veulent à la fois les libertés du libéralisme, les protections de l’Etat-providence, et un nationalisme cosmopolite, qui fasse sa place au souci du Sud. Cette orientation n’est pas pour eux/elles une question d’ascèse morale, c’est une question de ressenti, de mémoire familiale pour une bonne moitié d’entre eux/elles et, pour tou(te)s, une question de vécu quotidien. L’image de la « mosaïque » vient à l’esprit lorsqu’on évoque en France la catégorisation ethnique. Cette image a pu être employée pour évoquer la pluralité enfouie sous l’unité de la France et transcendée par la modernité (Lequin, 1988). Plus souvent, aujourd’hui, elle est associée dans le discours commun à un imaginaire de la dégradation de l’unité nationale, au « multiculturalisme », au « communautarisme ». Les origines extra-européennes de certains et le fait qu’ils entretiennent parfois entre eux et avec leurs espaces d’origine des relations suivies seraient source de profondes différenciations au sein des populations de l’Hexagone. L’image de la mosaïque des cultures et des identités à l’intérieur des frontières du pays laisse entrevoir des conflits civils en germe. Or elle s’avère fallacieuse, tout au moins dans le cas des adolescent(e)s scolarisé(e)s que nous avons interrogé(e)s. Si les lycées de Marseille sont, par les attaches de certains de leurs élèves et l’ouverture d’esprit de la grande majorité, des cités cosmopolites, les élèves ‘minoritaires’ ne sont pas les porteurs de particularismes qui distingueraient des groupes parmi eux. Il y a dans les lycées de Marseille (comme ailleurs) de l’ethnicité sans groupes ethniques délimitables à partir de leurs caractéristiques identitaires (Brubaker, 2002 ; Lorcerie, 2003). Lorsque l’ethnicité devient saillante, c’est donc aux conditions psycho-socio-politiques qui déterminent cette saillance qu’il faut s’intéresser pour en rendre compte, aux processus de la catégorisation ethnique. Mais c’est un autre sujet.
Limites des résultats On sait que la condition lycéenne tend à estomper les clivages sociaux, elle favorise le consensus entre les élèves (Rayou, 1998). Est-ce que l’effet d’estompement des frontières identitaires que nous pouvons constater sur notre population se fait sentir pareillement chez les jeunes non scolarisés ? Et dans les tranches d’âge adultes à Marseille ? Si les lycées publics de Marseille nous semblent constituer des cités cosmopolites, en est-il de même de la ville de Marseille ? Certainement pas de la même façon, – l’enquête reste à faire. Si Marseille suscite des imaginaires romanesques et cinématographiques cosmopolites, ils sont marqués à gauche, orientation politique que déclare aussi la grande majorité de nos lycéen(ne)s ; mais les performances du Front National aux élections empêchent de rêver. D’autre part, l’estompement des frontières pourrait n’être pas totalement stable pour les lycéens eux-mêmes, il pourrait être partiellement relatif aux conditions de recueil des données. Le mode de passation a pu désactiver des attitudes sociales agressives en neutralisant la présence imaginaire des outgroups (voir l’encadré). En contraste, par exemple, le rap marseillais, dont la pratique est fréquente chez les lycéens, surtout en lycée professionnel, repose sur un imaginaire de la compétition intergroupe et de la vicitimisation, il exalte les frontières ethno-sociales (avec les riches, avec les Parisiens) plutôt qu’il ne les estompe (Sberna, 2001). Ce point permet de préciser la notion de plurivocité des appartenances : non seulement les identités sociales des jeunes sont variables pour une même catégorie de classement, mais elles sont pour une part, peut-on penser, opportunistes : pour un même individu, elles sont ou peuvent être sensibles aux circonstances de l’échange. Poser la question des « vraies » identités sociales des jeunes n’a pas de sens. En outre, le message du rap incite aussi à dialectiser la relation entre le ressenti cosmopolite et l’appartenance nationale, à y introduire plus de contradiction que ne le suggère notre matériau d’enquête. Dernière limite à souligner, les lycées privés n’ont pas été enquêtés, or Marseille possède un système de lycées privés très différencié aux plans social, scolaire et religieux. On peut faire l’hypothèse, pour rester dans la ligne du résultat majeur de notre analyse, que l’enquête en leur sein aurait permis de mieux localiser les « noyaux » particularistes sous-jacents dans la configuration identitaire globalement cosmopolite des adolescent(e)s marseillais(es). Il reste que l’absence de segmentation identitaire forte induite par la catégorisation sociale parmi les lycéen(ne)s, la plurivocité des appartenances, l’ouverture cosmopolite se dégagent nettement du matériau. On ne peut éliminer l’hypothèse que ces traits de la population d’enquête reflètent des tendances bien représentées aujourd’hui chez les jeunes de toutes origines et de tous milieux sociaux, à la fin de leur scolarité secondaire, à Marseille.
Quelques résultats particuliers Sur les dimensions retenues comme pertinentes, qui sont souvent politisées dans le débat public, l’enquête a permis des observations fines et de ce fait, nous semble-t-il, précieuses. Quelques exemples brefs.
Marginalité de l’expérience scolaire au regard des variables de l’identité sociale. Centralité des variables identitaires par rapport aux variables de position. Les questions de l’enquête éclairent diverses composantes des identités sociales des élèves : identité subjective (la définition catégorielle de soi, à l’aide d’une liste : marseillais, français, européen, habitant du monde, jeune, homme ou femme, couleur de peau, origine, religion – deux réponses), positions sur certains problèmes discriminants (peine de mort, avortement, cours de morale, régularisation des sans papiers, etc.), attitude à l’égard de l’islam (est-il un obstacle à l’intégration ? – question ouverte), perception de tolérance ou de racisme autour de soi et dans la société, conception de la citoyenneté (question ouverte), options politiques ; ainsi que des dimensions spécifiquement liées à l’expérience scolaire (rapport aux professeurs, aux autres élèves, améliorations souhaitées dans le lycée, etc.). Dans l’ensemble, ces composantes sont peu liées aux variables scolaires, à l’exception des dimensions spécifiquement scolaires des identités lycéennes. Sur les cartes des liens entre variables, elles apparaissent toujours dans la portion de l’espace factoriel où sont les variables de condition sociale (origine, statut socio-économique), à distance des variables de position scolaire et faiblement liées à celles-ci. De surcroît, elles sont plus centrales, c’est-à-dire moins discriminantes que les variables de position scolaire et également celles de position sociale.
L’auto-identification ‘Marseillais’ entre dans une diversité de configurations identitaires. Les deux modalités d’identification les plus choisies sont Marseillais suivi de Jeune. Elles sont aussi les modalités les moins dépendantes de critères sociaux, ces choix sont très bien distribués dans la population d’enquête. Tout juste la préférence pour Marseillais est-elle particulièrement marquée dans les classes moyennement cultivées (les mères ont plus souvent une scolarité secondaire) et chez les garçons. C’est aussi le premier choix des filles, mais celles-ci se dispersent davantage sur les autres options, notamment sur être un homme ou une femme. En bref, que l’on étudie dans une classe de Foch chauffée pour Prépa ou dans une section menuiserie de Montaigne, que l’on soit fils de cadre né à Londres ou immigré comorien, on s’identifie au territoire local, à la communauté marseillaise (les variables scolaires et les variables d’origine n’interviennent pas dans ce choix). De même, les attractions avec d’autres éléments de l’identité sociale, notamment l’identité politique, sont rares. On ne trouve pas d’attraction particulière concernant la religion et son importance, l’avis sur l’islam, les objectifs prioritaires des hommes politiques, la peine de mort, etc. Ce qui caractérise plus spécifiquement le choix de Marseillais comme catégorie d’appartenance est une sorte d’apathie sociale : une tendance à méconnaître ou à nier les tensions civiles (c’est la seule identification qui attire typiquement l’idée que le racisme est un phénomène qui n’existe pas vraiment), et une tendance à méconnaître le fonctionnement de la laïcité (ceux et celles pensent qu’on n’a pas le droit d’être français et en même temps d’une autre religion que catholique choisissent typiquement Marseillais). Mais en réalité le sens que les individus confèrent à la catégorie Marseillais est probablement variable. La particularité de cette attache, en effet, est qu’elle s’associe avec un maximum d’autres options. Elle se combine préférentiellement avec des options d’identification aussi différentes que la fierté hexagonale (l’association des choix Français et Marseillais est très significative), ou une affirmation transnationale (association significative de Marseillais et Origine nationale), ou encore l’affirmation d’appartenance religieuse (association forte entre Marseillais et Votre religion), et finalement avec l’idée que la communauté d’âge est facteur d’appartenance (association privilégiée de Marseillais et de Jeune). Or, si l’on excepte cette dernière modalité, les autres correspondent à des profils sociaux différenciés. Seuls ne sont pas spécialement enclins à valoriser l’appartenance locale ceux et celles qui s’identifient par leur genre, ou bien qui relativisent l’appartenance nationale en choisissant une référence plus universelle (Habitant du monde ou, plus rarement, Européen).
La communauté marseillaise inclut-elle d’autres communautés ? Incidence inattendue de l’opposition quartiers Nord / quartiers Sud Une question demandait de se prononcer sur l’énoncé : ‘Certains disent que Marseille est une ville où vivent plusieurs communautés’. Son analyse permet de mieux cerner les logiques psycho-sociales sous-jacentes à l’auto-identification comme marseillais. C’est l’une de celles qui sont le mieux corrélées à des variables sociales et scolaires. Les 4 modalités de réponse sont en réalité socialement marquées, y compris sans opinion, qui apparaît ici comme une façon de prendre position sur la question. La réponse tout à fait d’accord (près de 30% des élèves) apparaît plus fréquente en milieu favorisé d’origine française, féminin et en fin de scolarité, et surtout plus généralement dans les établissements des quartiers Sud de Marseille. Le rapport à la scolarité est bon. On y note une propension à relativiser les tendances centrales dans la population d’enquête : les hommes politiques de droite sont jugés plus souvent tolérants, Marseille ou les professeurs plus souvent racistes. L’identification nationale est significativement plus marquée que dans les autres modalités de réponse : qu’il s’agisse de l’auto-identification par la catégorie français, ou de la production d’une définition de la citoyenneté par l’appartenance nationale. La défiance à l’égard de l’immigration est plus marquée également, mais pas spécialement à l’égard de l’islam. La réponse pas d’accord (15% des élèves) apparaît à l’opposé comme une réponse typique de lycéen(ne)s des LGT des quartiers Nord, de milieu plutôt défavorisé, masculin, en début de scolarité au lycée et portant sur leur lycée un jugement global plus souvent mauvais ou très mauvais. Ils manifestent semble-t-il une certaine pugnacité dans la scolarité. Ainsi, ont-ils fait grève significativement plus souvent, et ils considèrent plus souvent que le délégué de classe les défend. Ils se déclarent à 45% de religion musulmane et sont un peu plus nombreux que l’ensemble, 50%, à vouloir laver l’islam de tout soupçon d’entraver l’intégration. La réponse sans opinion (42,5% des élèves) réunit quant à elle le gros des élèves des quartiers Nord. Tous les établissements des quartiers Nord et eux seuls y sont typiquement représentés, LP comme LGT. Ceux/celles qui choisissent cette modalité de réponse sont à 49% issus de milieu défavorisé, ils sont plus souvent (mais en minorité) d’origine algérienne ou comorienne. Ils se déclarent musulmans à 46%, et défendent l’islam contre toute imputation de nuire à l’intégration à 51%, soit des taux analogues à la catégorie précédente. S’ils sont sensibles à la racisation (plus nombreux sont ceux/celles qui s’identifient plutôt par la couleur de leur peau, et qui se déclarent victimes du racisme des commerçants ou de la police), ils n’ont pas sur le racisme et la tolérance à Marseille, dans la société, ou chez les professeurs une position qui les particulariserait. Plus que dans la catégorie précédente, ils mettent en avant une vision morale du lien citoyen, insistant sur la solidarité et le respect mutuel. Ils sont aussi très majoritairement sensibles aux déséquilibres Nord-Sud et souhaiteraient que l’action politique les corrige. Au total, donc, l’idée de pluralité des communautés, autour de laquelle était construite la question, a activé dans notre population le grand partage du territoire marseillais entre quartiers Nord et quartiers Sud. Les élèves des quartiers Sud ont typiquement répondu plus souvent qu’ils étaient d’accord ou assez d’accord avec l’affirmation proposée, tandis que ceux des quartiers Nord ont été typiquement réticents à le faire. Ils ont pris position contre l’idée, ou ont adopté une position de retrait en choisissant la modalité sans opinion. Pourquoi les élèves des quartiers Nord se défendent-ils de l’idée de pluralité des communautés à Marseille, alors qu’ils reconnaissent autant que les autres l’existence du racisme à Marseille, qu’ils s’en disent plus souvent victimes, qu’ils se réclament parfois d’appartenances communautaires, qu’ils valorisent la solidarité ? A défaut d’un complément d’enquête sur ce point, nous voyons deux hypothèses. Toutes les deux ont à voir avec la charge symbolique du mot communauté, mais l’interprètent différemment. - Il se pourrait que l’affirmation d’une pluralité de communautés à Marseille soit ressentie comme atténuant ou mettant en cause l’unité de principe de Marseille, unité que les élèves des quartiers Nord ressentent comme une protection, au point que l’identification par l’appartenance marseillaise est leur identification dominante ; - ou encore, il se pourrait qu’ils perçoivent un danger à donner leur aval au mot communauté mis au pluriel. Peut-être sentent-ils que cet usage prête le flanc dans l’espace français à une imputation de communautarisme, qu’il désigne ‘les immigrés’. Les données recueillies à l’enquête appuient la première interprétation (voir les réponses à la question sur Marseille plutôt raciste ou plutôt tolérante). La réponse à la question sur la pluralité des communautés à Marseille enrichirait alors le constat que nous avons fait de la pluralité des significations psycho-sociales que recèle l’identification dominante à Marseille. Pour les jeunes des quartiers Nord, cette identification recèle une dimension revendicative et compensatrice des stigmates sociaux qu’elle n’a pas forcément pour les jeunes des quartiers Sud.
‘L’islam est-il un obstacle à l’intégration des populations d’origine maghrébine et africaine en France ?’ – question à échelle, suivie d’expansion libre Un peu plus de 20% des élèves choisissent la religion comme une de leurs identifications, dont une moitié environ des originaires du Maghreb. Mais presque la moitié de notre population totale répond pas d’accord du tout à la question ci-dessus, 6% seulement se déclarant tout à fait d’accord. La déclaration sans opinion est significativement plus fréquente dans les catégories qui ne sont pas de culture musulmane. De même, la tendance à modaliser son avis par plutôt, que l’on soit disposé à accepter l’islam ou non. A l’inverse, les catégories plus marquées par la référence musulmane sont très significativement plus enclines à écarter totalement l’idée que l’islam puisse être un obstacle à l’intégration. Cette position concerne près de 80% des descendants d’immigrés maghrébins, et 75% des descendants d’immigrés d’Afrique subsaharienne ou des Comores, contre 44% des originaires de France. Dans cette catégorie, cependant, l’idée que l’islam est un obstacle à l’intégration n’est acceptée que par un quart des élèves, sous sa forme modalisée ou, plus rarement, sous sa forme absolue. L’examen de la variation selon le statut socio-économique de la famille donne une image moins contrastée mais la variation reste très significative. Elle n’est pas sans lien avec la composition ethnique des catégories de statut. La catégorie favorisée se particularise par une tendance plus marquée à préférer les énoncés modalisés, mais au total elle écarte à 59% l’idée que l’islam soit un obstacle à l’intégration. Presque autant que dans la catégorie défavorisée, qui l’écarte à 66%. C’est dans la catégorie de statut intermédiaire que cette idée est le moins fréquemment écartée : elle l’est néanmoins dans plus de 50% des cas. L’idée adverse varie entre un taux de 14% dans la catégorie défavorisée et 24% dans la catégorie favorisée. Les élèves des lycées généraux et technologiques sont significativement plus enclins à recourir à l’adverbe plutôt que les élèves des lycées professionnels, lesquel(le)s sont plus typiquement sans opinion. Mais au total la fréquence avec laquelle est écartée l’idée que l’islam est un obstacle à l’intégration est analogue dans les deux types d’établissements (55% en LP, 58,5% en LGT). La modalisation par plutôt apparaît comme typique de la classe de terminale, tandis que les secondes LGT choisissent plus fréquemment la position tranchée pas d’accord du tout, les secondes BEP-CAP étant plus souvent sans opinion ou sans réponse. Un peu plus du tiers des élèves ont saisi la possibilité qui leur était offerte de préciser leur pensée. Les énoncés recueillis montrent que la notion d’intégration fait sens pour les élèves, ils l’associent à un problème public, à l’instar de la communication médiatique et de la communication politique. La position dominante est que les difficultés de l’intégration sont dues à des maux sociaux dans lesquels le dénigrement de l’islam, la peur de l’islam jouent un rôle. Dans notre population, elle est 5 fois plus fréquente que la position qui attribue les difficultés d’intégration à l’islam. On trouve à peu près à égalité trois types d’arguments avancés : (1) celui qui dégage la responsabilité de l’islam dans les problèmes, en avançant une approche systémique de l’intégration : mise en cause de l’assimilationnisme, du racisme, et plus largement des processus de dénigrement à base ethnique ; (2) l’argument qui dégage la responsabilité de l’islam en expliquant qu’il ne peut être en soi source de problèmes d’intégration. L’islam, disent ces élèves, est parfaitement compatible avec les institutions, ses valeurs sont profondément les mêmes que le christianisme, il commande même de s’intégrer, et il ne faut pas le confondre avec les excès de quelques uns ; (3) l’argument qui dégage la responsabilité de l’islam au nom du cadre institutionnel français et du droit : droit d’avoir une religion et liberté de religion, pourvu qu’on l’exerce dans le respect d’autrui, principe d’égalité, principe de séparation du religieux et du politique, certains énoncent le mot de laïcité. Le premier type d’argument a souvent été produit dans un système énonciatif où les élèves parlent en tant que non-musulmans, en témoins ; tandis que le second apparaît généralement dans un système énonciatif où les locuteurs se positionnent en tant que musulmans, en défenseurs (ils/elles s’inscrivent dans un nous). Le troisième type d’argument, par le droit, est indifférencié à cet égard. On le trouvera aussi en abondance dans les réponses à la question qui demandait de produire une définition de la citoyenneté.
En conclusion, Le constat général qui se dégage de l’analyse corrobore celui que fait Richard Jenkins dans le cas britannique : « Le nom peut être le même, ‘X’ par exemple, et l’expérience d’être un ‘X’ changer radicalement ; de même l’expérience peut être relativement stable, tandis que le nom change ; ou les deux peuvent changer » (Jenkins, 1996, notre trad.). C’est ce que nous avons nommé la plurivocité des appartenances catégorielles. Il est très aléatoire, à partir du matériau recueilli dans le cadre de cette enquête, de tracer des portraits-types qui correspondraient aux grandes catégories du classement social et scolaire : quartiers Nord/ quartiers Sud, LP/LGT, catégorie favorisée/défavorisée/ intermédiaire, issu de l’immigration maghrébine/ africaine/non issu de l’immigration, etc. Les typologies ne sont pas stables d’une série de questions à l’autre, et elles sont souvent peu consistantes socialement (elles jouent sur peu de variables). En fait, conçue pour caractériser la variation identitaire, l’enquête recadre la question. Elle montre la forte centralité de certaines identifications et attitudes (identification à Marseille, à la devise républicaine, lutte contre le racisme, tolérance à l’égard de l’islam, philosophie de la sanction scolaire, idéal dans la vie, etc.), en même temps qu’une forte individualisation (tendance générale à l’estompement des frontières inter-catégorielles). |
| Avertissement | |
| La problématique du Colloque 2006, dont le thème a été
défini lors du CA de mai 2005, a été retravaillée lors des journées des
militants (30 septembre, 1er et 2 octobre 2005). Le riche texte qui suit est donc un document de travail dont le but est d'aider à la réflexion. |
|
Inspecteur général de l’éducation nationale Doyen du groupe établissements et vie scolaire Professeur associé à l’Université Paris 5 |
|
| [1] Intervention effectuée devant les chefs d’établissement et responsables de la Mission laïque |
La place de l’élève au sein de l’établissement scolaire :
Une approche historique et institutionnelle[1] |
|
La question de la place de l’élève au sein de l’établissement scolaire est un sujet essentiel pour tous les acteurs du processus éducatif. Et pourtant, c’est une question qui peut paraître étonnante. Peut-on imaginer en effet un système éducatif sans élèves et donc sans une place pour les élèves ? Peut-on imaginer un établissement scolaire dans lequel les élèves n’auraient pas une place? Se poserait-on la même question sur la place des enseignants au sein des établissements scolaire ? Tout simplement, se serait-on posé la même question et dans les mêmes termes il y a trente ans ? On peut penser que si le législateur de 1989 a éprouvé le besoin de dire que cette place est au centre du système, c’est que cela n’allait peut-être pas de soi. Et si, de son côté, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école d’avril 2005 place, dans son article 3, les élèves en tête de l’énumération des membres de la communauté éducative : « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions », c’est que cela paraissait important à la représentation nationale de l’affirmer solennellement, et cette affirmation sonne aussi comme un rappel. Si les élèves ont évidemment une place au sein des établissements, la question est plutôt quelle sorte de place on leur fait et comment cette place s’est construite et a évolué historiquement et institutionnellement. |
|
Dans un premier temps je propose, en prenant l’exemple des lycéens, de regarder comment la place des élèves a évolué depuis vingt-cinq à trente ans au sein des établissements scolaires. J’envisagerai ensuite la question sous l’angle de ceux qu’on appelle les « nouveaux publics » : l’arrivée de « nouveaux publics » issus de la démocratisation de l’accès au lycée a-t-elle modifié la place accordée aux élèves dans les établissements et quelle place a-t-on fait de façon générale aux élèves issus de familles populaires au lycée et aux élèves en difficulté au collège ? Enfin, j’aborderai la question de la place de l’élève sous différents aspects pédagogiques et éducatifs : quelle place fait-on aujourd’hui à l’élève dans la construction des apprentissages, quelle place fait-on à l’éducation citoyenne de l’élève et enfin quelle place peut-on laisser à certaines revendications identitaires des élèves au sein des établissements ?
1. Quelle place fait-on aux lycéens dans les établissements scolaires depuis trente ans ?
C’est un sujet qu’il n’est pas facile de traiter car, aussi surprenant que cela paraisse, il n’existe pas beaucoup de travaux historiques ou sociologiques sur les acteurs essentiels du système éducatif que sont les élèves. Dans son important travail sur les lycéens en 1991, François Dubet pouvait dire alors « on connaît tout du système et pas grand chose des acteurs », et il soulignait « l’absence ou la part infime des travaux consacrés aux élèves dans la production sociologique consacrée à l’école»[1]. C’est assez dire le peu de cas que l’on a très longtemps fait de l’élève en tant que personne et acteur digne d’étude dans notre système éducatif. Depuis, les choses ont sensiblement changé. Pour ne prendre que l’exemple des travaux de l’inspection générale, on peut observer un effort pour centrer quelques études sur les élèves eux-mêmes. Par exemple, on peut citer le rapport sur « les élèves en difficulté au collège » de 2003 ou le rapport sur « l’emploi du temps des élèves de lycée » de 2001. Il n’existe pas non plus de texte spécifique, loi, décret ou autre circulaire, qui « détermine la condition juridique des élèves comme le statut de la fonction publique le fait avec les fonctionnaires. A l’école, les jeunes relèvent […] d’un ensemble de dispositions éparses, législatives et réglementaires, complétées et interprétées par une jurisprudence de plus en plus abondante. »[2]
Aujourd’hui, les élèves en général et les lycéens en particulier jouissent d’un certain nombre de libertés qui se manifestent par une liberté d’expression individuelle ou collective encadrée, notamment et j’en parlerai à la fin de mon propos, pour ce qui concerne le port de signes discrets d’appartenance religieuse, par la reconnaissance de droits de réunion, d’association, de publication, par la participation à un certain nombre d’instances de dialogue ou de concertation. A ces droits répondent des devoirs et obligations qui concernent le travail scolaire et la vie scolaire. L’apparition de ces droits est un phénomène récent. Longtemps, en effet, s’agissant des élèves, le système éducatif a surtout proféré des interdictions. Pour prendre l’exemple de l’absence de liberté d’expression et de la coupure nette entre le monde scolaire et la vie, on peut citer la circulaire de 1925 qui invitait les chefs d’établissement de l’époque « à ne tolérer parmi vos effectifs scolaires ni création de secteurs, ni désignation de subdélégués mandatés par aucune organisation, ni remise de buvards communistes ou de programmes électoraux. Vous ne devez admettre dans les établissements scolaires aucune caricature de nos querelles civiques auxquelles les adultes suffisent. » Le tournant pris dans les années 1970 est d’autant plus sensible. Une circulaire du 28 avril 1970 indique en effet que « la vie scolaire ne doit pas tendre à isoler les lycéens de la société dans laquelle ils sont appelés à vivre, mais à leur permettre progressivement la recherche de l’information objective et la pratique de la tolérance, conditions nécessaires à l’éducation du citoyen. » Souvenons-nous aussi que la question des droits et obligations des élèves est apparue dans le système éducatif d’abord sous « l’angle d’un droit à l’école. »[3] Je veux parler de l’apparition dans les lois républicaines liées à l’obligation scolaire à 13 ans (1882), 14 ans (1936) et 16 ans (1959) et du droit à l’éducation réaffirmés dans la constitution de 1958, dans la loi de 1975 et celle de 1989. Depuis la fin des années 1960, on parle aussi « d’un droit dans l’école »[4] qui accompagne « le phénomène de massification de l’enseignement » et qui permet de reconnaître aux élèves un certain nombre de droits. Les élèves ne sont plus alors de simples usagers du service public mais ils sont considérés comme des futurs citoyens que l’école reçoit pour mission de former en conséquence. Il peut être intéressant de se demander un instant si ces nouveaux droits sont apparus naturellement dans le paysage éducatif, en quelque sorte comme une conséquence logique à la fois de la massification, de l’allongement de la scolarité (beaucoup de lycéens sont aujourd’hui majeurs) et de la reconnaissance de l’élève comme personne, ou si le ministère de l’éducation nationale a été conduit à prendre ces mesures sous la contrainte des événements. Si je pose cette question, c’est qu’on doit remarquer que les mesures prises en faveur de nouveaux droits des lycéens en 1991 se situent quelques mois à peine après l’important mouvement lycéen de 1990. Et, de fait, régulièrement, depuis une quarantaine d’années, on constate que les élèves bougent, que les lycéens manifestent et que la société semble d’ailleurs découvrir à chaque fois les problèmes que les jeunes soulèvent en 1986, 1990, 1994, 1999-2000, 2005. Les élèves ne seraient-ils donc pas satisfaits de la place qu’on leur fait dans les établissements ? De quoi se plaignent les élèves dans ces moments de révolte et que veulent-ils ? Plusieurs travaux se sont penchés sur la question, notamment ceux de François Dubet.
Il est à cet égard tout à fait significatif de relever que, contrairement au mouvement de 1968, les explosions lycéennes qui se produisent de 1986 à aujourd’hui ne remettent jamais en cause l’école et ses finalités. Les élèves sont finalement, et c’est plutôt réconfortant, très attachés à notre tradition républicaine, ce qui n’avait pas empêché certains journalistes de parler de façon outrancière, au moment des manifestations de 1986, de « sida mental » des lycéens[5]. Cette incompréhension des demandes des lycéens est également visible en 1990 quand, en réponse aux inquiétudes des lycéens, le CNP fait des propositions pour atténuer la hiérarchie entre les filières au lycée. Un syndicat enseignant considère alors cette proposition « inacceptable pour les jeunes et pour le personnel pour lequel elle aurait pour conséquence de rendre le métier plus difficile par l’accroissement de l’hétérogénéité des élèves, par la multiplication du nombre de classes, par les changements d’emploi du temps »[6]. François Dubet fait remarquer que le mot hétérogénéité utilisé ici est « une façon élégante de désigner les nouveaux élèves issus des milieux populaires. Quant à l’affirmation du droit des élèves dans les établissements, elle se heurte à de vives résistances chez bien des proviseurs. »[7]
Ce qui s’est passé en 1990-1991 incite donc, pour le moins, à se poser la question de savoir si c’est le système éducatif qui ajuste régulièrement sa façon de faire une place à l’élève au sein des établissements, en dehors de toute pression du contexte, ou si ce sont les lycéens qui se font une place différente dans le système éducatif, explosion scolaire[8] après explosion scolaire. En vérité, comme souvent, la vérité est plus complexe. En fait, le ministère de l’éducation nationale, contrairement à une idée reçue, a largement anticipé les évolutions, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que, sur le terrain, tous les établissements scolaires aient eu la même attitude. Prenons comme repère la loi du 11 juillet 1975 qui préconise fortement que les établissements aident les élèves à accéder à l’autonomie pour mieux s’intégrer à la société. Complétée par le décret de 1985, cette loi reconnaît aux élèves le droit de participer à la vie de l’établissement par le biais du conseil d’administration, de la commission permanente et du conseil de discipline. Par contre, la liberté de réunion est accordée aux élèves (limitée pour les collégiens aux seuls délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions), après la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et après le mouvement lycéen de 1990. Si la loi d’orientation de 1989 prévoit la liberté d’association, liberté accordée aux citoyens depuis le 1er juillet 1901 mais refusée aux élèves depuis pendant presque un siècle sauf pour l’association sportive (1984) et les foyers socio-éducatifs (1968), et si la lettre de préparation de la rentrée 1990[9] fixe, pour la première fois, comme objectif de donner plus de responsabilité aux élèves et « invite les proviseurs à mettre en place à titre provisoire les conseils de délégués des élèves », c’est un décret de février 1991 qui la garantit aux lycéens et qui permet en particulier de constituer la Maison des lycéens, décision qui intervient donc après les manifestations de 1990. De même, l’article 10 de la loi de 1989 dit que «dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression », mais c’est le décret du 18 février 1991 qui traduit ce principe dans les faits. Autrement dit, le ministère de l’éducation nationale montre qu’il est prêt à des évolutions, qu’il les préconise même, mais c’est aussi la force des événements qui a pu accélérer le processus et ouvert aux élèves le bénéfice de libertés publiques. Il faut vite répondre aux lycées qui ont manifesté fortement à l’automne 1990 et la lettre ministérielle de préparation de la rentrée 1991 le dit explicitement. Le ministre y demande a en effet aux recteurs d’être très présents dans les lycées pour « coordonner et aider l’action des proviseurs mais également pour indiquer aux élèves que votre action porte sur la résolution progressive des difficultés qu’ils rencontrent. »[10] On verra tout à l’heure avec quel degré d’engagement et de réussite cette action a été relayée dans les établissements scolaires.
2. L’idée que l’on se fait de la place de l’élève au sein des établissements scolaires a-t-elle évolué en fonction de l’arrivée de nouveaux publics ? Quelle place fait-on à ces nouveaux publics ?
Si l’expression de « nouveaux publics » est employée communément pour les lycées comme pour les collèges, cela ne veut pas dire qu’elle soit entièrement juste. Et puis, d’ailleurs, fréquente-t-on un établissement scolaire comme on assiste à un spectacle ? Cette expression n’est pas totalement juste en effet et il faut toujours veiller, c’est le rôle des historiens, à ce que le passé ne soit pas caricaturé[11] et souvent trahi par l’idée reçue d’un supposé âge d’or. L’école n’échappe pas à cette difficulté. Car le problème avec les souvenirs concernant l’école c’est qu’ils s’alimentent à trois sources, bien identifiées par Pierre Caspard s’agissant de l’histoire des lycées lors d’un colloque à la Sorbonne en 2002 : « d’abord les souvenirs que chacun conserve de ses années d’études, souvenirs singuliers, parfois déformés, non généralisables, mais particulièrement prégnants. Ensuite, les grands stéréotypes qui franchissent les siècles : lycées-casernes, lycées-prisons, lycées-papillon…Enfin, et surtout, une histoire subliminale que distille quotidiennement nombre de propos tenus sur le lycée actuel et son avenir, et qui, sur le mode du « désormais » ou du « dorénavant », réduisent globalement le lycée d’hier au rôle de repoussoir ou de boulet pour les réformes jugées nécessaires. »[12] Et puis lors du même colloque sur l’histoire des lycées, plusieurs historiens ont bien montré que les lycéens du passé n’ont pas été « que des héritiers trouvant au pied de leur lit, à leur naissance, la panoplie complète du bon élève, mais que beaucoup d’entre eux étaient aussi des travailleurs infatigables dont l’investissement en travail a toujours eu quelque rapport avec la réussite des études. »[13] Par ailleurs, il ne faut pas s’imaginer un « ancien et statique public mythique »[14] qui n’en en fait jamais totalement et exclusivement existé. Il a toujours existé des boursiers ; les jeunes filles sont venues rejoindre les garçons, dans des établissements séparés d’abord, mixtes ensuite ; la démocratisation a en fait commencé dès les années 1930 avec la mise en œuvre de la gratuité du secondaire. A chacune de ces vagues successives, le système a dû s’adapter aux spécificités sexuelles, culturelles ou sociales des élèves. Mais cela dit, on a évidemment raison d’utiliser l’expression de « nouveaux publics »si on parle des nouveaux élèves qui ont massivement accédé à l’enseignement secondaire depuis trente ans. Jusque dans les années 1960-1970, l’enseignement secondaire est resté en effet un enseignement d’élite et la véritable démocratisation date de quelques dizaines d’années seulement, à partir du moment où l’école a été effectivement ouverte au plus grand nombre. Signalons, à titre d’illustration, que la note de service pour la préparation de la rentrée 1982 évoque officiellement l’objectif de « démocratisation de la formation scolaire au plus grand nombre »[15], mais remarquons que le système éducatif semble avoir du mal à se faire à ce « nouveau public » puisque la circulaire de préparation de la rentrée 1989 parle encore à ce moment des « nouveaux élèves » du lycée.[16] Tous les jeunes ont donc aujourd’hui en principe leur place au sein des établissements scolaires. On a ouvert le collège au début des années 1960, créé le collège unique au milieu des années 1970, accueilli au lycée sous le double effet de l’objectif des 80 % et de la création du Bac Pro[17], un public nouveau dans le second cycle à partir du milieu des années 1980. Tout cela s’est fait dans des délais extrêmement rapides. La circulaire de préparation de la rentré 1984 pour les lycées permet au ministre Savary de reconnaître qu’une « telle politique n’est pas simple ». Il rend hommage « aux personnels de l’éducation nationale qui travaillent chaque jour avec un nombre croissant d’élèves appartenant aux milieux culturels et sociaux les plus divers. »[18] Car il ne suffit pas de trouver une place[19] à chacun de ces nouveaux élèves, il faut encore organiser pour tous une scolarité réussie.
Il est vrai qu’il n’a pas été facile, et qu’il n’est toujours pas facile pour certains élèves, parlons vrai et nommons-les puisque ce sont les enfants du peuple, de trouver leur place au sein des établissements du second degré. Déjà, en 1972, dans un rapport au ministre de l’éducation nationale sur la fonction enseignante dans le second degré, Louis Joxe écrivait ceci : « Les enseignants d’aujourd’hui vivent avec leurs élèves une situation trop difficile et trop décevante ; les élèves actuels diffèrent de ceux pour lesquels le système ancien avait été conçu ; la société remet en question l’école et sa culture de façon trop radicale pour que le rapport pédagogique traditionnel puisse encore être accepté naturellement et vécu comme un accomplissement. A tout prendre, l’étonnant n’est pas que nous connaissions aujourd’hui une crise de l’acte pédagogique, mais bien qu’elle ne soit pas encore plus vive, et que les enseignants réagissent aussi bien. »[20] Trente ans plus tard, Jean-Pierre Obin, dans son rapport au ministre Enseigner un métier pour demain, fait le même constat : les enseignants ressentent une détérioration de leur métier en raison de l’évolution des élèves « moins bien préparés par leur éducation familiale et sociale à une scolarisation longue à laquelle ils n’aspiraient pas forcément. »[21] J-P Obin rend compte du désarroi des enseignants devant des élèves « dont la façon d’être et de travailler n’est plus la même » (sous-entendu qu’avant la démocratisation), et dont « le comportement a profondément évolué : plus audacieux et moins travailleurs, ils n’acceptent plus d’emblée les règles et les codes scolaires, leur motivation semble plus faible, ils travaillent plus difficilement à la maison, manquent d’attention en classe et ne savent plus se fixer sur une activité. […] ‘’Matériel oublié, travail non fait, absences, mauvaise tenue, chewing-gum, vulgarité’’ écrit l’un d’eux. […] Un sentiment qui semble partagé est que le niveau de recrutement baisse, que l’expression écrite se détériore, que l’hétérogénéité augmente et que les comportements se dégradent. »
Pourtant l’accueil de ces nouveaux élèves a fait l’objet d’une action soutenue et remarquable de la part du ministère et des personnels qu’il faut saluer. Je veux parler des efforts budgétaires importants (la France est un des pays qui dépensent le plus pour son second cycle), des efforts d’adaptation des enseignants qui n’ont pas à rougir du travail effectué dans le cadre de cette démocratisation, des offres multiples d’enseignement et d’options mis en place, de la création de nouvelles filières d’enseignement, des dispositifs de plus en plus diversifiés de lutte contre l’échec scolaire.
La place des élèves pauvres dans l’établissement scolaire [22]
La centration sur l’élève évoquée il y a un instant s’est accompagnée de la mise en place de dispositifs pédagogiques qui ont pour objectif de permettre à chaque élève d’aller à son rythme pour acquérir les connaissances et les compétences prévues dans les programmes. Mais la différenciation pédagogique doit-elle nécessairement conduire à une individualisation des enseignements ? Cette question est loin d’être anecdotique pour les élèves issus de familles pauvres puisque selon les estimations de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, nous scolarisons aujourd’hui dans nos écoles, collèges et lycées plus d’un million de jeunes venant de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Or, devant les difficultés lourdes de certains enfants et adolescents de milieu populaire, ne commet-on pas, ici ou là, un contresens sur « l’adaptation de l’école » et sur l’individualisation des enseignements, en réduisant, de fait, malgré les instructions officielles, les exigences en matière d’apprentissage ? Qui sont les élèves les plus touchés par certaines dérives de la pédagogie du détour qui, à force d’emprunter les chemins de traverse, perd de vue les apprentissages ? Et qui sont les parents qui peuvent le soir, avec l’aide du « Bescherelle » ou du « Bled », structurer les apprentissages fondamentaux qui font aujourd’hui défaut dans certains cas ? Nous sommes évidemment tous convaincus que l’école qui s’adresse aux pauvres ne doit pas et ne peut pas être une école appauvrie dans ses objectifs et dans ses contenus et qu’il ne faut en aucun cas proposer une école au rabais sous prétexte que le contexte de la vie quotidienne de ces enfants est difficile. L’école de la République a les mêmes ambitions pour tous les élèves, sinon ce n’est plus l’école de la République. Et d’ailleurs, les pauvres eux-mêmes, quand on veut bien les écouter, ne veulent surtout pas d’une école adaptée aux pauvres. Ils veulent, dans un réflexe salutaire, la même école que les autres, accéder à l’universel et ne veulent pas pâtir de certains délires relatifs au fameux « droit à la différence ». Le réflexe de ces familles est d’autant plus intéressant qu’il les conduit, en fait, à refuser l’individualisation croissante de notre société et de son école : ce que veulent les familles populaires pour leurs enfants c’est, si je puis dire, du collectif, de l’universel. Les familles pauvres veulent du « scolaire » car elles savent bien que c’est le « scolaire » qui ouvre au monde. Ces familles rejoignent en cela certains chercheurs[23] dont les recherches sur l’échec scolaire devraient conduire à privilégier, dans les conditions d’apprentissage mises en œuvre, un enseignement plutôt collectif (ce qui n’exclut pas la mise en place temporaire de groupes de besoins), en classe hétérogène (ce qui n’exclut pas des moments de travail de groupes), structuré et explicite, avec une mesure régulière de la progression des élèves, plutôt qu’un enseignement systématiquement différencié ou individualisé. Méfions-nous donc, pour les enfants de milieu populaire tout particulièrement, de cette tendance à individualiser à l’extrême le travail scolaire en classe. Utilisée sans discernement, l’individualisation fait que l’élève n’a d’autre repère que lui-même. Or, la classe collective, c’est aussi le moyen d’apprendre ensemble des connaissances difficiles. L’exemple des ZEP est significatif. Le bilan dressé est plutôt positif là où, précisément on est resté centré sur les apprentissages fondamentaux en conservant le maximum d’hétérogénéité possible dans les classes et, donc, là où l’on a pas abaissé le niveau d’exigence.
Quelle place au collège pour le travail personnel du collégien en difficulté ?
Rappelons que, en application de la loi de 1975, c’est à la rentrée précédente de 1977 qu’a commencé à se mettre en place « un tronc commun de formation »[24] à l’entrée en 6ème. Avant cette date, les maîtres de l’école primaire donnaient un avis sur le « type de pédagogie »[25] qui convenait aux élèves de C.M.2 et ces derniers étaient affectées dans l’une des trois filières du collège d’enseignement général : type 1 (long), 2 (court) ou 3 (transition et classes pratiques). Dans cette configuration des études, chacun étant à la place que le système lui assignait, l’élève en échec n’existait pratiquement pas car chaque élève voyait son destin scolaire pris en charge dans une filière globalement homogène et précocement déterminée. Le collégien « en difficulté » apparaît dans les circulaires de rentrée à partir du moment où les filières sont supprimées. Réaliste, la circulaire de rentrée 1978 évalue le nombre de dossiers d’élèves en difficulté à un maximum de 30% des élèves scolarisés en C.M.2. Ce chiffre donne un ordre de grandeur du nombre d’élèves qui ne sont pas prêts à accéder au tronc commun à ce moment et qui risquent donc de se trouver en difficulté. Je crois qu’on peut dire, sans forcer le trait, que l’apparition de l’élève en difficulté au collège marque donc un progrès important dans l’histoire du système éducatif, ne serait-ce que parce qu’on fait alors une place dans le second degré à un public nouveau qu’il a fallu aider à s’adapter. De ce point de vue, nous qui avons trop tendance à porter un jugement pessimiste sur notre système, saluons le formidable travail accompli en trente ans par les personnels enseignant en collège. Aujourd’hui, en effet, 87 % à 90 % des élèves accèdent au tronc commun de formation générale. Il subsiste certes encore trop d’élèves en difficulté au collège (de l’ordre de 10 % à 13 %), mais n’oublions pas d’où nous venons. Les circulaires de rentrée sont lucides quant aux causes de ces difficultés. Par exemple, la question des temps et des rythmes d’apprentissage apparaît très tôt dans les motifs des difficultés. En 1980, les élèves en difficulté sont des élèves « qui éprouvent quelques difficultés à suivre le rythme. » Ce sont ensuite des élèves « qui ont besoin qu’on leur consacre du temps » (1988). La question sociale est également prise en compte dans les explications formulées par le ministère. On trouve une première mention en 1978 quand il est fait état « des élèves spécialement démunis ou défavorisés » et en 1987 quand sont évoqués « les élèves dont l’environnement éducatif ne réunit pas les conditions les plus favorables. » La même formule est utilisée, mot pour mot, en 1995. En 2001, on manie l’euphémisme en évoquant les élèves qui « ne bénéficient pas des conditions optimales de réussite scolaire. » En 1989 encore, on reconnaît que les difficultés scolaires concernent les élèves « issus de familles qui n’ont pas encore de tradition de l’enseignement secondaire. » La question sociale rejoint ici la question de l’identité du collège : en effet, de quel « enseignement secondaire » parle-t-on ? Est-ce celui qui prépare uniquement à l’enseignement général du lycée ? C’est sans doute ce qu’il faut comprendre quand, en 2002, on parle d’élèves en difficulté qui « n’envisagent pas a priori de poursuivre des études longues. » Chose étonnante, en 1998 les élèves en difficulté sont même interpellés voire chapitrés dans la circulaire de rentrée qui, pourtant, ne s’adresse pas à eux. On dit de ces élèves qu’ils « sont un souci pour l’équipe éducative » et qu’en conséquence ils « doivent comprendre que l’école est une chance pour eux et qu’elle fait tout pour lutter contre leur exclusion et pour reconnaître chaque élève dans sa dignité. » En 2003, on admet pourtant que « les modalités traditionnelles de soutien » n’ont pas permis une pleine efficacité du collège.
Il apparaît très vite aux autorités ministérielles qu’on ne parviendra pas à résoudre totalement les difficultés rencontrées par ces nouveaux élèves si on n’organise pas, au sein des établissements, des temps de travail personnel, sous la forme d’études surveillées ou dirigées. C’est, là encore, un sujet sur lequel les historiens se sont encore assez peu penchés. Le travail, le temps de travail, l’emploi du temps des élèves pour ce qui concerne les cours mais aussi les espaces inter-cours, le temps des exercices, des leçons, des lectures et des loisirs, mériteraient pourtant des études approfondies. L’histoire nous apprend d’ailleurs que les « études » occupaient une place très importante dans l’emploi du temps des élèves du secondaire au 19ème siècle, plus importante même que les heures de classe. Ces études étaient prises en charge par des répétiteurs ou des adjoints d’enseignement. Au 20ème siècle, on a assisté à la disparition progressive des répétiteurs et des adjoints d’enseignement dont les missions ont évolué vers l’enseignement. Cette évolution s’achève dans les années 1960, au moment même où accédaient dans les établissements de nouveaux élèves qui ne disposaient pas de l’appui familial pour effectuer ce travail de répétition des leçons, d’accompagnement des exercices et des devoirs, d’aide aux devoirs, etc. Autrement dit, c’est quand arrivent dans le secondaire des jeunes issus des classes moyennes ou populaires qu’on renvoie aux familles ce travail essentiel d’accompagnement du travail scolaire.[26] C’est en 1985 que, pour la première fois, un texte récent évoque cette question pour les lycées et les lycées professionnels. Le ministère se donne alors pour objectif « l’amélioration des conditions de travail personnel des élèves » en partant du constat que « ce qui manque le plus à beaucoup de lycéens de seconde, c’est la faculté de travail personnel »[27] Il n’est donc pas étonnant que la question des études se soit également posée avec force quand se met en place le collège unique. Cette mesure est introduite au collège en 1984. La circulaire de rentrée demande que les emplois du temps des élèves soient « conçus de telle façon qu’ils aient la possibilité d’avoir deux à trois heures par semaine d’étude surveillée par groupe de quinze à vingt élèves. » Il est précisé que les travaux que les élèves réaliseront pendant ce temps seront conçus « collectivement par les équipes éducatives. » Mais la circulaire de rentrée 1985 indique « qu’il appartient aux chefs d’établissement de dégager les moyens nécessaires sur leur dotation mais aussi de rechercher auprès des municipalités si des aides financières peuvent leur être apportées. » Constatons en passant que le ministère de l’éducation nationale n’a jamais eu besoin de faire appel aux collectivités territoriales pour financer les heures dites de « colle » dont bénéficient les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles : dans ce cas tout aussi indispensable, mais particulier il est vrai, d’accompagnement scolaire le ministère a toujours pu consacrer les efforts nécessaires. Au même moment, pour les lycées, on demande aux responsables locaux que « l’organisation d’études dirigées [soient] proposées aux communes, département et régions »[28] La circulaire de 1989 pour les collèges donne la raison pour laquelle il faut aider certains élèves : « c’est une mesure de justice sociale que de donner aux élèves, et notamment à ceux issus de familles qui n’ont pas encore de tradition de l’enseignement secondaire, l’aide méthodologique et le soutien indispensables. » On relèvera ici que, dix années après la mise en place du collège unique, les enfants du peuple sont considérés comme des élèves à part, n’ayant pas encore totalement gagné leur place dans un collège resté un petit lycée car leurs familles ne possèdent pas la « tradition de l’enseignement secondaire. » La circulaire de 1993 consacre à son tour un chapitre entier au travail personnel des élèves au collège en reconnaissant que « la réussite des élèves dépend en grande partie de leur capacité à organiser leur travail personnel et à en maîtriser les méthodes. » Le texte de 1993, qui définit les études dirigées « comme un élément clé de la pédagogie de la réussite » précise qu’elles permettent « d’apporter un soutien méthodologique et une stimulation psychologique aux élèves en difficulté scolaire » et demande que l’on accorde la priorité « aux élèves de sixième compte tenu de l’hétérogénéité de ces classes. » Mais, une nouvelle fois, l’organisation retenue condamne l’aide au travail personnel à l’aléatoire et à la précarité. La circulaire de 1993 suggère en effet, comme celle de 1985, que les responsables académiques s’adressent aux collectivités territoriales « en complément de l’effort du système éducatif » pour rechercher « des aides financières en vue de mobiliser tous les partenaires concernés par l’accompagnement scolaire. » La circulaire de 1994 qui consacre un chapitre à « l’aide méthodologique pour tous » car « le collège doit offrir une aide particulière aux élèves dépourvus de suivi et de soutien familial et, plus généralement, de cet accompagnement parascolaire qui constitue un important facteur d’égalisation des chances », confirme le caractère aléatoire des études qui seront « financées sur le contingent d’heures à taux spécifique ou de vacations dont dispose l’établissement. » La circulaire de rentrée 2001 préconise que les parents « soient associés à la démarche d’accompagnement du travail personnel tant il est vrai que du regard qu’ils portent sur l’école dépend beaucoup la réussite de leurs enfants. » Cela est bien sûr vrai, mais alors que le ministère n’a pas la possibilité de faire prendre en charge ce travail d’accompagnement par les enseignants, la responsabilité est renvoyée sur des parents qui ne sont pas les mieux armés pour une action qui demande tout de même de hautes compétences. On peut également lire que « lorsque les parents prennent en compte les contraintes scolaires, soutiennent les efforts dans l’apprentissage des leçons et la réalisation des devoirs écrits, ils transmettent aux enfants une culture du travail scolaire. » Certes, mais quand des parents ne peuvent pas faire tout cela ? La même circulaire formule une suggestion : que des « partenariats soient noués avec des associations dans le cadre des contrats éducatifs locaux » et signale que dans de nombreuses municipalités « un suivi scolaire peut être assuré par des parents ou des éducateurs, en collaboration étroite avec les équipes éducatives. » Autrement dit, dans le cas précis de l’accompagnement du travail personnel des élèves en difficulté, il appartient aux partenaires de l’école de prendre des initiatives et aux équipes éducatives de collaborer. Et si on renversait la proposition ?
3. La place de l’élève dans les politiques pédagogiques et éducatives
La difficile articulation des disciplines entre elles dans la construction des apprentissages : la place de l’élève n’est-elle que devant les disciplines ?
La place de l’élève dans la relation pédagogique qui s’établit avec le professeur est bien sûr au cœur de la problématique que je tente de développer devant vous ce matin. C’est en effet « la relation aux élèves, bien avant les relations aux collègues et à l’institution, qui atteste aux yeux du professeur lui-même sa valeur professionnelle. »[29] C’est tellement vrai que les professeurs savent bien que les élèves sont les principaux évaluateurs de leur travail d’enseignant et qu’ils tiennent à ce titre une place centrale dans leur métier. D’ailleurs, quand ils sont questionnés pour savoir à qui ils estiment devoir rendre des comptes, 30 % des enseignants (premier et second degré) désignent leurs élèves et 25 % les familles, contre seulement 15 % qui désignent l’institution, 10 % la société et 3 % leurs collègues.[30] Le problème, c’est que cette relation quasi exclusive avec les élèves peut entraîner aussi bien de l’enthousiasme, quand les élèves correspondent à l’idéal disciplinaire du professeur, que du découragement, quand il y a un trop grand décalage entre le niveau des élèves, leur attitude et les attentes du professeur. L’autre problème, c’est l’isolement professionnel de l’enseignant créé par le cloisonnement disciplinaire et bien sûr le morcellement que cela entraîne dans la construction des apprentissages de l’élève. Dans leur rapport sur l’emploi du temps des élèves au lycée, Dominique Borne et François Perret ont pu écrire que ce modèle, qui «associe un professeur, un enseignement, une classe, une heure, plonge ses racines dans un passé très ancien [et] n’a pas été sérieusement remis en cause malgré les critiques dont elle a pu faire l’objet, notamment dans les années 1980-1990, certains allant jusqu’à lui reprocher d’être le principal obstacle aux évolutions nécessaires de l’école. »[31] Cette façon d’aborder le travail dans l’établissement est déterminante car elle focalise le temps scolaire sur le temps de l’enseignant et non sur celui de l’élève. Nous connaissons le temps des enseignants, nous savons peu de choses sur le temps des élèves. Les documents officiels donnent d’ailleurs toutes les informations souhaitables sur l’emploi du temps des enseignants, sur celui de la classe, mais « l’emploi du temps des élèves est un objet introuvable, non répertorié. »[32] L’élève, dans son individualité, « dans sa réalité quotidienne, dans son emploi du temps personnel, est introuvable. »[33] Qui connaît, dans un établissement, l’emploi du temps de l’élève le plus chargé et celui de l’élève le moins chargé ? Qui sait que dans un lycée d’enseignement général la différence entre les deux représente l’équivalent d’une journée sur une semaine ? Dans les résultats de la consultation nationale sur les lycées qu’il a conduite à la demande du ministre Savary, l’historien Antoine Prost constatait déjà en 1982 que le nombre d’heures de cours des élèves des lycées est « trop lourd pour permettre de développer leur réflexion personnelle […], de leur assurer une vie équilibrée. » A. Prost proposait de réduire les horaires et d’utiliser les moyens dégagés pour lutter contre l’échec scolaire.[34] Dans son dernier ouvrage, Hervé Hamon[35] conseille à tous ceux qui s’intéresse aux élèves de suivre une classe pendant plusieurs jours, de cours en cours, pour prendre conscience du rythme parfois effrayant que nous faisons subir aux élèves. C’est quelque chose en effet que nous devrions tous faire, inspecteurs, chefs d’établissement et professeurs dont beaucoup ne connaissent pas toujours le nombre total d’heures de cours des élèves de leurs classes dans une journée ou dans une semaine. Parfois, même les élèves éprouvent des difficultés à évaluer leur nombre d’heures de cours hebdomadaire. Il faut dire que, dans certaines classes, il peut arriver que tous les élèves aient des emplois du temps différents. Et enfin, dans quel lycée aujourd’hui consulte-t-on le conseil des délégués pour la vie lycéenne au moment de l’élaboration de l’emploi du temps dans l’établissement et pour recueillir un avis quant à l’organisation de l’heure de vie scolaire comme c’était prévu dans une instruction de 1999 ? D. Borne et F. Perret constatent néanmoins que le système a connu de évolutions ces dernières années. Signalons celle qui a vu l’élève être de moins en moins présent dans sa classe de base et de plus en plus dans des groupes divers de dédoublement, d’options ou autres, organisés parfois en « heures de quinzaine ». Ainsi, la place de l’élève de lycée aujourd’hui se situe pour un tiers du temps scolaire en dehors de sa classe, ce qui complique certes le travail de réalisation des emplois du temps, mais qui doit permettre, si l’on en croit la circulaire de 1999, de « favoriser la réussite de chacun » et de « répondre plus précisément aux attentes des élèves grâce à des approches pédagogiques variées. »[36] Dans notre histoire récente, de nombreux efforts ont été produits pour rompre l’isolement de l’enseignant et mieux articuler les disciplines entre elles. Je veux parler des essais de décloisonnements disciplinaires. On peut rappeler[37] l’étude du milieu introduite dans les « classes nouvelles » à la Libération, les dix pour cent institués en collège en 1973 qui permettent des activités scolaires différentes, les PAE créés en 1982 pour penser autrement le travail scolaire et tendre au décloisonnement des disciplines, la pédagogie du contrat prônée dès 1984 autour du travail autonome, les Thèmes transversaux des programmes de collège de 1985. Dans le rapport annexé à la loi d’orientation de 1989, il est dit que « l’utilisation du temps scolaire est mal adaptée aux objectifs actuels de la formation parce que les journées de classe sont trop lourdes, les temps morts sont nombreux et la rigidité et l’uniformité dans la gestion pédagogique du temps sont trop grandes. » Sont arrivés ensuite dans le paysage éducatif les parcours diversifiés en 1996, les travaux croisés en 1998, les itinéraires de découverte maintenant. Ces dispositifs ont connu des fortunes diverses, souvent éphémères. Dès 1995, par exemple, on constate que les modules ont connu « un certaine rigidité [qui] semble les détourner de leur finalité initiale de réponse aux attentes et aux besoins des élèves »[38] Aujourd’hui, par exemple, les IDD sont devenus facultatifs pour certains élèves. Dans les lycées, ce sont les modules introduits en classe de seconde en 1992 et conçus comme « une réponse à la diversité des besoins des élèves »[39]et l’aide individualisée en 1999 qui devaient permettre de donner un peu d’autonomie et de nouvelles compétences aux élèves mais qui ont été presque totalement dénaturés. Ce qui fait dire à certains chefs d’établissement que « Le lycée a su s’adapter aux nouveaux élèves, mais pas les enseignants ni les enseignements. »[40]Et puis, ont été mis en place avec davantage de succès l’heure de vie de classe, puis les TPE, les PPCP et l’ECJS. Ces dispositifs ne modifient pas l’organisation traditionnelle du lycée car ils viennent davantage s’ajouter et se superposer aux temps d’enseignement qu’ils ne les font évoluer.[41] On peut même dire qu’à cause de cela, ces nouveaux dispositifs ont plutôt aggravé la complexité existante, notamment des emplois du temps, ce qui n’a pas contribué à les rendre populaires. Il s’agit pourtant d’une tentative tout à fait intéressante et féconde pour mettre la construction de la citoyenneté au cœur de la construction des savoirs en apprenant aux élèves à travailler collectivement autour d’un projet, à apprendre à débattre et à argumenter, à apprendre à faire la distinction entre ce qui est de l’ordre des opinions qui normalement s’affrontent en démocratie et ce qui relève des valeurs de la République qui échappent par définition au champ de la négociation. Ce qui ne manque pas de frapper l’observateur attentif c’est que les TPE ou l’ECJS sont arrivés dans le paysage éducatif très largement à la demande des élèves eux-mêmes qui se sont beaucoup impliqués dans la consultation conduite à la demande du ministre par Philippe Meirieu sur les savoirs au lycée de décembre 1997 à mai 1998. la note de service du 20 mai 1999 qui institue l’ECJS le dit d’ailleurs explicitement : « l’enseignement d’éducation civique, juridique et sociale répond à une forte demande des lycéens »[42]. La note de service ne le dit évidemment pas, mais on sait que la demande ne venait pas de la majorité des enseignants, c’est le moins que l’on puisse dire. Si les enseignants se sont finalement rendus compte de l’intérêt des TPE, l’ECJS peine encore beaucoup à faire sa place. Comme on le sait il ne s’agit pas d’un enseignement et encore moins d’une discipline. Il s’agit d’une éducation civique au sens fort du terme qui concerne en principe toutes les disciplines et qui doit être conduite au moyen de débats. Cinq ans plus tard, force est de constater que seuls les enseignants d’histoire-géographie se sentent un peu concernés et encore, pour certains d’entre eux, parce qu’ils y voient le moyen horaire de boucler leur programme ! Par ailleurs, le temps d’ECJS n’est pratiquement jamais l’occasion d’un travail effectué par plusieurs enseignants ensemble. On pourrait dire la même chose des heures de vie de classe, quand elles sont inscrites dans l’emploi du temps bien sûr ! La place de l’élève ne serait-elle légitime que devant les disciplines ? Le lycéen de 1998 était pourtant réaliste. Il demandait à la fois de « vrais adultes » et des pratiques nouvelles dans l’établissement scolaire. Le lycéen de 1998 ne confondait pas l’élève et le maître, mais il voulait que l’école le prépare mieux à l’exercice de la citoyenneté. Ce constat est confirmé par une enquête d’opinion réalisée auprès des jeunes de 15 à 24 ans en 1999. Quand on leur demande ce que seraient les changements souhaitables dans la société, les jeunes placent en tête l’épanouissement de l’individu et en troisième position le respect de l’autorité.[43]
Quelle place à l’éducation citoyenne de l’élève ?
On peut rappeler que c’est en 1998, que le ministère décide de transformer les comités d’environnement social en comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté[44] et de créer les « initiatives citoyennes » dans les établissements du second degré. C’est aussi à ce moment que le ministère met en place de nouvelles instances de participation des élèves à la vie de leur établissement et du système éducatif : les CVL (1998), CAVL (1991), CNVL(1995) et des moyens facilitant l’exercice de ces libertés, comme le fonds de soutien à la vie lycéenne ou la Maison des lycéens. Il ne faut évidemment pas commettre de contresens sur la signification de cette évolution. L’élève n’est pas un citoyen au sens strict du terme et nos établissements scolaires ne sont pas des démocraties, tout en ayant pour mission de préparer les élèves à prendre toute leur place dans le fonctionnement de notre démocratie. Et cela ne peut se faire que si l’on donne à l’élève un rôle social à l’intérieur de l’établissement. Autrement dit, ce n’est pas seulement à l’élève qu’il faut faire une place dans l’établissement mais également au citoyen en devenir qu’il est aussi. Cinquante ans avant le rapport tout à fait remarquable du recteur Blanchet sur la vie des élèves et des établissements qui préconisait de faire de l’établissement scolaire un espace de démocratie vivante, le Plan Langevin-Wallon[45] disait déjà en 1946 qu’il revient à l’école de faire à l’enfant « l’apprentissage de la vie sociale et, singulièrement, de la vie démocratique. » Dans cet esprit, le fonctionnement de l’établissement est conçu de manière à permettre aux élèves de former un « groupe scolaire à structure démocratique auquel l’enfant participe comme futur citoyen et où peuvent se former en lui, non par les cours et les discours, mais par la vie et l’expérience, les vertus civiques fondamentales : le sens des responsabilités, discipline consentie, sacrifice à l’intérêt général, activités concertées et où on utilisera les diverses expériences de « self-government » dans la vie scolaire. » Tous les mots sont ici pesés. Par exemple, le rapport ne dit pas que l’école est une démocratie et les élèves, futurs citoyens, ne sont pas confondus avec le peuple. Mais l’école doit avoir une organisation, « une structure » à caractère démocratique qui permette un apprentissage effectif de « la vie démocratique. » Dans ces lignes apparaît bien la visée démocratique du projet de réforme de l’enseignement à la Libération. Les élèves peuvent également exercer leur sens des responsabilités en s’impliquant dans les associations de l’établissement. Ainsi, pour les rédacteurs du Plan, la participation à l’organisation des coopératives scolaires (c’est « par les élèves eux-mêmes que la coopérative doit être gérée ») peut donner « aux adolescents l’expérience des responsabilités et le sentiment de l’importance des fonctions sociales. » De même, anticipant ainsi sur nos récentes incitations à l’engagement des élèves dans des actions humanitaires, le Plan Langevin-Wallon encourage la participation des élèves à « des services sociaux », ces « activités désintéressées » étant un moyen « d’enseigner aux jeunes à sortir d’eux-mêmes. » Si je cite longuement ce texte, c’est qu’à plus de cinquante ans de distance, il peut encore aider à lever les ambiguïtés ou les malentendus que l’on peut observer ici ou là dans le fonctionnement des instances qui permettent l’expression et la participation des élèves à la vie des établissements. Ainsi, le Conseil de la vie lycéenne est bien un outil d’apprentissage du fonctionnement d’une instance représentative et du rôle des élus dans une démocratie, mais ce n’est pas une instance à proprement parler démocratique : son président de droit est le chef d’établissement, et les adultes qui participent à ses réunions n’ont pas voix délibérative. Les élèves comprennent parfaitement cette distinction pour peu que les adultes prennent le temps de l’expliquer. Par ailleurs, les dispositifs destinés à favoriser un travail sur la citoyenneté (heure de vie de classe, ECJS) rencontrent un accueil plutôt favorable de la part des élèves dans les établissements scolaires, même si, comme le constate la circulaire de rentré 2003, le « lien entre l’enseignement civique et la vie des établissements n’est pas suffisamment établi. » Mais ce qui doit tous nous interroger, c’est qu’on constate, dans le même temps, que l’accumulation des instances représentatives ne favorise pas vraiment l’implication des élèves qui, en réalité, ne semblent pas avoir beaucoup d’intérêt pour le « self-government. » dont parlait le plan Langevin-wallon. Il faut aussi remarquer que, si les nouveaux droits accordés aux lycéens font l’objet de textes spécifiques, ces droits ne sont pratiquement jamais évoqués dans les circulaires générales de préparation de la rentrée dans les lycées de 1992 à 1999. Comme si on ne parvenait pas, victimes que nous sommes d’une sorte de strabisme éducatif divergent, à réduire la coupure entre les consignes d’ordre pédagogique données dans les circulaires de rentrée et les consignes concernant la vie scolaire. Il faut attendre la circulaire de rentrée 1999 signée de Bernard Toulemonde, pour que la DESCO dise dans un texte de portée générale que « les établissements sont non seulement des lieux d’acquisition de savoirs mais également des lieux d’apprentissage de la citoyenneté. Les nouvelles instances de la vie lycéenne mises en place dans tous les établissements, favorisant des pratiques plus responsables fondées sur les droits et les devoirs des lycéens. »[46] On doit à la vérité de dire que, de leur côté, la plupart des adultes ne s’impliquent pas beaucoup dans ces dispositifs, refusant ainsi, de fait, d’aider leurs élèves à exercer des responsabilités. Sauf exception, les adultes des établissements scolaires prêtent encore trop peu d’attention au point de vue des élèves, « à leur manière de percevoir et d’analyser l’éducation qui leur est proposée et la place qui leur est attribuée dans les institutions éducatives. »[47] Dans beaucoup d’établissements, on déplore un défaut de participation, voire une apathie de l’ensemble des élèves et, encore une fois, des adultes eux-mêmes. La participation à la vie de l’établissement risque ainsi de devenir la spécialité de quelques uns, alors que l’objectif est la diffusion d’une culture citoyenne chez tous les élèves. Le Plan Langevin-wallon abordait ce sujet sous un angle original, en exprimant le souci de développer ce qu’il appelle les deux aspects qui répondent à la hiérarchie des fonctions dans la vie en société en régime démocratique : responsabilité du dirigeant, responsabilité de l’exécutant. Ainsi, l’école doit-elle organiser les activités scolaires de « telle sorte que tous [les élèves] aient alternativement des responsabilités de direction et d’exécution développent conjointement l’initiative, la décision, l’intégration volontaire à une activité réglée et collective, la conscience scrupuleuse dans l’accomplissement des plus modestes tâches. Il importe en effet d’éviter de cultiver en certains l’absolutisme du chef prédestiné et en d’autres l’habitude paresseuse d’une aveugle soumission. » Nous avons, à dire vrai, encore beaucoup de progrès à faire pour mieux prendre en compte cet aspect essentiel de l’activité des élèves dans les établissements. Comment reconnaître et évaluer l’engagement de l’élève dans la vie de l’établissement et de la Cité ? Les CPE sont certes associés, depuis le décret du 11 octobre 1989, au suivi et à l’évaluation des élèves et participent au conseil de classe, mais l’intérêt porté par un élève à l’action collective et au bien commun ne fait pas encore assez l’objet d’une reconnaissance objective. Il s’agit là d’un vaste et vrai chantier à peine exploré. Un chantier essentiel, ne nous y trompons pas, car il faudra bien un jour sortir de cette situation qui conduit encore trop souvent les élèves, comme les adultes d’ailleurs, « à vivre à côté des autres plus qu’avec les autres »[48]. Mais n’est-ce pas la manifestation de la contradiction soulignée par R. Ballion entre « la nécessité de vivre ensemble et le fait que, dans notre société, chacun revendique son autonomie au nom d’une liberté qui ne se reconnaît d’assises qu’individuelles »[49].
La place de la revendication identitaire de l’élève dans l’établissement scolaire[50]
Pendant une longue période, en gros les trente glorieuses, notre société a considéré qu’elle n’avait plus besoin de mettre l’accent sur l’objectif d’intégration nationale confié à l’école et à juste titre par la Troisième République : cet objectif semble alors atteint. La République et la démocratie font partie des valeurs communes. C’est à ce moment que René Haby supprime l’éducation civique à l’école en 1975. On passe à une autre priorité, l’insertion économique et la mission qui est confiée à l’école est d’aider à former des individus participant à la production et à la consommation de richesses. Mais la crise économique qui dure, la montée du chômage et de l’exclusion, la constitution de ghettos, les difficultés d’intégration des populations nouvellement arrivées, la montée de la violence dans la société et dans les établissements scolaires (souvenons-nous que le mouvement lycéen de 1990 vient des lycéens de banlieue qui refusent cette violence dans des établissements surchargés par la vague démographique) changent radicalement la donne. On le voit bien à la lecture de la loi d’orientation de 1989 qui attend de l’école qu’elle « développe la capacité de l’individu à vivre en société, ce qui inclut l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la démocratie. » Aujourd’hui, certains élèves contestent le caractère universel et donc la vérité de ces valeurs, d’autres, et ce sont parfois les mêmes, affirment une identité individuelle ou collective de nature religieuse au sein des établissements. On peut alors comprendre pourquoi l’article 2 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école juge nécessaire de préciser ou de rappeler que « outre la transmission de connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire pratiquer aux élèves les valeurs de la République. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. » Comment peut-on réagir face à ces phénomènes ? Disons d’abor que la mise en cause, dans un petit nombre d’établissements, au nom de principes religieux, des valeurs républicaines et de ce qui se fait à l’école est une réalité, l’inspection générale l’a montré récemment dans un rapport[51]. Les contestations de l’enseignement ou les actions de prosélytisme sont des atteintes au principe de laïcité qui doivent être prises au sérieux et combattues comme il se doit, même si, heureusement, elles sont loin d’être généralisées[52]. Cela dit, la position de repli ou d’opposition de certains de nos élèves vis à vis de nos valeurs ne relèvent pas toujours d’une manipulation. Cette attitude repose parfois sur un échec scolaire sévère, sur une mémoire blessée ou sur un sentiment d’exclusion. Il ne s’agit évidemment pas d’une excuse mais de comprendre pourquoi, à certains moments, les valeurs que nous promouvons n’ont pas beaucoup de légitimité a priori et que, d’une certaine façon, nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité peuvent apparaître aux yeux de certains élèves comme un catéchisme parmi d’autres, ou une incantation qui relève plus d’un particulier propre aux dominants que de l’universel. Par ailleurs, avons-nous suffisamment conscience que certains de nos élèves subissent un communautarisme de fait en vivant dans des ghettos désertés par ceux qui ont la possibilité d’aller vivre ailleurs[53] ? Dans ce cas le communautarisme n’est évidemment pas choisi mais il est le résultat d’une ségrégation. Il s’agit ici d’un enfermement et d’un appauvrissement subis[54] car, généralement, comme le disait Michelet, « ce n’est pas volontairement que l’esprit se resserre. »[55] On ne laisse jamais impunément une population, et donc des élèves, s’enfoncer dans l’échec ou dans un sentiment d’exclusion. Pour rester un instant encore avec Michelet, rappelons aussi l’avertissement qu’il donnait à ses étudiants en 1848, avertissement toujours valable : « nulle fraternité hors du droit, nul amour dans l’iniquité, nulle alliance hors du cercle que doit tracer la justice. »[56] Et avons-nous suffisamment entendu la mise en garde de Jaurès : « La République française doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu’elle aura su être sociale » ? Le pire évidemment serait d’utiliser la question laïque pour éviter de poser la question sociale. Rappelons ensuite qu’une affirmation identitaire, individuelle ou collective, n’est pas en soi illégitime et ne conduit pas obligatoirement au communautarisme. Quand on regarde ce qui se passe dans les établissements scolaires on voit des exemples d’itinéraires identitaires,[57] comme la revendication identitaire par le « look », revendication qui nous choque parfois sans pour autant faire trembler la République sur ses fondements. Ce que je veux dire c’est que l’affirmation identitaire n’est pas forcément à chaque fois une source de désordre. Quand des élèves d’un même village ou d’un même club sportif se rassemblent dans la cour de récréation, personne ne trouve à y redire. Quand des élèves d’origine portugaise font de même, on pense généralement que c’est pour une raison folklorique. Et bien, quand des élèves dont les familles sont originaires d’Afrique du nord se regroupent, il ne s’agit pas forcément à chaque fois de communautarisme. Ou alors, il faudrait aussi s’interroger sur une forme de « communautarisme » propre à quelques unes de nos classes préparatoires aux grandes écoles. Certains de nos élèves de confession musulmane sont davantage visibles aujourd’hui qu’il y a vingt ans ? Cela peut en effet poser un problème mais n’oublions pas que la revendication identitaire est aussi un apprentissage de la liberté. Et puis, ce n’est pas pour autant qu’il faudrait regretter l’époque « où les musulmans ne faisaient pas de bruit, restaient discrets, se contentaient, finalement d’être des travailleurs immigrés. »[58] La question me semble-t-il n’est donc pas de savoir s’il faut refuser l’affirmation identitaire de nos élèves, mais de savoir comment faire pour concilier cette affirmation identitaire et l’unité de la République. Autrement dit, comment trouver des « accommodements raisonnables »[59] et poser des limites dans le respect du principe de laïcité ? Comment passer des « petites patries » identitaires à la « grande patrie » nationale ? Il me semble que c’est d’abord en faisant comprendre qu’en République une liberté, y compris celle d’affirmer son identité particulière ou collective, n’est jamais absolue et qu’elle est toujours encadrée par la loi. La loi de mars 2004 sur les signes religieux ostensibles est un exemple de cadre donné à la liberté d’expression des élèves. Deuxièmement, l’affirmation identitaire ne doit pas se construire de façon conflictuelle, « sur le rejet de ce qui est commun à tous les français et qui constitue l’identité nationale et républicaine de la France. » [60] Autrement dit, les acteurs de la vie scolaire au sein de l’établissement doivent veiller à ce que la revendication identitaire ne s’oppose jamais à l’acceptation de règles de vie et de valeurs communes, comme la stricte égalité entre les élèves et la liberté de tous. Dans cet esprit, faire en sorte que les repas du restaurant scolaire prennent en compte les différentes appartenances est évidemment possible ; ne plus servir du tout de porc à la table commune est une atteinte majeure et inadmissible à nos valeurs d’égalité et de liberté. Et nous touchons ici à une troisième limite, fondamentale, à l’acceptation de l’expression d’une identité d’appartenance, c’est que cette expression n’empêche pas ceux qui le souhaiteraient de quitter cette appartenance. Autrement dit, l’école doit absolument refuser toutes les pressions que certains groupes d’élèves ou d’adultes chercheraient à exercer sur d’autres élèves ou adultes au nom d’une obligation d’appartenance à une identité particulière. Je pense notamment aux pressions inadmissibles qui s’exercent parfois dans certains établissements pour l’observance de rites religieux, aux pressions à l’encontre des jeunes filles ou aux contestations de la mixité filles-garçons. En vérité, le sentiment d’appartenance à la République française et l’adhésion à ses valeurs est une construction et il revient à tous les acteurs de la vie scolaire de donner les clés pour permettre un enracinement de l’idée républicaine et une émancipation de tous. Ces clés sont plus à rechercher du côté d’un accueil raisonné et encadré des différences que du côté d’un arrachement brutal aux particularités portées par tels ou tels de nos élèves. Claude Nicolet l’a dit magistralement en 2003, lors du regroupement national des correspondants académiques chargés de la « prévention des dérives communautaires » organisé par la DESCO[61] : être Français, nous savons ce que cela veut dire depuis le 14 juillet 1790, fête de la Fédération, mais nous l’avons oublié. Etre Français n’a pas pour fondement le droit du sang, car « cela renvoie à l’idée de race et de filiation » et « ce n’est pas recevable en termes républicains ». Etre Français, n’a pas davantage pour fondement le droit du sol car cela « renvoie à la féodalité : celui qui naît à tel endroit appartient à celui qui règne à tel endroit. » Ce qui fait « la nationalité-citoyenneté, c’est le consentement, le fait d’accepter de faire partie de la Nation ». Cette adhésion aux valeurs communes ne veut pas dire que l’on oublie qu’on est aussi d’origine picarde ou d’origine maghrébine, mais cela veut dire qu’on accepte les valeurs communes de la Nation. Et, comme on ne peut pas adhérer à des valeurs sans les connaître, on voit immédiatement le rôle fondamental de l’école.
Au total, et pour conclure, à quelles conditions la place faite à l’élève dans l’établissement scolaire sera-elle la plus satisfaisant possible ? La première de ces conditions est que l’établissement soit accueillant. Je veux dire par là que l’établissement doit attendre l’élève qui arrive et lui faire comprendre qu’il est attendu et qu’il a, comme ses parents, une place dans l’établissement qu’il soit pauvre, riche ou handicapé. Personne ne doit se sentir étranger dans un établissement de la République. Sanctuaire ou pas, l’établissement n’est pas d’abord un mur sacralisé à franchir plus ou moins difficilement, c’est d’abord un accueil éducatif. L’établissement doit aussi être juste. Les élèves ont un sens aigu de l’injustice. Et, pour eux, l’injustice commence avec une note mal comprise, une orientation non désirée, une sanction ou une exclusion incompréhensible, une punition collective. Mais un établissement juste n’est pas un établissement laxiste. Les élèves ne s’y trompent pas qui sont souvent les plus sévères en conseil de discipline pour sanctionner les dérapages de certains d’entre eux. L’établissement doit enfin être respectueux. Même si le mot respect est aujourd’hui un peu galvaudé, soyons persuadés qu’un établissement scolaire dont tous les membres, adultes et élèves, sont réciproquement respectueux, c'est-à-dire attentifs aux autres, aux personnes et à leurs droits, attentifs aux règles communes, est un établissement plus à l’abri qu’un autre du désordre et de l’injustice. Un établissement respectueux est aussi un établissement ambitieux pour tous ses élèves. Tous les élèves peuvent réussir et donc tous ont leur place dans l’établissement.
Jean-Paul DELAHAYE mai 2005
[1] François Dubet, Les lycéens, Les dossiers éducation et formation, ministère de l’éducation nationale, mai 1991. [2] Y. Buttner, A.Maurin, B. Thouveny, Le droit de la vie scolaire, Dalloz, 2003, p. 101. [3] Ibid. p. 103. [4] Ibid. p. 104. [5] Le Figaro, cité par François Dubet, op. cité, p. 214. [6] Libération, 24 et 25 novembre 1990, cité par François Dubet, op. cité, p. 217. [7] François Dubet, op. cité, p.217. [8] François Dubet préfère parler, à juste titre d’explosion scolaire et de non de « mouvement lycéen ». [9] Lettre ministérielle du 7-12-1989 de préparation de la rentrée 1990, B.O. du 21-12-1989. [10] Lettre ministérielle du 20-12-1990 de préparation de la rentrée 1991. [11] Je reprends l’expression utilisée par Pierre Caspard lors de lors de la conclusion du colloque « Lycées et lycéens en France 1802-2002 » qui s’est tenu à la Sorbonne du 9 au 12 juillet 2002. [12] Colloque op. cité. [13] Ibid. [14] Ibid. [15] Note de service 82-022 du 13 janvier 1982, B.O. du 21-01-1982. [16] Circulaire 88-354 du 21-12-1988, B.O. du 5-01-1989. [17] C’est la note de service 85-275 du 20-12-1985, B.O. du 16-01-1986, qui évoque pour la première fois le baccalauréat professionnel. [18] Circulaire 84-001 du 3-01-1984, B.O. du 12-01-1984. [19] J-P Obin, op. Cité, p. 22. [20] L. Joxe, La fonction enseignante dans le second degré, Rapport au ministre de l’éducation nationale, 1972. Cité par Jean-Pierre Obin, Enseigner, un métier pour demain, Rapport au ministre de l’éducation nationale, 2002. [21] J-P Obin, op. cité, p. 6. [22] Voir Jean-Paul Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire, Actes de l’université d’automne d’octobre 2002, ministère de l’éducation nationale, direction de l’enseignement scolaire. [23] En particulier Denis Meuret chercheur à l’IREDU de l’Université de Bourgogne. [24] Circulaire 77-011 du 5 janvier 1977, B.O. du 27-01-1977. Cette circulaire précise que les instituteurs de C.M.2 conservent la possibilité de proposer un redoublement et demande que les commissions d’admission pour l’entrée en 6ème n’examinent que les « dossiers des élèves de C.M.2 pour lesquels le maître considère que le passage au collège peut poser des problèmes particuliers, soit qu’il estime qu’un redoublement serait utile, soit qu’il pense que les difficultés rencontrées par l’élève doivent entraîner pour lui la mise en œuvre du soutien dès le début de la scolarité au collège. » [25] Circulaire 77-011 du 5 janvier 1977, B.O. du 27-01-1977. [26] Voir à ce sujet, la contribution de Philippe Savoye pour la partie historique du rapport de Jean-Pierre Obin, op. cité. [27] Note de service 85-475 du 20-12-1985, B.O. du 16-01_1986. [28] Circulaire de préparation de la rentrée 1985, op. citée. [29] J-P Obin, op. Cité, p. 29. [30] W. Hutmacher, A qui rendre compte du travail enseignant ?, Revue Educateur, n° 9, 1996. Cité par J-P Obin, op. cité, p. 30. [31] D. Borne, F. Perret, L’emploi du temps des élèves au lycée, Rapport au ministre de l’éducation nationale, novembre 2001, p. 5. [32] Ibid., p. 3. [33] Ibid., p. 29. [34] Note de service 82-604 du 23-12-1982 pour la préparation de la rentrée 1983 dans les lycées, B.O. du 13-01-1983. [35] Hervé Hamon, Tant qu’il y aura des élèves, Le Seuil, 2004. [36] Circulaire 99-073 du 20-05-1999. [37] Voir l’ouvrage de Florence Castincaud et Jean-Michel Zakhartchouk, Croisements de disciplines au collège, CRAP et CRDP d’Amiens, 2002. [38] Circulaire 95-099 du 27-08-1995. [39] Note de service 92-164 du 25 mai 1992, B.O. du 4 juin 1992. [40] D. Borne, F. Perret, op. cité, p. 19. [41] D. Borne, F. Perret, op. cité, p. 7. [42] Note de service n° 00-073 du 20 mai 1999. [43] J-P Obin, op. Cité, p. 34. [44] Voir l’analyse qu’en fait Robert Ballion dans Les conduites déviantes des lycéens et l’éducation à la citoyenneté, dans la revue Ville-Ecole-Intégration, n° 118, septembre 1999. [45] Le Rapport Langevin-Wallon, présenté par Claude Allègre, François Dubet, Philippe Meirieu, Paris, Editions Mille et une nuits chez Arthème Fayard, 2004. [46] Circulaire de rentrée op. citée. [47] Résumé de l’intervention de Cléopâtre Montandon, lors du colloque « L’élève-roi, autour de la place de l’élève dans le système éducatif en France et en Suisse » à Paris, 14 février 2002. [48] . Jean-François Vincent, président de l’Office central de la coopération à l’école, site internet de l’OCCE. [49] R. Ballion, op. cité, p. 145. [50] Ce passage reprend l’intervention de Jean-Paul DELAHAYE lors du colloque Laïcité et vérité organisé par l’ESEN et l’Inspection générale, 22 et 23 mars 2005. [51] Inspection générale de l’éducation nationale, Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, rapporteur Jean-Pierre Obin, juillet 2004. [52] Ce passage reprend l’intervention de Jean-Paul Delahaye au colloque Laïcité et vérité organisé par l’inspection générale de l’éducation nationale et l’Esen, 22 et 23 mars 2005, Paris, Palais de la Découverte. [53] Voir à ce sujet, Eric Maurin, Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, Seuil la République des idées, 2004. [54] Voir ce qui est dit dans le rapport de la commission Stasi à propos du « communautarisme plus subi que voulu.» Laïcité et République, La documentation Française, 2004, p. 99. [55] Jules Michelet, 2ème leçon, 23 décembre 1847, dans L’Etudiant, Paris, Seuil, 1970, p. 67. [56] Jules Michelet, 8ème leçon, 3 février 1848, dans L’Etudiant, Paris, Seuil, 1970, p. 137. [57] Bien mis en relief par Jean Baubérot dans son dernier ouvrage Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Paris, Seuil, 2005, à partir de la page 159. [58] Ibid, p. 178. [59] Expression d’origine québécoise, reprise dans le rapport de la commission Stasi. [60] Projet de rapport annexé à la loi d’orientation [61] Intervention résumée sur le site eduscol/conf-nicolet.htm |