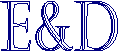

Nouveau site : http://www.educationetdevenir.fr/
\n
Ce compte rendu d'atelier, inédit, rend compte d'une réflexion qui a, en quelque sorte, anticipé les textes sur le Règlement intérieur et les sanctions disciplinaires parus en 2000.
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/default.htm
Règlement Intérieur
Loi pour tous ?
Personnes- ressources : Jean-Marie CATUSSE
Directeur Départemental de la Protection judiciaire
de la Jeunesse de 1'Aveyron
Gérard MAMOU proviseur, Rédacteur en chef de la
Revue du Droit Scolaire, Proviseur
Animatrice : Françoise GALLET, Académie de Nantes
Rapporteur : Josette LE RAY, Académie de Nantes
Rédacteur : Jean-François LAUNAY, Académie de Nantes
Une journée préparatoire au colloque, dans l’académie de Nantes, animée par Jean-Pierre Obin, sert d’introduction à cet atelier sur le Règlement Intérieur. J.-P. Obin avait pu Iister les confusions, apparues dans cette journée, dans les ateliers, entre droit et morale, sanction et punition, non respect de la loi et conflit, conseil de discipline et punition, punition et réparation, ordre juridique et contrat éducatif (confusion fréquente dans la définition même du règlement intérieur), individu-fonctionnaire-citoyen...
Le règlement intérieur est-il le miroir de la loi ? La respecte-t-il d’ailleurs ? Peut-il servir de régulation ? Qu’en est-il de sa lisibilité, de son évolution ?
Questions proposées au débat, que G. Mamou, proviseur et rédacteur en chef de la Revue du Droit Scolaire, est chargé de lancer.
Pourquoi ce thème du règlement intérieur prend-il de plus en plus d’importance ?
Il y a d’abord des raisons institutionnelles : des instructions de 1989 et 90 ont demandé‚ de moderniser les règlements intérieurs et, en particulier, d’en ôter les caractères illégaux et obsolètes ; elles préconisaient aussi d’introduire les modalités de mise en applications des droits et obligations des élèves ; le processus même de cette révision était clairement détaillé.
Une deuxième cause est la montée du contentieux relatif à la scolarité‚ des élèves et au règlement intérieur. Ce n’est pas un hasard si l’ex-DAGIC (Direction des Affaires Générales, Internationales et de Coopération) est devenue la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) et si la Lettre d’information Juridique du ministère est proposée à tous les EPLE.
La troisième raison est l’intervention visible du juge dans le domaine scolaire, juge qui rappelle fortement que la liberté publique est la règle, la restriction de police l’exception. Des arrêts du Conseil d’Etat (C.E.) illustre cet adage, ainsi de l’avis de 1989 dans l’affaire dite des foulards islamiques où le C.E. affirme qu’il n’y a pas de signes ostentatoires en soi et que les restrictions doivent se fonder sur les refus de la propagande et du prosélytisme ou bien sur des gênes avérées au fonctionnement normal de la mission d’enseignement. Deux autres arrêts du C.E. sur le problème de l’obligation du samedi matin s’inscrivent dans cette même optique : dans l’un, le C.E. renvoie finalement à l’établissement le soin d’organiser la concertation en vue de concilier liberté religieuse et obligations de services ; dans un deuxième où un élève de classe préparatoire aux grandes écoles se voit débouter de sa demande de dérogation du samedi à raison qu’en s’inscrivant dans ce type de classe il ne pouvait en ignorer les obligations, il peut se déduire qu’a contrario le refus de dérogation n’est pas acquis s’agissant d’autres niveaux. Et alors que le juge ne s’occupait pas, naguère, de mesures dites « intérieures », il accepte maintenant d’examiner des sanctions internes à l’armée ou au système pénitentiaire, voire même dans les fédérations sportives. Volens, nolens, les établissements scolaires, sont ramenés au droit commun. Ainsi une mention telle que « Les parents ne peuvent refuser les sanctions données par l’établissement » n’a aucune valeur, puisqu’ils peuvent contester une sanction par des recours gracieux, hiérarchiques et même contentieux. D’ailleurs « le législateur, avec la loi du 4 août 1982, a repris a son compte la jurisprudence du Conseil d’Etat en posant en principe qu’un règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». (C.E. 12 juin 1987, cité par G. Mamou dans La charte du civisme scolaire Le règlement intérieur CNDP).
Le paradoxe du règlement intérieur est qu’il ne relève pas seulement du champ disciplinaire, mais qu’à cet aspect s’ajoutent des aspects informatifs, éducatifs, éthiques et moraux. il est, en quelque sorte la cristallisation de ce que la communauté‚ scolaire se donne comme règles. Les élèves, comme les autres parties prenantes de l’EPLE, participent à l’élaboration du règlement intérieur, mais une fois celui-ci adopté‚ il s’impose. Quant à la notion de contrat, c’est abusivement qu’elle est employée s’agissant de règlement intérieur : le contrat se négocie entre parties égales or l’élève n’est pas dans une situation contractuelle, mais dans une situation réglementaire et statutaire.
Cependant, remarque un universitaire, si ces mécanismes conventionnels, en droit, n’existent pas, ils peuvent être utiles en termes symboliques, affirmant des droits réciproques entre l’individu et l’institution.. Pour autant, il serait abusif de dire que le règlement intérieur est la loi pour tous ; certes on peut estimer que pour les adultes, il y a des tolérances inadmissibles, mais les adultes travaillant dans l’EPLE relèvent de statuts (pour la plupart, branches du statut de la fonction publique, avec des contraintes, concernant la liberté‚ d’expression, par exemple, plus fortes que celles du « statut » des lycéens).
Dans l’application au quotidien se pose d’abord le problème de sa lisibilité - est-on sûr que chaque acteur mette la même chose sous les mêmes termes ? - de son appropriation réelle (des exemples sont donnés de l’indifférence voire de l’ignorance totale du règlement intérieur chez les enseignants) ? Une autre difficulté‚ déjà soulevée par Jean-Pierre Obin, est l’absence de séparation des pouvoirs entre la définition de la loi, son imposition et l’application des sanctions, le chef d’établissement participant de la première et étant le garant des deux autres. Un arrêt du C.E. a confirmé‚ que, quelles que soient les pressions, le chef d’établissement reste maître de la procédure disciplinaire.
Un représentant de parents d’élèves (FCPE) dénonce la tentation de vouloir tout y mettre, d’en faire un catalogue d’interdictions, sans que soient posées des règles claires. Si ce recueil est vraiment indispensable, il faudrait, à côté, développer des lieux de dialogue, avec une charte de fonctionnement, en revalorisant le rôle des délégués des élèves.
Jean-Marie Catusse, Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ), s’interroge sur ce qu’on attend d’un règlement intérieur. il y voit
l une fonction structurante du cadre de vie de l’élève :
ï intégration de la loi, donc rôle de distanciation par rapport aux règles de vie de la cité‚ du quartier ; ce qui nécessite une explicitation et une vérification de la compréhension des règles.
l une fonction de production de sens, d’où la nécessité d’expliciter un certain nombre de valeurs :
ï le respect de soi et des autres
ï l’importance des apprentissages
ï la solidarité‚
ï la justice ;
et la finalité‚ de la présence des adultes et des jeunes.
l une fonction de production de liens, car il implique un engagement de tous : le règlement intérieur peut rattacher à une communauté‚ plus vaste que la micro-communauté de la classe que l’enseignant est perpétuellement amené à recomposer.
l une fonction d’identification individuelle : l’élève peut se construire un personnage autre que celui qu’il revêt dans la famille, le quartier...
l une fonction d’identification collective qui peut créer un effet d’aspiration en améliorant les possibilités de repérages, en amenant à l’acceptation et à l’intégration des contraintes et des richesses de la vie en collectivité‚ (avant de parler citoyenneté‚ il faut parler socialisation)
l une fonction de régulation et de responsabilisation : le règlement intérieur permet de mettre des mots sur les comportements, de gérer les manquements et les conflits (en éliminant la loi du plus fort, en prévenant les tentations de passage à l’acte tant des adultes que des élèves) ; il évite la confusion entre compréhension des comportements et leur acceptation en remettant les choix de comportement opérés, non plus sous le signe de la fatalité‚ mais sous celui de la responsabilité.
l une fonction de clarification en évitant, par exemple, de mélanger les sanctions pour des comportements et la sanction des acquis scolaires, le registre du pénal et celui du pédagogique (on ne met pas zéro pour un comportement répréhensible, ni de retenues pour de mauvais résultats).
La notion de distanciation, d’aspiration, qui permet aux jeunes de se détacher des adhérences qui se font par rapport aux règles du milieu social dans lequel ils vivent (loi du plus fort dans le quartier, de l’arbitraire dans la famille) est illustrée par d’autres exemples. Même dans les milieux bourgeois, il faut que l’élève prenne ses distances avec la loi de la famille où tout se négocie ; dans les milieux ruraux, il faut qu’il puisse se libérer de la forte pression familiale liée à la dévalorisation de la vie paysanne (le Gers connaît un taux élevé de suicides des jeunes).
Peut-il être un levier de vie, s’articuler avec des situations pédagogiques que les nouveaux programmes pourraient faciliter ? Peut-il même être la pièce maîtresse de la refondation de la communauté scolaire, redonnant sens à la présence des adultes et des jeunes ? Doit-on y introduire des aspects novateurs tels que le droit à la remédiation, le droit de bâtir son projet personnel ? Mais cela ne risque-t-il pas d’introduire une confusion avec le projet d’établissement. L’articulation entre règlement intérieur et projet d’établissement a cependant semblé problématique.
La question est posée de savoir si cette définition des fonctions du règlement intérieur ne serait pas finalement celle des fonctions de l’école elle-même et s’il ne faudrait pas cantonner le règlement intérieur aux plans juridique et fonctionnel, quitte à distinguer ce document unilatéral qui produit des règles du jeu et donne lieu à sanctions, d’un autre ayant un caractère conventionnel avec adhésion morale. Le règlement intérieur ne peut porter toutes les missions de l’école.
Ce qui peut, à certains égards, rejoindre ces objectifs ambitieux, ce sont les conditions d’élaboration du règlement intérieur. Ces conditions feront qu’il sera accepté‚ ou reçu comme un élément extérieur. Cette élaboration doit prendre en compte les problèmes de lisibilité‚ tant dans le vocabulaire ou la syntaxe que dans la présentation. L’adoption du règlement intérieur doit être suivie d’une politique de communication vers les familles, vers les adultes de l’EPLE, vers les élèves, avec vérification d’une bonne compréhension du texte.
Un autre aspect capital est l’application de la sanction : à « l’authenticité‚ dans la rigueur de sa conception » doit correspondre « la réalité de sa juste application ». (G. Mamou, op. cité). Dans un article de la Revue du Droit Scolaire, l’Inspecteur général D. Mallet rappelle que les sanctions « doivent s’inscrire dans une gradation - étant elles-mêmes graduées - permettant d’observer le principe de la proportionnalité des sanctions et des peines » (souligné par l’auteur). Il rappelle également qu’« il ne peut être prononcé de sanction non prévue par le règlement intérieur » et que sont « formellement interdits », par un arrêté de juillet 1890 (non officiellement abrogé) le piquet, le pensum, la privation de récréation... Les sanctions qu’autorise cet arrêt‚ ainsi qu’un autre de juillet 1884 (exclusion momentanée de la classe ou de l’étude avec renvoi devant le chef d’établissement, la retenue, la tâche extraordinaire, le devoir à refaire, la leçon à apprendre... ) pourraient compléter, sous certaines réserves et après actualisation, celles que prévoient les décrets de 85 et 91 (l’avertissement, l’exclusion temporaire jusqu’à huit jours, prononcés par le chef d’établissement, l’exclusion temporaire supérieure à huit jours, l’exclusion définitive qui relèvent du conseil de discipline). La prudence la plus grande doit régner dans la définition de sanctions du type TIG (Travaux d’Intérêt Général) qui peuvent risquer d’être assimilées à des brimades.
De même, l’usage de l’exclusion temporaire avec obligation de présence dans l’établissement pose de lourds problèmes de responsabilité.
Comme ce sera indiqué ultérieurement dans le colloque, le problème n’est pas tant la transgression de la loi (du RI) mais sa négation (qui peut d’ailleurs passer par une habile utilisation). À ce propos, J.M. Catusse cite un article de Frédéric Jésu, dans le Journal du Droit des Jeunes de mars 1996, qui distingue diverses catégories de collégiens : les rebelles (1,8%), chefs indiscutables et indiscutés (reproduisant, le plus souvent, dans le collège, des phénomènes de pouvoir exercés dans le quartier), assurés de l’impunité‚ car connaissant bien les institutions et s’en servant à leur profit ; les candidats à l’impunité‚ (4,5%), prenant les premiers comme modèles mais moins à l’abri de la répression ; les paumés (4,5%), victimes désignées en particulier des précédents ; les positifs (5,5%), respectés dans le domaine scolaire ; enfin les élèves ordinaires qui ne veulent pas d’histoires, mais qui sont victimes des deux premières catégories. Cette typologie, dans sa précision quantificatrice, peut prêter à discussion, elle n’en pointe pas moins la difficulté‚ pour un règlement intérieur de faire le poids face à cette reproduction d’un contexte social dans les zones dites sensibles ou difficiles.
Pour conclure, travailler, analyser, modifier le règlement intérieur, se traduit dans TROIS AXES :
· le resituer par rapport aux libertés publiques, au droit commun
· être conscient du poids possible des pressions du moment, du mimétisme
· se placer dans la perspective d’en faire la cristallisation de ce que la communauté‚ se donne comme règles communes.
n La forme
· limiter ce qui peut-être contestable, être lisible
· répondre à qui fait quoi ? comment arriver à une harmonisation relative des pratiques quotidiennes, des attitudes ? Quelle prise de distance par rapport au vécu de chacun ?
· quelle forme donner au travail d’élaboration pour impliquer les divers partenaires de la communauté‚ scolaire ? puis quelle diffusion, quelle vérification régulière du niveau d’appropriation par chacun, quel suivi, quelle évolution ?
urêvée d’abord comme médiation qui permet d’aspirer et d’aller vers autre chose,
· en structurant élèves et adultes
· en permettant, pour l’élève, la distanciation par rapport à la loi du milieu où il vit
· en socialisant
· en produisant du sens, des valeurs favorisant l’intégration, la remobilisation.
uvoulue ensuite comme recentrée sur le juridique, avec la partie morale et éthique, le projet de vie sous une autre forme qui prendrait aussi en compte la distanciation et la production de sens évoquées.
Elle doit être
· authentique dans la rigueur de sa conception, de son application
· maîtrisée, prenant en compte beaucoup d’éléments (ce que la loi interdit, le risque d’arbitraire, de brimades, les limites matérielles... ), ne dépassant la jurisprudence connue qu’avec prudence et en toute lucidité.
Þ élaboration après une clarification (qui fait quoi ? quelle prise de distance opérationnelle ?...)
Þ vérification du niveau d’appropriation, pour chaque acteur, régulièrement
Þ donner une orientation juridique
Þ faire de la sanction un acte éducatif au titre de la communauté scolaire, en sachant se donner une marge consciente de risques par rapport à une vision purement juridique.
Si le règlement intérieur doit être en rapport à la loi, c’est aussi et avant tout celui d’un EPLE précis, avec son environnement, son histoire.