
Nouveau site :
|
Lettre à un jeune professeur : Philippe Meirieu engage le débat…
|
|||||||||||||||||||||||||||
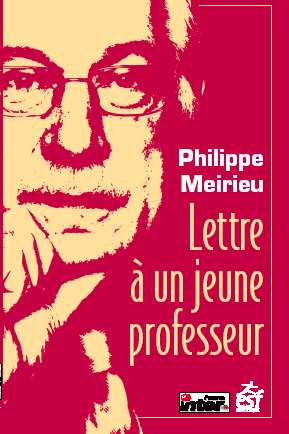 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Le dernier ouvrage de Philippe Meirieu, à paraître le 22 août, Lettre à un jeune enseignant (co-édition ESF – FRANCE INTER), prend un peu un caractère « testamentaire » puisque le directeur de l’IUFM de l’Académie de Lyon annonce qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat. Son titre est explicitement inspiré de la Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Ceux qui donnent dans la critique convenue du style « éducnat » ou, pire, d’un langage pédagogique jargonnant en seront pour leur frais. L’écriture est fluide rendant la lecture aisée et rapide, sans nuire à la profondeur de la réflexion et à la solidité de l’argumentation. Quelques flèches bien ajustées sont décochées vers ceux que notre ami Raymond Mallerin désigne sous le nom de « rétropenseurs », mais le propos de Philippe Meirieu n’est, à l’évidence, pas polémique.
Philippe Meirieu a fait l’amitié à Education & Devenir de l’autoriser à mettre en ligne, avant la parution (prévue pour le 22 août), des « bonnes feuilles ». Mais il a souhaité aussi que ce soit l’occasion d’ouvrir un débat. C’est ainsi que nous avons convenu du principe suivant : seraient mis en ligne deux extraits, assortis de remarques auxquelles l’auteur répondrait et un passage sur lequel l’accord était total. Inutile de dire que, sur ce dernier point, la matière était surabondante et le choix a été parfaitement arbitraire.[1]
[1] Les commentaires « critiques » sont l’œuvre d’un responsable d’Education & Devenir avec l’apport modeste du responsable du site qui porte, en revanche, l’entière responsabilité du choix des extraits.
|
|
|
Cet échange peut et doit se poursuivre : toutes celles et ceux d’entre vous qui veulent réagir à cette page, à celles de la prochaine livraison du Monde de l’éducation qui comporte un long entretien avec l’auteur, et bien sûr à l’ouvrage lui-même, le peuvent sur notre site. Philippe Meirieu s’efforcera de répondre à vos commentaires. |
Pour réagir cliquez sur l'enveloppe |
| L’écart entre l’idéal et le quotidien | |
|
Voilà des choses qu’on ne dit guère et qui sont, pourtant, notre lot commun : nous vivons tous dans un écart, difficile à accepter, entre notre idéal et notre quotidien. Et nous en souffrons : plus ou moins ostensiblement, parfois en retournant la souffrance contre nous-même – « Je suis vraiment un incapable et je n’aurais jamais dû faire ce métier ! » - parfois en la transformant en agressivité contre « la pseudo démocratisation de l’École » et « la baisse du niveau encouragée par des politiques démagogiques » ! Croyez-moi : aucun professeur n’est à l’abri de ces plaintes. Et ne soyez pas culpabilisé d’y céder parfois. C’est l’inévitable revers de la médaille. Le verso de l’ambition lumineuse qui nous a fait choisir ce métier… Je suis d’ailleurs le premier à comprendre – pour l’avoir souvent vécu – ce sentiment d’agacement devant ce qui nous apparaît comme des persécutions administratives dérisoires au regard de notre projet d’enseigner : « Monsieur Meirieu, vous n’avez pas rempli correctement le cahier de textes de la classe… Vous êtes en retard pour vos bulletins… Avez-vous oublié les dernières instructions ministérielles sur la grammaire ? Avez-vous pris la peine de convoquer les parents de cet élève ? De signaler cet autre au conseiller d’éducation et de voir l’assistante sociale pour évoquer le cas de ce troisième ? » Ou encore : « Monsieur Meirieu, vous n’avez rien fait pour la semaine de la presse à l’école, que pensez-vous faire pour la semaine contre le racisme ? Ne sous-estimez-vous pas votre rôle en matière d’éducation à la santé ? Vous semblez oublier nos responsabilités en matière de prévention routière. Et êtes-vous vraiment sûr que ce livre sur lequel vous apprenez à lire à vos élèves soit au programme ? » On finit par craquer ! Et, dans les moments de colère, par se demander si ceux qui sont chargés d’administrer notre institution n’ont pas d’abord pour objectif de nous empêcher d’enseigner ! […]
Et, sans doute, les responsables de la « machine-école » n’ont-ils pas vraiment pris la mesure de ce phénomène. On se demande même, parfois, s’ils ne rêvent pas d’une institution sans professeur : une sorte de self-service où les élèves seraient pris en charge, alternativement, par des ordinateurs et des intervenants extérieurs, avec évaluation en temps réel des compétences acquises et reventilation immédiate en « groupes provisoires et adaptés ». Les directeurs et les chefs d’établissements pourraient ainsi, à partir d’un diagnostic initial des élèves, piloter au plus près de l’efficacité immédiate, repérer au mieux les réfractaires et mettre en place les remédiations requises… sans avoir à s’encombrer des états d’âme de professeurs. […]
Je n’ai, pour ma part, pas la moindre inclination pour cette songerie technocratique qui évoque les tableaux les plus sombres de la science-fiction. Je reste d’abord professeur et, comme vous, je ne suis vraiment heureux que quand je m’approche un peu de ma source intérieure, quand je sors d’un cours avec le sentiment que « ça a marché »… Je sais bien qu’en avouant cela, je prends le double risque de la niaiserie et de la provocation. Niaiserie au regard des esprits forts des sciences dites humaines qui risquent de me ranger définitivement dans le camp des ringards : « Voilà que Meirieu se perd dans l’indicible… Un peu plus et il va nous faire une crise de mysticisme ! ». Provocation aux yeux des défenseurs des « savoirs disciplinaires » qui voient en moi un fossoyeur de la culture : « Après tous les discours qu’il a tenu sur le projet d’établissement et la pédagogie différenciée, comment croire à ce déballage indécent ? » Et pourtant, face à un jeune professeur, je persiste et signe : on ne construira pas une « école de la réussite de tous », comme nous y invitent les politiques, contre ce qui meut chaque professeur en son projet le plus intime. On ne la construira pas, non plus, sans les professeurs dans leur ensemble. En leur imposant de l’extérieur une série d’obligations déconnectées de leurs préoccupations premières et qu’ils vivent souvent comme des entraves à leur mission. C’est pourquoi je défends l’idée iconoclaste selon laquelle il conviendrait que toute personne qui prend des responsabilités administratives ou pédagogiques garde un contact régulier avec des élèves : que le chef d’établissement continue à enseigner quelques heures par semaine dans sa discipline d’origine comme l’inspecteur et, même, l’inspecteur général. Que les fonctionnaires de l’administration centrale du ministère comme les recteurs et leurs collaborateurs continuent d’assurer des charges d’enseignement scolaire ou universitaire. […] |
|
La quête de l’efficacité
|
|
|
Nul ne saurait décemment prétendre que l’institution scolaire doit renoncer à toute efficacité. Ni l’État et l’ensemble de la société civile, ni les contribuables et, a fortiori, les parents d’élèves, ni les directeurs écoles et les chefs d’établissement. Ni même les professeurs que nous sommes. Au quotidien, d’ailleurs, nous sommes tous en quête d’efficacité. Et ce que nous nommons « didactique » n’est rien d’autre que la recherche par laquelle nous tentons de comprendre « comment ça marche » dans la tête d’un élève afin qu’il s’approprie au mieux les connaissances du programme. J’ai moi-même beaucoup travaillé dans cette perspective : j’avais été frappé, dès mes débuts, par le caractère stérile de nos injonctions habituelles – « Mais faites donc un effort pour comprendre ! » - et la vanité du seul renvoi à une activité censée résoudre tous les problèmes : « Faites votre exercice et vous comprendrez ! ». C’est ainsi qu’en me penchant sur les travaux des pédagogues et des psychologues, j’en suis venu progressivement à me demander : « Qu’est-ce que je dois précisément faire réaliser à mes élèves aujourd’hui ? Sur quels matériaux travailler et avec quelles consignes, pour que chacun d’entre eux accède aux connaissances que je veux lui transmettre ? » Un renversement apparemment anodin et, pourtant, essentiel. Ne plus se poser la question : « Qu’est-ce que je vais leur dire ? », mais : « Qu’est-ce que je vais leur demander de faire ? ». Et sans, bien sûr, renoncer au cours magistral quand c’est nécessaire, mais en s’interrogeant, là encore : « Comment mes élèves peuvent-ils en profiter au mieux ? Quels conseils pour soutenir leur écoute ? Quels exercices pour vérifier leur appropriation en continu ? » […] Malgré ce que vous pourriez croire, il n’y a rien de vraiment nouveau dans ces propositions. C’est, en effet, Jules Ferry lui-même, dans un discours prononcé le 2 avril 1880, qui affirmait : « Les méthodes nouvelles qui ont pris tant de développement, tendent à se répandre et à triompher : ces méthodes consistent, non plus à dicter comme un arrêt la règle à l’enfant, mais à la lui faire trouver. Elles se proposent avant tout d’exciter et d’éveiller la spontanéité de l’enfant, pour en surveiller et diriger le développement normal, au lieu de l’emprisonner dans des règles toutes faites auxquelles il ne comprend rien. » […] L’efficacité ne se mesure qu’à l’aune des finalités. Et nous ne pouvons réduire notre travail éducatif à la poursuite des seuls effets que nous pouvons mesurer avec les outils traditionnels de l’évaluation scolaire. Regardons précisément les dernières statistiques de l’enquête internationale de l’OCDE sur les performances des élèves de quinze ans*. Trois pays arrivent en tête : la Finlande, le Japon et la Corée du Sud. Avec des résultats à peu près comparables. Mais on ne peut s’en tenir là : il faut regarder, de près, comment ils s’y prennent. En Finlande, les élèves sont scolarisés dans des classes hétérogènes jusqu’à seize ans. Ils n’ont aucune note chiffrée, mais des évaluations qualitatives leur permettant d’orienter leurs efforts ; ils bénéficient de parcours personnalisés en fonction de leurs besoins et n’ont aucun travail à la maison. De plus, ils occupent une grande partie de leur temps scolaire à des recherches documentaires, seuls ou en petits groupes. Ils sont systématiquement encouragés à participer à des troupes de théâtre, à des chorales ou à des activités culturelles de toutes sortes. L’après-midi, les écoles restent ouvertes et accueillent des clubs d’astronomie, de reliure ou d’informatique qui réunissent élèves, parents, enseignants et habitants du quartier ou de la région… Au Japon ou en Corée du Sud, en revanche, après des études primaires assez semblables aux nôtres, les élèves sont triés à dix ou onze ans, de manière draconienne. Ils passent un examen d’entrée au collège et, s’ils sont reçus, sont soumis à un rythme scolaire d’une extrême dureté. De plus, la plupart d’entre eux doivent, pour réussir, prendre de nombreuses leçons particulières. Très vite, ils abandonnent toute activité extrascolaire pour ne vivre que dans l’obsession des bonnes notes. Le taux de dépressions et de tentatives de suicide augmente d’année en année… Évidemment, il n’est pas question, ici, de diaboliser les systèmes éducatifs asiatiques et d’idéaliser la Finlande, dont les spécificités historiques et géographiques rendent le système difficilement transposable en France. Mais la question se pose : pouvons-nous, dès lors qu’il s’agit d’éducation, réduire l’évaluation de nos écoles et de nos établissements aux seuls indicateurs habituels de réussite scolaire ? 80% d’élèves au niveau du baccalauréat… pourquoi pas ? Mais, pourquoi pas, dans un régime qui se veut formateur à la citoyenneté démocratique, 80% des élèves qui auront été délégués de classes – et, donc, accompagnés et formés pour cela – au cours de leur scolarité ? 100% d’élèves ayant un niveau de qualification ? Évidemment ! Mais pourquoi pas, aussi, 10% d’élèves ayant eu l’occasion de faire une enquête, de préparer un dossier sur une question et de prendre la parole pendant une heure devant un groupe ? Une augmentation de 20% des élèves « atteignant en langue vivante étrangère le niveau B1 du cadre de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » ? Qui pourrait s’y opposer ? Mais pourquoi pas une augmentation de 20% du nombre d’élèves entretenant une correspondance en langue vivante étrangère ? Ou une augmentation de 20% des élèves impliqués dans un projet artistique ou culturel ? Ou encore une augmentation de 20% du taux de fréquentation des bibliothèques et centres de documentation ? Qui ne voit que ces indicateurs de réussite pourrait être multipliés à l’infini ? Qui ne voit qu’aucun choix, ici, n’est innocent et que chacun d’entre eux renvoie, tout à la fois, à un projet d’homme et de société… qu’il promeut des pratiques pédagogiques spécifiques et s’appuie sur une conception implicite de notre métier ? Et qu’on ne dise pas que les objectifs alternatifs que nous proposons conduiraient à une baisse catastrophique du niveau : les exercices scolaires et les examens traditionnels n’ont pas le monopole de l’exigence de rigueur et de qualité. La recherche de la vérité, la pensée critique, la référence à l’histoire et à la culture, le souci de la précision et de la perfection peuvent parfaitement être au cœur de pratiques qui conjuguent accès à l’autonomie et formation à la citoyenneté ! […] Impossible, aussi, de se contenter de défiler en criant que « l’École n’est pas une entreprise », si nous ne travaillons pas, de l’intérieur, à changer les pratiques d’évaluation pour nous dégager du marchandage scolaire qui nous renvoie effectivement dans le système productif : tant que la note restera un salaire pour un travail effectué plus ou moins volontairement et ne deviendra pas une indication pour se situer et progresser, l’École continuera, irrémédiablement, à basculer dans l’économie de marché. Inutile, enfin, de stigmatiser les dérives libérales du système si l’on ne se bat pas contre toutes les formes d’exclusion et de relégation, si l’on ne fait pas en sorte que tous, même ceux qui n’auront pas la possibilité de poursuivre leurs études dans des filières prestigieuses, acquièrent les fondamentaux de la citoyenneté. Une « école juste », explique François Dubet, ne peut ajouter l’humiliation à l’échec. Elle ne peut pas, non plus, faire l’impasse sur des savoirs sans lesquels les plus démunis perdent toute chance de comprendre un peu ce qui leur arrive…
* Sur PISA 2003 (OCDE) on peut consulter : - les résultats de l'enquête (format excel) (ndlr) |
|
Que Philippe Meirieu nous pardonne d’ajouter un dernier extrait, mais nous ne pouvons résister au désir de proposer encore ces quelques lignes : |
 |
Construire un monde à hauteur d’homme
|
|
Je ne saurais trop vous demander de vous méfier de cet esthétisme de la désespérance, si répandu aujourd’hui. Sous prétexte que le monde nous donne, chaque jour, le spectacle lamentable de foules qui se prosternent aux pieds de tyrans ou s’avachissent devant le crétinisme des médias, trop d’intellectuels se retirent sur l’Aventin : ils n’en finissent pas d’excommunier le monde… mais sans jamais rien proposer pour nous permettre de le transformer. On peut ainsi, être, tout à la fois, révolté et résigné, bénéficier du prestige de la dissidence et de la tranquillité du renoncement. Et gagner sur tous les tableaux… On rejette alors, avec mépris, « les illusions pédagogistes » de ceux qui se coltinent, tant bien que mal, l’éducation des barbares. L’on se satisfait très bien – même si on ne l’avoue guère - d’un monde où cohabitent la démagogie et l’élitisme, le mépris pour les uns et la suffisance des autres, l’apartheid entre les exclus et les élus… (…)
Et, en matière scolaire, ce comportement trouve une application facile : on se contente d’enseigner la minorité d’élèves qui connaît déjà la saveur du savoir et de déverser les autres dans des garderies plus ou moins déguisées. Sans imaginer, un seul instant, que nous disposons d’une arme formidable contre toutes les formes de fatalité, d’un moyen pour faire sortir les uns et les autres de leurs ghettos : l’éducation démocratique à la démocratie. (…)
N’ayez crainte : je ne vous demande surtout pas d’abandonner la moindre parcelle de votre projet initial. De renoncer à enseigner les disciplines pour lesquelles vous vous êtes engagé dans ce métier. Bien au contraire. C’est au cœur même de cet enseignement, et en assumant pleinement votre mission de transmission des savoirs, que vous « enseignerez l’École ». Vous deviendrez ainsi, en même temps un professionnel de l’apprentissage et un militant politique – au sens le plus noble du terme - engagé, au quotidien, dans la construction d’un monde à hauteur d’homme. |
|
| E&D, Philippe Meirieu avec l'aimable autorisation des éditions ESF | |
| Rappel : vos réactions et commentaires sont les bienvenus et Philippe Meirieu (dans la mesure, bien sûr, de ses possibilités) essaiera de poursuivre l'échange riche (de notre point de vue) entamé sur cette page. |
Pour réagir cliquez sur l'enveloppe |
| Je ne crois pas, bien
sûr, que nous puissions réinventer le monde au quotidien. Mais, peut-être,
peut-on travailler au quotidien à ce qu’il demeure ou devienne “à hauteur
d’homme”: c’est-à-dire que les enjeux soient bien posés au niveau de
l’avenir des hommes, et non de ceux de la marchandise, des “mécaniques
institutionnelles” aveugles, des intérêts de quelques minorités mieux
informées ou plus fortunées, des carrières politiques ou médiatiques de
quelques uns, etc... S’agissant de l’effort des établissements franciliens pour “aider les plus méritants” à accéder aux meilleurs établissements (ce qu’on appelle aujourd’hui “la discrimination positive”), je crois qu’il faut être prudent. J’approuve le travail de jumelage entre les établissements de banlieue et “Sciences politiques”*, par exemple : cela permet de relancer la mobilité sociale dont l’absence est particulièrement décourageante et fait perdre tout crédit à l’école. Il ne faudrait pas, pour autant, s’en contenter et oublier d’apporter aux “établissements difficiles” l’aide dont ils ont besoin pour faire face aux défis qu’ils doivent relever. Je ne voudrais pas que “la discrimination positive” se solde par l’organisation de la concurrence entre les exclus pour que “les plus méritants” puissent quitter des ghettos considérés comme définitivement abandonnés. C’est là, à mes yeux, un des problèmes majeurs de notre système scolaire et je me permets, sur cette question, de vous renvoyer, outre à l’ouvrage dont il est question ici, à un petit pamphlet que j’ai publié en janvier 2005 : Nous mettrons nos enfants à l’école publique (Mille et une nuits). * Sur cette action de Sciences Po voir http://education.devenir.free.fr/colloque2004.htm#CEP-IEP |
|
|
Enfin! Le branle est donné sur cette soi-disant
"culture de l'évaluation" qui a la prétention de réduire l'éducation, les
personnes, élèves, enseignants, encadrement, à des objets que l'on entend
transformer par l'injonction à des "résultats". Rendre en quelque sorte
les acteurs responsables de leur échec. Et aussi, dans le même temps,
conforter les positions de pouvoir des experts de la statistique,
l'autorité hiérarchique de ceux qui, dans l'administration, se sont saisis
de tous ces outils qui font moderne pour "piloter"*, en fait diriger. J'ai
appelé ce phénomène "administratisation" du système.
Pourtant, il me semble qu'il faut sortir de cet
affrontement stérile qui replace systématiquement de telles problématiques
dans le champ clos de la guerre entre rétropenseurs et progressistes. Car
beaucoup d'enseignants n'en ont cure, comme le dit F. Dubet dans Le Monde
de l'Education: "Le blocage s'accroît : plus les enseignants souffrent
dans leur pratique professionnelle devenue "impossible", plus ils se
crispent; plus ils se crispent, plus ils se désespèrent. Nous sommes dans
une spirale perverse". Il faut donc poser la question de l'évaluation, et
dans le même temps celle des fonctionnements hiérarchiques. J'apprécie que
Ph. Meirieu évoque la totémisation des résultats par la hiérarchie; qu'il
laisse entendre que l'évaluateur est impliqué dans l'évaluation, que
l'acteur est amené à "penser par lui même", que le fameux concept de "remédiation"
est d'une insuffisance criante, reprise à l'envi par les circulaires qui y
voient une potion magique! Enfin, j'apprécie qu'il pose la question de
l'inspection, même si la solution qu'il préconise, transformer les
inspecteurs en "formateurs" rattachés aux IUFM , voire les supprimer, me
paraît naïve et irréfléchie.
Sur la création du "métier d'inspecteur", voilà 15
ans bientôt qu'avec mes collègues et amis Jean Pol Rocquet et Rémy
Bobichon nous proposons une réflexion autour des pratiques d'évaluation,
d'animation, de médiation. Nous avons diffusé ces approches sur notre site
"métiers d'inspecteur",
http://crdp.ac-reims.fr/ien et Jean Pol ROCQUET vient de publier aux
éditions l'Harmattan son ouvrage : "L'inspection pédagogique, aux risques
de l'évaluation" (2005). Que ce soit sur les pratiques, la culture "EN"
évaluation, etc., l'ouvrage développe ce en quoi l'inspection trouve sa
légitimité et qu'avance Ph. Meirieu : "On ne construira pas une école de
la réussite pour tous...contre ce qui meut chaque professeur en son projet
le plus intime". L'inspection nous paraît devoir reconstruire sa
légitimité dans ce travail direct avec les enseignants autour de la valeur
de leurs actes, des valeurs qui les animent, des méthodes qui les
prolongent.
Développer cette problématique professionnelle n'est
pas sans risque, et je remercie Ph. Meirieu de l'avoir ranimée dans son
ouvrage. Mais le système résiste: la formation des inspecteurs piétine et
s'enlise dans un cumul d'injonctions paradoxales, d'inculcation d'usages,
d'évitement du questionnement sur le sens du travail ; la hiérarchie
veille au grain et garde la main en se prévalant des impératifs
technocratiques ; et si quelques acteurs se permettent de réfléchir à leur
positionnement, à leurs pratiques, ils sont bien vite montrés du doigt,
comme dans le rapport des IGEN sur l'académie de Reims, page 98, où un
membre du service académique raille un quarteron d'IEN à "l'étrange
positionnement"! (on peut trouver un commentaire sur notre site).
Ph. Meirieu nous conforte dans notre volonté réflexive, encore faut-il que les acteurs se mobilisent, qu'ils préservent une certaine fierté, et que l'on passe au niveau des pratiques, là où l'éducation se fait: dans la classe, dans l'école. _ Georges Gauzente 23/08/05 * Sur des "outils pour piloter" voir Des indicateurs de pilotage. Lesquels? Pour quoi faire? Comment? et notamment les IPES (Indicateurs de pilotage pour les établissements secondaires). |
Jean-François CHALOT 28/08/05 |
| Merci à Jean-François
Chalot pour sa lecture bienveillante. Même si je regrette qu’il reste encore
sur une représentation négative du rapport de 1998 sur les lycées* (qui ne me
semble pas si éloigné, au fond, de ce que je défends dans la Lettre à un
jeune professeur), je lui sais gré de “me donner ma chance encore” -
comme disait jadis richard Anthony ! - et d’accepter de considérer les
positions que je défends aujourd’hui sans préjugé. Je me sens d’ailleurs, comme lui, très gêné par “l’opposition frontale” entre ceux et celles qui défendent l’exigence intellectuelle et culturelle de l’École, d’une part, et ceux et celles qui, d’autre part, veulent “changer l’École”. Pour moi, cette opposition est absurde : c’est au nom des exigences intellectuelles et culturelles fortes qui sont les miennes que je récuse, pour ma part, la pédagogie paresseuse des “conservateurs” pour lesquels toute forme de travail de groupe, de recherche documentaire, de pédagogie du projet n’est que démagogie et temps perdu. Et c’est au nom des mêmes exigences que j’encourage toutes les méthodes pédagogiques qui permettent de construire un rapport critique et non sacramentel au savoir. C’est au nom de ces exigences que je défends les Travaux personnels encadrés aussi bien que “La Main à la pâte”, les journaux scolaires et les classes à projet artistique et culturel... La question cependant, comme j’essaye de le montrer, est bien, dans toutes ces pratiques, celle du niveau d’exigence: on peut s’abîmer dans la contemplation béate des élèves, s’agenouiller devant leurs caprices ou bien, au contraire, saisir toutes les occasions possibles pour les “tirer vers le haut”: susciter la curiosité, encourager à enquêter au delà des évidences premières, faire le détour par l’histoire, activer les interactions entre pairs, questionner les représentations, exiger une expression précise et des démonstrations rigoureuses, aider à formaliser les acquis et à se donner de nouveaux objectifs d’apprentissage, organiser le transfert de connaissances, etc. Dès lors que le professeur met en place tout cela, il contribue à “élever le niveau”, le vrai... Sur la question des “centres d’intérêt”, je ne défends absolument pas l’idée que le maître doit abandonner toute forme de proposition, ni qu’il doit renoncer à faire découvrir aux élèves ce qu’ils ne connaissent pas et pour quoi ils ne peuvent donc être motivés : je dis même explicitement le contraire. Mais j’ajoute que toute la difficulté est de faire en sorte que les travaux contraints suscitent en eux-mêmes la motivation... sans attendre une tardive rétribution: “Tais-toi et travaille... Tu verras bien, un jour, que c’est intéressant!”. Cette lointaine rétribution n’est accessible qu’aux élèves favorisés, ceux qui ont déjà vu et compris, à travers le témoignage de leur environnement, que le sacrifice de ses intérêts immédiats au profit d’un hypothétique intérêt lointain n’est pas un leurre. Car, pour les autres, pour l’immense majorité des élèves de collège par exemple, cette “satisfaction différée” est vécue comme une escroquerie. Et c’est pourquoi c’est dans le mouvement même du travail que le professeur doit susciter la motivation. Ni la présupposer avant. Ni se résigner à ce qu’elle ne vienne qu’après. Concernant le problème des réformes et, en particulier l’instauration du “projet d’établissement”, je reconnais bien volontiers – je le dis explicitement – que cela a pu être vécu comme un “bidule administratif”. Mais je fais le pari que ce n’est pas une fatalité : dès lors que l’on centre la concertation, le travail en équipe, le projet d’établissement sur la question de la transmission des savoirs – et non seulement sur des questions organisationnelles -, alors tout change : le professeur peut se sentir respecté dans sa “vocation” première et, en même temps, être porté par une dynamique collective. * "Quels savoirs enseigner dans les lycées ?" téléchargeable format *.rtf |
|
|
J'ai eu le plaisir de rencontrer Philippe Meirieu lors de l'université d'été de Prisme et c'est un plaisir de retrouver ce débat autour de son dernier livre. Voici ma réaction en tout simplicité: Merci à M. Meirieu de stimuler encore notre curiosité intellectuelle avant la rentrée. Se demander si on peut apprendre seul à être un bon enseignant, si les cadres hiérarchiques et les pressions institutionnelles enrichissent ou paralysent cet apprentissage, pose en fait la question mystérieuse de tout apprentissage, celui des élèves, celui de tout professeur, celui de tout être humain : si nous savons que l’enfant sauvage n’apprendra rien, chacun d’entre nous parvient-il pour autant à retrouver dans l’être qu’il est devenu la trace de ce qu’il devrait à une simple "opération de transmission de savoirs " ? Bref comment apprend ton ? Ne sommes- nous pas des organismes autonomes qui devenons humains parce que nous faisons dès l’enfance et toute notre vie des hypothèses, des erreurs, des expériences, des tris, des conclusions, des choix, affectivement et émotionnellement motivés de l’intérieur de nous-mêmes, dans la masse d’informations que nous offre le monde ? L’enseignant est alors un acteur parmi d’autres dans cette conquête de l’autonomie .Il accompagne, il encourage, il rassure, il enrichit, il ouvre tous les chemins sans en imposer un seul, avec l’ambition et la modestie de cette tâche, plein de confiance dans l’apprenant. Et comment le cadre étriqué et réducteur des programmes pourrait-il contenir la masse de plus en plus croissante de la complexité du monde actuel ? L’attachement de notre hiérarchie à ses petits programmes, à ses petites évaluations, à ses petites grilles de compétences , sa surdité aux vraies problématiques éducatives et son paternalisme infantilisant au sujet de notre « responsabilité de fonctionnaire » est assez pitoyable. Heureusement, certains enseignants* n’ont pas attendu en vain les animations pédagogiques ou les inspections pour engager, dans la solitude de la préparation « de la classe », puis avec leurs élèves sous des formes adaptées à leur âge, les réflexions qui devraient s’inscrire dans toute formation initiale : Pourquoi, je suis à l’école ? Qu’est-ce que les humains font dans le monde ? Qu’est-ce que j’ai envie d’en comprendre ? Quel rôle j’ai à jouer dans ce monde ? Et souvent, poussés par une puissante motivation qu’on appelle aussi « désir de connaître », ils vont librement compléter leur connaissance du monde en lisant des compagnons aussi rassurants que Philippe Meirieu dont je vais enrichir ma bibliothèque. Christine Chassain enseignante à l'école Jaurès de Morsang sur Orge |
|
| * Attention toutefois de ne pas tomber dans ce "libertarisme" que Philippe Meirieu décrit plus haut (ndlr) |
|
J’ai retrouvé dans ce dernier ouvrage de P. Meirieu, le compagnon fidèle à ses valeurs d’humaniste, cohérent dans ses convictions, modeste artisan de la pédagogie, démocrate convaincu, tribun infatigable… Dans mon travail quotidien, je me sens toujours proche de sa conception du métier d’enseignant, des missions de l’Ecole, de l’organisation de la classe et de l’établissement, de son respect et de son amour des élèves. Pourtant, j’ai été souvent gêné à la lecture de ce livre et j’ai craint que ses détracteurs trouvent aliment pour l’accuser de propos excessifs et de démagogie. Accusations aux antipodes de sa pratique quotidienne. Il me semble en effet que P. Meirieu a été victime du procédé littéraire qu’il a choisi : la forme d’une lettre adressée aux jeunes enseignants l’amène à parler pour eux pour mieux leur répondre « Vous êtes agacés par… je partage vos réticences… mais… » Le 1er inconvénient est qu’il met tous les jeunes enseignants dans le même sac, sans prendre en compte leur diversité… Le 2ème inconvénient - le plus important à mes yeux – est qu’en réalité il leur fait chausser d’emblée les positions réactionnaires de ses propres adversaires (qui sont aussi ceux des militants de E.D)…qui ne se caractérisent pas particulièrement par leur jeunesse. Je comprends bien l’intention de P.Meirieu : il s’agit pour lui de les prévenir, de répondre par anticipation aux discours que ces jeunes professeurs entendront nécessairement en salle des professeurs. La forme choisie risque ainsi de faire perdre le sens du message qu’il veut leur adresser : on ne persuade pas un enseignant de la grandeur de sa mission en lui attribuant a priori, et - je crois- à tort les réticences et agacements des réactionnaires de tout poil des vingt dernières années… Les jeunes enseignants ne sont pas encore crispés par le formalisme excessif des projets d’établissement. Ils ne connaissent pas les dérives du projet d’établissement telles que nous les avons connues au début des années 90. …J’en connais beaucoup au contraire qui se plaignent de l’absence de vrais projets d’établissement qui expriment une politique claire pour tous ceux qui vivent dans leur établissement… ils ne sont pas irrités par le fait qu’ils doivent rendre des comptes en remplissant un cahier de textes…. ils ne sont pas en réalité accablés par les formalités administratives… J’en ai peu connu qui soient réticents à connaître le fonctionnement d’un établissement, ses instances, les rôles de ses acteurs… Ils ne condamnent pas d’emblée « les délires organisationnels ». Je ne connais pas beaucoup de jeunes enseignants qui vivent de la nostalgie de l’Ecole de la 3ème république… Cette école ne fait pas partie de leur culture. Loin de « boycotter les multiples dispositifs d’accompagnement des élèves », ils sont prêts à s’impliquer dans le travail, en petits groupes, à travailler en équipe et à monter des projets… Ils ont simplement peur de ne pas arriver à tout faire…
Heureusement, au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture de cet ouvrage, P. Meirieu renonce progressivement à parler au nom de son public… Le propos retrouve sa vigueur et sa pertinence, en particulier quand il parle de l’exigence, de la discipline en classe et de notre métier commun de « Professeur d’Ecole »… Il resterait encore à dire aux jeunes enseignants, qu’ils font un métier certes difficile, mais un beau métier qui les rendra heureux pour peu qu’ils respectent leurs élèves, ne restent pas seuls face aux inévitables difficultés, qu’ils sont mieux outillés grâce à une formation, dont les générations précédentes n’avaient pas bénéficié… à oser leur dire que leurs conditions de travail, de salaire et de vie en font des privilégiés au regard des personnels TOS qu’ils côtoient chaque jour et de la très grande majorité des parents de leurs élèves. Claude Rebaud, ancien Président d'E&D |
M-Hélène MEYNET (Proviseure retraitée) |
| Il est évident que
l’attitude des politiques, en particulier, dans ces quatre dernières années,
a été particulièrement démobilisatrice. La consultation présidée par Claude
Thélot a fait remonter des éléments intéressants, mais sans, véritablement,
parvenir à mobiliser les parents et à déborder en dehors du cercle des
spécialistes traditionnels du système éducatif. Néanmoins, je crois que les
propositions du “rapport Thélot” aurait dû être prises au sérieux : non pour
les accepter toutes, mais pour vraiment débattre des problèmes qu’elles
soulevaient. Or, ce rapport a été mis sous le boisseau et la “loi
d’orientation sur l’avenir de l’école” s’est réduite à un ensemble de
mesures technocratiques peu lisibles... suspendues, d’ailleurs, pour
beaucoup d’entre elles, par Gilles de Robien à son arrivée au ministère.
Tout cela, effectivement, n’est guère mobilisateur ! Sur la question de la frilosité des enseignants, je suis réservé. Comme vous, pourtant, je crois qu’il faut redéfinir les services (je l’avais proposé dans mon rapport sur les lycées en 1998). Comme vous également, je pense qu’il faut accompagner cette redéfinition d’une revalorisation des salaires. Comme vous, je suis convaincu qu’il faut mieux reconnaître ceux qui s’impliquent le plus : mais cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par des bonifications indiciaires (dont je ne suis pas certain que les professeurs soient demandeurs, d’ailleurs), mais peut s’effectuer par une valorisation symbolique (la possibilité d’être un peu déchargé pour aller expliquer à d’autres collègues, au sein de son Académie, ce que l’on a conduit, par exemple). Il conviendrait, au moins, dans un premier temps, que ceux et celles qui s’impliquent le plus ne fassent pas l’objet de suspicion ou de tracasseries de toutes sortes, cela serait déjà un vrai progrès ! Vous mettez, par ailleurs, le doigt sur la question de la multiplication des charges imposées aux enseignants : au risque de paraître en désaccord avec des collègues d’ Education et devenir, je partage votre analyse. C’est ce que me disent les enseignants que je rencontre et c’est ce qui ressort des nombreuses enquêtes dont nous disposons. Mon point de vue, néanmoins, c’est que ce ne sont pas ces charges elles-mêmes qui sont refusées, mais le fait qu’elles apparaissent trop déconnectées du “coeur du métier” et qu’elles ne viennent pas aider à ce qui fait sens pour l’enseignant (la transmission), mais lui donnent souvent le sentiment de l’en détourner. C’est pourquoi, dans ce livre, j’ai tenté de mener une démarche “phénoménologique” (excusez le pédantisme) en repartant de “l’intention d’enseigner” et en reconstruisant les “obligations” du métier à partir de là. J’ai bien conscience, comme on me l’ont fait remarquer, que je risque d’apparaître ainsi endosser les arguments des adversaires de toute évolution et les discours réactionnaires qui fleurissent un peu partout (de Marianne au Nouvel Observateur!). Mais il faut entendre ces discours, même s’ils ne nous font pas plaisir et même - évidemment – s’ils ne correspondent pas à ce qu’entendent les chefs d’établissement ouverts et attentifs à la pédagogie qui militent à Education et devenir. Ne pas les entendre serait dangereux : on ne peut transformer l’Ecole, en France, contre l’opinion publique (fut-elle très mal informée). Ne pas les entendre serait aussi un peu méprisant : nous ne pouvons pas vivre en permanence comme si nous avions toujours raison et si nous n’avions commis aucune maladresse. C’est pourquoi je crois que, sans renier nos convictions fondatrices, il faut se demander comment “transformer la pédagogie” et pas seulement comment “transformer l’École”. C’est pour n’avoir pas suffisamment réfléchi à cette question que notre système scolaire a été qualifié ainsi, récemment, par des visiteurs québécois : “Dans l’école, ça change tout le temps. Mais dans la classe, c’est toujours pareil.” Si nous prenons “le virage pédagogique”, je suis convaincu qu’il n’y a pas à désespérer. |
|
|
Je suis entièrement d'accord avec P. Meirieu concernant
l'écart qui existe entre l'idéal et le quotidien. En effet, l'un des
problèmes majeurs de l'enseignement, c'est que les décideurs, les
responsables, se situent loin de la réalité qotidienne de la classe ; on
assiste même un paradoxe pour le moins surprenant : plus on "fuit" les
élèves et mieux on est placé dans la sphère de l'enseignement et de
l'éducation, moins on côtoie les élèves et plus on a des chances de prendre
ders décisions concernant leurs études. Or, il est une vérité que tout un
chacun peut vérifier : rien ne peut marcher, rien ne peut réussir si on ne
tient pas compte de la réalité quotidienne de la classe. Miloud Belati,
Inspecteur pédagogique - Oujda Maroc |
|
| Je remercie vivement Miloud Belati de son témoignage. Je conçois bien la difficulté technique d’assurer en même temps des responsabilités administratives et un enseignement régulier devant des élèves. La proposition de Monsieur Belati est, à cet égard, un minimum exigible qui me paraît absolument fondamental. Mais, si je peux ajouter un élément tiré de mon expérience personnelle, je suis convaincu que, bien souvent, les responsabilités administratives entraînent ceux qui les exercent dans une spirale de l’action : il y a toujours quelque chose à faire, un problème à régler, une réunion à préparer, etc. Et, très vite, on est aspiré par des préoccupations légitimes mais qui font perdre de vue la pédagogie. Le fait de devoir assurer des enseignements joue ainsi un rôle d’hygiène mentale : cela oblige à interrompre un moment son travail de ruche, à suspendre les urgences pour retrouver l’essentiel. Pour moi, personnellement, qui suis toujours tenté de donner la priorité à l’urgence, l’obligation de se mettre régulièrement devant l’essentiel est particulièrement utile. | |
|
| Je suis
particulièrement sensible à cette contribution d’André Roux. Elle me semble,
en effet, placer le débat au bon niveau, avec cette alliance de solidarité
et de pensée critique propice à nous faire avancer ensemble. Je partage
complètement les positions d’André sur la question de l’évaluation et, sans
doute maladroitement, c’est à cela que j’appelais dans mon petit livre : une
réflexion critique et constructive sur tous les indicateurs d’évaluation au
sein des établissements et, plus généralement, au sein de l’Education
nationale. Sur la question des parents, je serai plus radical que lui : c’est justement parce que l’École est “une institution” et non “un service” qu’elle doit avoir une politique à l’égard des familles. “Un service” peut se contenter d’accueillir chaque famille, de l’écouter et de tenter de répondre à ses aspirations le mieux possible ; “une institution”, elle, se doit de mener une action délibérée pour mettre l’ensemble des familles (et pas seulement celles qui se manifestent spontanément) dans une position de partenaires actifs. Cela passe d’abord, à mes yeux, par une vraie politique d’information (et, sur ce point, je trouve que bien des établissements sont encore très déficients, se contentant de réunions rares et bâclées, de circulaires évasives ou peu respectueuses des personnes, de convocations en cas de problèmes graves, sans réflexion sur la déontologie nécessaire et les effets en cascade que l’on déclenche, etc.). Cela passe également par l’organisation de véritables occasions de travail commun avec toutes les familles, sur le projet d’établissement, mais aussi sur les outils de liaison, les procédures d’orientation, etc. Cela passe, enfin, par des actions communes sur des sujets qui concernent les parents et l’école et sur lesquels les uns et les autres ne peuvent être efficaces que s’ils sont solidaires (l’usage de la télévision, le travail à la maison, la lecture, l’autorité, etc.). Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour que, dans “l’institution école”, les parents soient considérés comme des “citoyens” et non comme des “clients”, c’est-à-dire impliqués et entendus comme de véritables co-éducateurs (pour reprendre l’expression de la loi de 1989), au lieu de se contenter de céder à la pression des plus bavards et des plus interventionnistes. Je sais que, sur ce point, nous sommes d’accord, André Roux et moi, et, je regrette, effectivement, que la lecture de mon livre puisse donner le sentiment inverse... Reste la question de “l’administration”. D’accord avec André pour dire que bien des personnes, en son sein et à tous les niveaux, ne sont pas du tout dans la posture “anti-pédagogique” que je dénonce et n’ont pas pour objectif d’empêcher les professeurs d’enseigner. Les bonnes volontés individuelles ne sont pas, ici, en question. En revanche, comme je l’avais développé au printemps dernier lors du colloque de l’Association française des administrateurs de l’Education (AFAE), il me semble que s’est développée une “culture administrative” dans l’Education nationale qui surdétermine les bonnes volontés individuelles. Nous assistons, de mon point de vue, à un “effet système” qui est impulsé par un ensemble de textes émanant de “la centrale”, soutenu par un fonctionnement institutionnel hiérarchique (encore très “monarchique”, en particulier au niveau du ministère, des rectorats et des inspections académiques) et par un exercice de l’autorité souvent déconnecté des finalités de l’institution... Et ces phénomènes sont amplifiés, dans l’imaginaire collectif des enseignants, par le fait qu’ils se sentent “mal aimés” et ont le sentiment que la gestion du système l’emporte sur ce qui leur paraît essentiel... Tout cela était, sans doute, inévitable en raison de l’extraordinaire “explosion scolaire” que nous avons eu à gérer ; les grands “administrateurs” qui s’y sont employés étaient particulièrement généreux (j’ai employé dans Le Monde de l’Education, l’expression “conflit de générosités” pour désigner ce malentendu entre “réformateurs” et “professeurs”). Mais je suis convaincu que ce temps est fini et qu’il faut, aujourd’hui, réfléchir à des changements forts dans les rapports entre les “cadres” de l’éducation et les “professeurs” : c’est là un grand chantier à mes yeux, et sur lequel Education et devenir a déjà apporté de belles contributions. Il faut, je crois, s’y atteler de manière encore plus volontariste. |
|