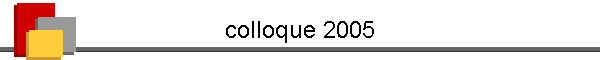
Nouveau site : http://www.educationetdevenir.fr/
Reportage et notes sur le colloque Ü
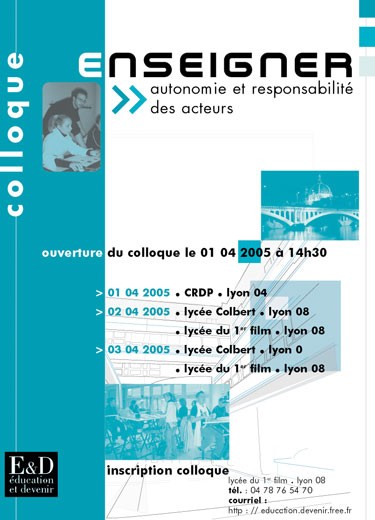 |
|
| Enseigner : autonomie et responsabilité des acteurs | |
| LOLF- loi d’orientation | |
|
LOLF, loi d'orientation et place des collectivités territoriales, directives européennes se partagent chacune entre enjeux positifs et risques de dérive. Quelles stratégies pédagogiques dans la classe et dans l'établissement ? Comment penser l'acte pédagogique dans ces nouveaux contextes ? Les libertés et les contraintes, les risques et les enjeux concernant les acteurs, les finalités...
|
|
| Problématique du colloque Þ | |
| Fiche d'inscription téléchargeable : format *.rtf (lisible sous Word, Open Office, Star Office...) ou format *.pdf (pour lire les fichiers pdf) | |
|
PROGRAMME INDICATIF |
|
| Vendredi 1er Avril | |||||
|
14 h 30 |
Accueil au CRDP 47, rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème(métro Hénon, ligne C) |
||||
|
15 h |
Ouverture par :
|
|
15 h 30 |
Conférences d’ouverture : |
|
Jean-Paul de Gaudemar Recteur
|
Enseigner dans les nouveaux contextes. |
|
A-M Drouin-Hans Université de Bourgogne |
Quel(s) homme(s) prépare-t-on pour demain ? |
|
19 h |
Réception
de la
Région Rhône-Alpes : discours d’accueil et buffet dînatoire
|
||
|
20 h 30 |
Assemblée Générale de l'association |
|
Samedi 2 avril |
au lycée Colbert, 20 rue Louis Jouvet Lyon 8ème (métro :Sans Souci, ligne D) | ||||||||||||
|
9 h |
Table ronde animée par J-C Boulu, Principal, avec
|
||||||||||||
|
11 h Philippe Meirieu Directeur de l'IUFM de Lyon |
Conférence de synthèse Les nouveaux enjeux |
 |
|||||||||||
|
13 h |
Repas au lycée du 1er Film, 14 rue du 1er Film, Lyon 8ème (métro Monplaisir Lumière, ligne D) |
||||||||||
|
14 h 30 |
Ateliers : | ||||||||||
Questions et propositions seront soumis à un grand témoin qui aura lui-même réfléchi à la problématique générale du colloque. |
|||||||||||
| 17 h-17 h 30 à 18h 18 h 30 |
Visites
:
|
||||||||||
| 19 h 30 |
Réception de la Ville de Lyon : discours d’accueil, soirée festive avec
la Fanfare à Mains Nues (Compagnie Traction Avant, Vénissieux).
|
||||||||||
 |
|||||||||||
| Dimanche 3 avril | au lycée Colbert, 20 rue Louis Jouvet Lyon 8ème (métro :Sans Souci, ligne D) |
|
9 h Claude Pair Recteur, ancien Directeur des Lycées
|
grand témoin
il répond aux questions des ateliers |
|
10 h 30 Françoise Clerc Professeure des Universités |
Conférence de conclusion : Liberté pédagogique et culture de résultats |
|
12 h |
Repas |
Photos de l'Office du tourisme de Lyon
 |
|
|
|||
|
|
n quelques décennies, sous la pression de facteurs divers le système éducatif français a subi de profondes mutations. Lentement mais de façon continue, depuis les années 70, les identités professionnelles changent sous l’effet croisé d’une série de facteurs : la nouvelle organisation des pouvoirs due à la décentralisation, les logiques économiques qui imposent d’évaluer le rapport entre l’efficacité et le coût des actions entreprises, l’émergence d’une demande de participation sociale et la nouvelle distribution des rapports entre le capital et le travail, la redéfinition des rapports de production au niveau mondial. Elles changent aussi en lien avec l’accélération et la variété des productions des connaissances, en réaction aux transformations des modes de validation dans un espace où la formation est aussi un marché. Les représentations idéologiques et le rapport aux valeurs évoluent aussi. Face à ces bouleversements, et au risque de dispersion, l'établissement scolaire est apparu comme le lieu dans lequel l'action éducative trouve sa cohérence. On perçoit là le sens même du projet d'établissement, tentative de définir une réponse locale aux objectifs nationaux, réponse qui tresse ensemble le travail pédagogique et éducatif, le fonctionnement de la démocratie interne (le maillage interne avec son système et ses sous-systèmes de délégations), le champ de la gestion et celui de l'organisation. Les établissements scolaires se sont enrichis de nouveaux et nombreux dispositifs. Depuis 1973 sont apparues régulièrement de nouvelles formes de diversification ou de pratiques inter ou co-disciplinaires auxquelles se sont adossées les tentatives de rénovation pédagogique. Citons les 10%, les PACTE, les PAE, les actions au titre du FAI, les modules, l’aide individualisée, les travaux croisés, les itinéraires de découverte, les PPCP, les TPE, les actions dans le cadre aujourd’hui de PASI…. ; mais aussi l’introduction des nouvelles technologies, à travers le plan informatique, les transformations de la discipline « technologie » (ex-enseignement manuel et technique ) en collège, et comme support à l’ensemble des enseignements professionnels, technologiques ou généraux. On peut regretter certaines lenteurs ; mais, comparé à d’autres secteurs de la vie économique, le système éducatif français n’est pas en retard et des changements féconds se sont greffés sur les éléments d’innovation. Par un mouvement continu depuis les années 70, les dispositifs assurant une plus grande participation des élèves et des parents et les pratiques visant l’apprentissage de la démocratie à l’école se sont étoffés. Pourtant on a pu constater que dans les établissements, ces changements n'avaient, la plupart du temps, affecté qu'en surface le fonctionnement de la classe et peu agi sur les processus d'apprentissage. On a pu dire que ces évolutions étaient restées à la périphérie, sous forme d'expérimentations, de projets innovants…La boîte noire de la classe, principe structurant de la professionnalité enseignante, résiste. L'espace et le temps se plient à sa force d'organisation.
ujourd'hui, ne semble-t-il pas que la transformation du paysage subisse une accélération inédite ?
L'Etat poursuit l'idée d'inscrire ses orientations pour le système éducatif dans un texte de loi, jusque et y compris dans certains détails des pratiques : diversification des parcours, modularisation des référentiels, individualisation des enseignements… L'objectif d'une Ecole de la réussite pour tous, au-delà de la difficulté à aboutir à un vrai consensus comme au-delà des débats sur les moyens, ne dessine-t-il pas un champ de responsabilités qui interroge chaque personnel de l'éducation quant à sa participation propre aux visées de cohésion sociale comme de prospérité économique ? L'évaluation de l'efficacité des actions entreprises est à l'ordre du jour en même temps que celle des compétences mise en œuvre. Avec la perspective de passer de l'obligation de moyens, que l'éducation partageait jusque là avec la médecine, à une obligation de résultats, ne voit-on pas se profiler un changement radical des procédures et du sens même de l'évaluation ? La Loi organique sur la loi des finances ne touche pas directement les établissements ; mais si sa logique était respectée, ne pourrait-on voir se décliner une méthode de conventionnement par projet ? Les collectivités territoriales prennent chaque jour une plus grande importance. Leur participation ou leur soutien aux projets des établissements se font chaque jour plus évidents tant par la mise à disposition de moyens, que par l'encouragement à l'innovation ou la mise en place de moyens de contrôle et d'évaluation des choix mis en œuvre. Ici ou là on les voit accompagner des dispositifs d'aide aux élèves, de nouvelles stratégies éducatives… La responsabilité des régions quant à la définition de la carte des formations et à la mise en œuvre de la formation professionnelle ouvre des champs entièrement nouveaux dont on ne mesure pas encore toutes les dimensions. En ce qui concerne la seule formation continue des adultes à travers le réseau des GRETA, ne peut-on constater que l'Education nationale et ses établissements publics d'enseignement se situent pleinement sur un marché concurrentiel et que l'obligation de résultats y représente d'ores et déjà un enjeu vital ? Ne peut-on imaginer que l'articulation indispensable entre l'offre et la forme de l'offre de formation en formation initiale et en formation continue soit de nature à provoquer des évolutions rapides dans les lycées technologiques et professionnels ? Et que la notion de socle commun associée à la notion de parcours personnalisé puisse entraîner une mutation dans les processus d'acquisition comme dans les modes de validation ? L'émergence de la " nouvelle économie de la connaissance " ne conduit-elle pas acteurs publics et sociaux à s’interroger sur les conditions dans lesquelles s’organisent la production et la transmission des connaissances, leur utilisation et leur renouvellement ? Le concept européen de formation tout au long de la vie qui fait déjà l'objet de nombreuses actions concrètes ne suppose-t-il pas une mise en cohérence de l'organisation de la formation initiale en segments de compétences mieux identifiés ? Il est certes encore confondu avec la seule modernisation de la formation continue mais pourtant n'amène-t-il pas à remettre en cause la vision traditionnelle de la spécialisation des temps de la vie et une autre imbrication du travail et de la formation ? L'établissement, pour faire face à toutes ces composantes, se transforme ; des fonctions nouvelles apparaissent, d'autres se consolident. Des tâches mieux identifiées ou nouvelles s'intègrent à la définition de la mission des enseignants (pilotage de niveau, de classes, de projets, encadrement, responsabilités logistiques, animation d’équipes, etc...) Les modes de direction se modernisent : les chefs d'établissement sont invités à pratiquer les audits, à organiser la réflexion, à faire des diagnostics, à construire des délégations en fonction des objectifs arrêtés avec les autorités de tutelle. L'établissement devient un espace de travail coopératif dans lequel des partenaires mieux identifiés peuvent construire une stratégie à partir d'un diagnostic partagé. Progressivement les établissements s'imposent en dépit des résistances un maillage fonctionnel qui permet une gestion plus démocratique mais aussi une réflexion collective sur les pratiques pédagogiques, réflexion jusqu'alors cantonnée au face à face entre le maître et son inspecteur. Au contraire les deux composantes de la hiérarchie de l'Education nationale se rapprochent dans une vision binoculaire sur le fonctionnement du local. L'établissement, espace de décision mieux reconnu, est conduit à prendre davantage en compte son autonomie, à mieux discerner ses potentialités, ses marges de manœuvre et à inscrire son projet dans la durée. Certes, les acteurs vivent parfois ces transformations comme une surcharge ou un éloignement de leur mission première, mais avec le temps n'assiste-t-on pas à une évolution des services. Les métiers récemment entrés dans le système ne transforment-t-ils pas peu à peu le paysage ? Les documentalistes sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand avec les dispositifs co-disciplinaires et les nouveaux travaux de recherche, les aides-éducateurs contribuent à repositionner les enseignants du côté de l’ingénierie pédagogique. Les CPE s’éloignent définitivement de leurs lointains ancêtres les « surgé » ; par niveau de classes, on les voit de plus en plus entrer dans le jeu des équipes pédagogiques, participer au processus d’orientation et au dialogue avec les familles. Les ATOS, avec l’action des régions en matière d’équipement et de gros travaux, sont conduits à prendre une part plus active à l’amélioration de l’environnement pédagogique et à l’espace de vie en général. Les ACMO dans les établissements technologiques apportent également un renouvellement de la prise en charge des problèmes par la communauté. La structure classe a résisté et reste un élément indispensable, mais la différenciation sous la forme de dispositifs « d’aide à côté de la classe », inaugurée en 1992, avec les modules, s'est soudain accélérée. En dépit d'un manque certain de lisibilité, la diversification actuelle de l’offre éducative (PPCP, TPE, IDD, Aide, ECJS, Heure de vie scolaire…) ne représente-t-elle pas un levier pour changer la relation pédagogique, pour réussir l'individualisation et permettre une meilleure réussite de tous ? N'est-elle pas une occasion de repenser la pression sur les horaires élèves, l’espace, ou le service des professionnels ? Ces nouveaux dispositifs qui sollicitent chez les élèves de nouvelles aptitudes, supposent aussi de nouvelles compétences pour les enseignants. N'entraînent-t-ils pas une obligation d'aller vers une plus grande professionnalisation des métiers de l'éducation et une responsabilité nouvelle pour l'établissement dans le cadre de l'accueil et de la formation des personnels ? Avec les réformes des marchés du travail et de la formation, l'Europe signifie pour certains une précarité accrue mais à la suite des orientations du mémorandum de Lisbonne, il s'agit pour nous de promouvoir la possibilité d'une mobilité positive vers de meilleurs emplois et de meilleures formations. La nouvelle harmonisation des diplômes universitaires, cette nouvelle perspective de vie active, où l’économie fait appel au développement des capacités humaines retentissent jusque dans la construction de nouveaux projets dans les classes.
Les "nouveaux contextes" que nous évoquons dans le titre de notre colloque, nous interpellent et interpellent l'enseignement, sur un plan culturel, social, philosophique. Quel nouveau rapport créatif entre le politique et le religieux ? La référence à la religion, entendue comme une représentation qui fait sens et cimente la société, n’opère plus comme par le passé. Mais ne peut-on en dire tout autant de la laïcité ? Les États se montrent souvent défaillants face aux tensions « désagrégatrices » de la société. Comment penser une confrontation du spirituel et du politique pour construire la "société" en Europe ? L'art n'a-t-il pas un cheminement à trouver vers l'émergence d'une identité européenne dans le monde ? Comment le politique peut-il stimuler un renouveau de la culture de réforme économique ? Sortir du défaitisme, du scepticisme devant des choix urgents de société ne suppose-t-il pas un engagement pour un nouveau type de croissance, soucieux d'un développement durable avec peut-être de nouveaux critères d’efficacité ? Ne doit-on pas imaginer la construction d'une société civile porteuse de projets, d’une éthique de participation inquiète de l'homme qu'elle fera advenir ? Face à l'incertitude du monde, saurons-nous inlassablement questionner, préparer un devenir plus démocratique, en nous ressourçant dans l'espérance d'un monde toujours meilleur ? On voit bien que l'ensemble de toutes ces déterminations qui brossent incomplètement les nouveaux contextes ne sont pas des sujets pour experts mais bien des questions qui habitent notre quotidien et mettent en perspective l'avenir de l'école. La boîte noire s'entrouvre sous l'effet d'une force centripète reconduisant toutes ces questions vers la relation éducative elle-même, et singulièrement vers notre responsabilité d'enseignant.
v |