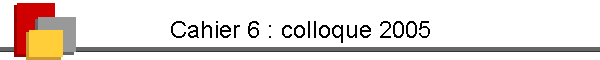
Nouveau site :
Pour se procurer les cahiers :
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?rubrique5
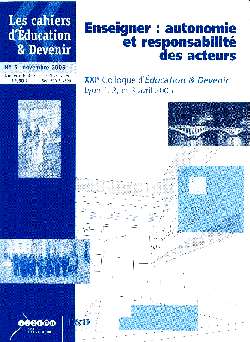 |
Problématique et |
Les cahiers d'Éducation & Devenir - N° 6 nouvelle série n° double
Enseigner : autonomie et responsabilité des acteurs Colloque de Lyon, 1,2, 3 avril 2005 |
| voir aussi reportage et notes sur le colloque | ||
| PROBLÉMATIQUE | |||
| Extraits |
n quelques décennies, sous la pression de facteurs divers le système éducatif français a subi de profondes mutations. Lentement mais de façon continue, depuis les années 70, les identités professionnelles changent sous l’effet croisé d’une série de facteurs : la nouvelle organisation des pouvoirs due à la décentralisation, les logiques économiques qui imposent d’évaluer le rapport entre l’efficacité et le coût des actions entreprises, l’émergence d’une demande de participation sociale et la nouvelle distribution des rapports entre le capital et le travail, la redéfinition des rapports de production au niveau mondial. Elles changent aussi en lien avec l’accélération et la variété des productions des connaissances, en réaction aux transformations des modes de validation dans un espace où la formation est aussi un marché. Les représentations idéologiques et le rapport aux valeurs évoluent aussi. Face à ces bouleversements, et au risque de dispersion, l'établissement scolaire est apparu comme le lieu dans lequel l'action éducative trouve sa cohérence. On perçoit là le sens même du projet d'établissement, tentative de définir une réponse locale aux objectifs nationaux, réponse qui tresse ensemble le travail pédagogique et éducatif, le fonctionnement de la démocratie interne (le maillage interne avec son système et ses sous-systèmes de délégations), le champ de la gestion et celui de l'organisation. [...] Pourtant on a pu constater que dans les établissements, ces changements n'avaient, la plupart du temps, affecté qu'en surface le fonctionnement de la classe et peu agi sur les processus d'apprentissage. On a pu dire que ces évolutions étaient restées à la périphérie, sous forme d'expérimentations, de projets innovants…La boîte noire de la classe, principe structurant de la professionnalité enseignante, résiste. L'espace et le temps se plient à sa force d'organisation.
ujourd'hui, ne semble-t-il pas que la transformation du paysage subisse une accélération inédite ?
L'Etat poursuit l'idée d'inscrire ses orientations pour le système éducatif dans un texte de loi, jusque et y compris dans certains détails des pratiques : diversification des parcours, modularisation des référentiels, individualisation des enseignements… L'objectif d'une Ecole de la réussite pour tous, au-delà de la difficulté à aboutir à un vrai consensus comme au-delà des débats sur les moyens, ne dessine-t-il pas un champ de responsabilités qui interroge chaque personnel de l'éducation quant à sa participation propre aux visées de cohésion sociale comme de prospérité économique ? L'évaluation de l'efficacité des actions entreprises est à l'ordre du jour en même temps que celle des compétences mise en œuvre. Avec la perspective de passer de l'obligation de moyens, que l'éducation partageait jusque là avec la médecine, à une obligation de résultats, ne voit-on pas se profiler un changement radical des procédures et du sens même de l'évaluation ? [...] L'établissement, pour faire face à toutes ces composantes, se transforme ; des fonctions nouvelles apparaissent, d'autres se consolident. Des tâches mieux identifiées ou nouvelles s'intègrent à la définition de la mission des enseignants (pilotage de niveau, de classes, de projets, encadrement, responsabilités logistiques, animation d’équipes, etc...) Les modes de direction se modernisent : les chefs d'établissement sont invités à pratiquer les audits, à organiser la réflexion, à faire des diagnostics, à construire des délégations en fonction des objectifs arrêtés avec les autorités de tutelle. L'établissement devient un espace de travail coopératif dans lequel des partenaires mieux identifiés peuvent construire une stratégie à partir d'un diagnostic partagé. [...] Certes, les acteurs vivent parfois ces transformations comme une surcharge ou un éloignement de leur mission première, mais avec le temps n'assiste-t-on pas à une évolution des services. Les métiers récemment entrés dans le système ne transforment-t-ils pas peu à peu le paysage ? [...] La structure classe a résisté et reste un élément indispensable, mais la différenciation sous la forme de dispositifs « d’aide à côté de la classe », inaugurée en 1992, avec les modules, s'est soudain accélérée. En dépit d'un manque certain de lisibilité, la diversification actuelle de l’offre éducative (PPCP, TPE, IDD, Aide, ECJS, Heure de vie scolaire…) ne représente-t-elle pas un levier pour changer la relation pédagogique, pour réussir l'individualisation et permettre une meilleure réussite de tous ? [...]
Les "nouveaux contextes" que nous évoquons dans le titre de notre colloque, nous interpellent et interpellent l'enseignement, sur un plan culturel, social, philosophique. [...]
Face à l'incertitude du monde, saurons-nous inlassablement questionner, préparer un devenir plus démocratique, en nous ressourçant dans l'espérance d'un monde toujours meilleur ? On voit bien que l'ensemble de toutes ces déterminations qui brossent incomplètement les nouveaux contextes ne sont pas des sujets pour experts mais bien des questions qui habitent notre quotidien et mettent en perspective l'avenir de l'école. La boîte noire s'entrouvre sous l'effet d'une force centripète reconduisant toutes ces questions vers la relation éducative elle-même, et singulièrement vers notre responsabilité d'enseignant. |
||
| Accueil | ||||
| Yves Grellier, directeur du CRDP de Lyon | ||||
| Ouverture du colloque | ||||
|
Alain Morvan, recteur de l'académie de Lyon |
|||
|
José Fouque, président d'Éducation & Devenir | |||
| Conférences d'ouverture | ||||
|
Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'académie d'Aix-Marseille |
|||
|
Anne-Marie Drouin-Hans, maître de conférence, université de Bourgogne | |||
| Table ronde | ||||
| Enseigner et piloter dans le système éducatif, demain | ||||
| animateur : Jean-Claude Boulu, principal du collège Victor Grignard, Lyon | ||||
|
Contributions à la table ronde |
||||
|
Béatrice Ricard, professeur de sciences physiques, académie de Lyon | |||
|
Robert Thollot, professeur de sciences économiques et sociales, académie de Lyon | |||
|
Synthèse de la table ronde |
||||
|
Philippe Meirieu, directeur de l'lUFM de Lyon | |||
| Ateliers | ||||
|
Académie de Rouen | |||
|
Académie d'Aix-Marseille | |||
|
Académie de Dijon | |||
|
Académie de Grenoble | |||
|
Académie de Lyon | |||
|
Contributions aux ateliers |
||||
|
Ø Claude Pair, ex-recteur de l'académie de Lille et auteur du rapport : « Faut-il réorganiser l'Éducation nationale ?» Ø Jean Yves Langanay, IPR - IA, académie de Lyon Ø Claude Rebaud, proviseur, académie de Lyon |
|||
|
Erik Louis, IA - DSDEN de l'Eure | |||
|
Jean-Pierre Cuvelier, IA - DSDEN de la Nièvre | |||
| Claude Pair | ||||
| Conférence de conclusion | ||||
|
Françoise Clerc, professeur à l'université, Lyon | |||
| Conférence de Philippe Meirieu | |
| Extraits |
Vous résistez ! Il faut savoir résister mais il faut savoir aussi que nous avons perdu. Nous avons politiquement perdu sur à peu près toutes Les valeurs que nous portons, non pas depuis 1981 mais depuis la création de l'institut Jean-Jacques Rousseau en 1901 par Edouard Claparède à Genève. Inventorions les différents points sur lesquels nous avons perdu. Nous avons perdu sur la mise en place d'une pédagogie différenciée au sein de la classe avec une organisation souple du temps, avec une capacité à installer un vrai tutorat auprès des élèves. Nous avons perdu au profit de la linéarité taylorienne, au profit du « plus de la même chose » pour ceux qui n'en veulent déjà pas. Nous avons aussi perdu sur l'hypothèse généreuse d'un lien fort entre les savoirs et la culture qui, aujourd'hui, est battu en brèche par l'idéologie du socle commun. Le socle pour tout le monde, oui, mais pas la statue. Nous allons voir nos élèves se promener comme des socles. Ce seront de beaux socles, mais, au-delà, que vont-ils porter ? Nous avons perdu au regard même des conceptions de l'apprentissage sur lesquelles nous travaillons depuis si longtemps. Nous avons perdu la notion de sens au profit de celles de répétition (à traduire par redoublement), d'évaluation (systématique, de performance. Nous avons également perdu sur cette conception fondatrice que c'est par la culture qu'on accède aux savoirs. L'idée de socle n'est qu'une autre façon de revenir au vieux lieu commun de «bases» dont toute la recherche en éducation tente de se débarrasser depuis plus d'un siècle. Les bases n'existent pas, les élèves en difficulté ont besoin d'un haut niveau d'exigences culturelles, de textes et d'enjeux culturels forts ; ils n'ont pas besoin éternellement qu'on leur répète qu'ils n'ont pas acquis les bases. Nous avons perdu dans le domaine de la démocratie lycéenne : rien dans la loi sur cette question. Nous avons perdu dans le domaine de la démocratie au sein des établissements même si quelques déclarations d'intentions et quelques courageuses prises de position d'un député de la majorité, Pierre Henri Périsol, ont permis d'introduire dans la loi un certain nombre d'éléments sur la place des parents. […] Nous avons perdu sur la construction du rapport aux savoirs. À cet égard, la suppression des TPE en terminale reste à mes yeux, plus qu'une erreur ou une faute, le signe réel d'une volonté de changer radicalement le paradigme éducatif qui est celui sur lequel nous nous battons depuis un siècle. […] les TPE ont été supprimés parce qu'il fallait punir symboliquement un certain type de rapport aux savoirs et qu'il fallait restaurer démagogiquement une certaine conception de l'autorité des enseignants, conception qui est le contraire de ce à quoi nous voulons par ailleurs former le citoyen, à savoir la démocratie. Nous avons perdu sur la notion de sanction par l'introduction inique de la notion de sanction collective, contraire au droit, par l'assimilation du travail supplémentaire à la sanction… |
| Le grand témoin : Claude Pair | |
| Extraits |
Le colloque a été construit de manière très soigneuse... dans une belle perspective « descendante », top-down disent les Anglo-saxons, du sommet à la base, du plus loin au plus près, du contexte global puis ministériel aux collectivités territoriales, à l'établissement et enfin aux personnels. Je note malicieusement le contraste avec l'autonomie et la responsabilité de ces acteurs : peut-être aurait-on pu attendre l'inverse, une démarche « ascendante », bottom-up, qui retourne la pyramide sur sa pointe, comme le proposait le rapport « Centrale 2000 » écrit en 1993 sous la direction de Céline Wiener. Il est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus très sûr que l'élève soit au centre du système, et il n'y a donc plus de raison pour que l'établissement se trouve au cœur de l'organisation ! Mais je persifle abusivement : il ne s'agit que de la construction intellectuelle du colloque et nos habitudes cartésiennes incitent à cheminer du général au perticulier sans pour autant impliquer que, sur le fond, nous serions d’accord avec un pilotage hiérarchique descendant. |
| Liberté pédagogique et culture de résultats | |||||||
| Extraits |
Tout d'abord, il faut remarquer qu'il existe, au-delà de son apparente évidence, un non-dit du titre de la conférence. « Liberté pédagogique et culture de résultats» peut se décliner au moins de trois façons :
Ces deux raisonnements, dans Le cas le plus favorable, n'entraînent aucune gratification, dans le cas le plus défavorable provoquent une suspicion des évaluateurs, une culpabilisation des évalués.
Ce dernier raisonnement revient à externaliser la responsabilité sur le système. Il constitue la réponse la plus efficace au raisonnement précédent. Il correspond exactement ce que tout professionnel est enclin à dire dès lors qu'il n'est pas dans un rapport de confiance avec l'organisation qui l'emploie. Invoquer le manque de moyens, le poids de l'Inspection, le manque de motivation des enfants, l'hostilité des parents, l'incompréhension de la société, est une stratégie gagnante à tous les coups. Poser le problème en termes de liberté et d'obligation de résultats ne peut déboucher que sur un blocage : démontrer que l'on n'est pas libre tout en revendiquant une plus grande liberté constitue la défense la plus efficace contre l'obligation de résultats. Si le politique passe outre, il est considéré comme déraisonnable et persécuteur. |
||||||