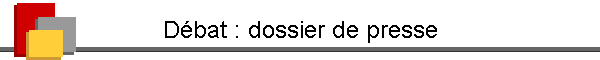
Nouveau site :
|
Ce dossier de presse essaye de refléter - partiellement sans doute, avec des choix qu'on peut juger arbitraires - le débat sur l'école. L'ordre chronologique est inversé. Les articles cités ne donnent bien sûr pas la position d'E&D. |
NB Vu l'importance du débat sur la lecture (aussi bien en volume qu'en enjeux politiques et idéologiques) un dossier de presse spécifique est ouvert.
|
Darcos réforme la seconde
|
Extraits Pour le Sgen-CFDT, deuxième syndicat d'enseignants du secondaire, il s'agit d'«une réformette». Pour les parents d'élèves de la FCPE, «d'un rendez-vous raté». Tandis que l'UNL, premier syndicat lycéen, fustige «un gloubi-boulga sans nom». l'ambitieux projet «modulaire» qui devait permettre aux lycéens de valider leurs semestres au terme d'un «parcours personnalisé» paraît compromis... Programmée dès la rentrée 2009, la «seconde» new look dessinée par Darcos proposera - sans grande surprise - des enseignements généraux, des matières à option et de l'aide individualisée. La semaine, qui devait être raccourcie, comptera presque autant d'heures de cours qu'aujourd'hui. Xavier Darcos le reconnaît : «Nous sommes revenus à quelque chose peut-être un peu plus raisonnable que ce que (...) dans des moments d'imagination on aurait pu faire.» A cette timidité dans la réforme, une explication : le Snes, premier syndicat de l'enseignement secondaire, était opposé à tout changement. Aujourd'hui, après avoir joué des muscles en coulisses, il pavoise. Pourtant cette «réformette», si quelconque en apparence, enfonce plusieurs coins dans le système actuel. Le tutorat d'abord. Il devrait éviter à l'élève d'être largué. «Il va falloir l'aider à s'organiser, lui donner des conseils de méthode, mieux le prendre en compte», anticipe un prof de maths. Aujourd'hui, 15% des élèves de seconde redoublent. Grâce au soutien individuel, cette proportion devrait diminuer. A la rentrée 2009, outre les matières du tronc commun, l'élève de seconde pourra choisir deux enseignements pour le premier semestre. Et en élire deux autres au semestre suivant. Cette démultiplication des choix (quatre dans l'année, au lieu de deux aujourd'hui) va lui permettre de construire un parcours un peu original. Pas un mot sur les futures classes de première et de terminale qui seront modifiées en 2010 et en 2011. Que nous réservent les prochaines étapes de l'aggiornamento lycéen ? Nel Obs hebdo 30/10/08 |
Le nouveau lycée
|
Extraits La piste de travail actuellement privilégiée par le "Monsieur Réforme du lycée" -le recteur d'Aix-Marseille, Jean-Paul de Gaudemar- consiste à bâtir un tronc commun pour tous les élèves dans lequel on trouverait lettres, maths, histoire-géo, deux langues vivantes et sport. A ce jour, la physique-chimie, l'éducation civique et les sciences naturelles ne font donc plus partie des enseignements obligatoires. Pas plus que l'économie, déjà exclue par une précédente réforme contestée. Ce tronc commun devrait représenter 60% des cours. Le reste sera divisé en deux types de modules, les "exploratoires" (25% du total) et ceux "d'accompagnement" (15%). L'année scolaire sera découpée en deux semestres au lieu de trois trimestres. A la fin du premier semestre, les élèves pourront changer de module, ce qui constitue une révolution: la fin du programme figé pour l'année entière. La suppression du redoublement. Chaque année, 15% des lycéens de seconde redoublent. "L'idée est que les élèves en difficulté dans tel domaine se renforcent lors du second semestre par le jeu des modules, explique le cabinet de Xavier Darcos, et que le redoublement devienne anecdotique." Vingt-sept heures pour tous. Tel devrait être, de la seconde à la terminale, le nouveau volume horaire hebdomadaire de tous les lycéens des filières générales. Actuellement, les élèves ont entre vingt-huit et trente-cinq heures de cours. La fin des filières, la fin des maths obligatoires. Les élèves de première et de terminale disposeront eux aussi d'un enseignement découpé en trois. La proportion actuellement retenue est de 45% (tronc commun), 45% (modules exploratoires), 10% (modules d'accompagnement). L'histoire-géographie et les mathématiques disparaîtraient du tronc commun mais pas la philo, qui pourra être débutée (en option) dès la première. Un élève pourrait donc ne plus faire de maths après la seconde ! Quant aux filières scientifique (S), économique et sociale (ES) et littéraire (L), trop déséquilibrées (surfréquentation en S, pénurie en L) et injustes socialement (les enfants des familles les plus favorisées sont largement majoritaires en S, qui ouvre toutes les portes), elles tombent aux oubliettes. Quatre "dominantes" (humanité et arts, sciences, sciences de la société, technologie) les remplaceront plus souplement grâce au principe des modules (dont le droit, autre nouveauté) interchangeables en cours d'année. Journal du dimanche 05/10/08 |
La formation des maîtres prise dans le tourbillon des réformes de Darcos
|
Extraits Comme hier l’école primaire et demain le lycée, la réforme de la formation des enseignants se fait à la hussarde. En avril dernier, Nicolas Sarkozy annonce à la télévision qu’il va demander «la mastérisation des jeunes enseignants pour les payer davantage». Comme toutes les réformes voulues par Nicolas Sarkozy, la «mastérisation» ne peut attendre. Elle entrera donc en application dès la rentrée 2009, annonce le ministre de l’Education. L’Education nationale, l’employeur, se charge de la réforme des concours. L’Enseignement supérieur mettra au point les nouveaux masters. Mais comme les universités sont appelées à devenir autonomes, ce sont elles qui vont s’y mettre. Et que deviennent dans tout cela les IUFM qui, la première année, préparaient les étudiants aux concours, puis la seconde année, leur donnaient une formation plus professionnelle ? Ils vont devoir coopérer avec les universités. Il est clair que les IUFM, bastion du «pédagogisme» honni par les «déclinistes» et la droite en général, sont désormais menacés de disparition. Sur le fond, les syndicats sont divisés. Certains veulent des garanties sur la dimension professionnelle de la formation - avec des modules et des stages prévus dans le master et des épreuves au concours. D’autres, au contraire, réclament que le niveau disciplinaire soit privilégié. |
Formation : il faut tout changer, dit la Cour des comptes
|
Extraits Dans son rapport, la Cour des comptes propose une "mutualisation" plus importante des fonds considérables de la formation professionnelle, qui représentaient pour l'année 2006, quelque "34 milliards d'euros". Les magistrats dénoncent des "circuits financiers (...) excessivement cloisonnés et peu contrôlables" et relèvent le nombre trop important d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), évalué à une centaine. Derrière la critique, c'est tout le fonctionnement d'un système qui est pointé du doigt : nombre de ces organismes de collecte sont suspectés de contribuer au financement du paritarisme et des organisations patronales, CGPME en tête. Le rapport évoque la possibilité que "la collecte des fonds de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage soit transférée à un organisme unique voire, aux Urssaf". Une solution qui séduit le gouvernement mais inquiète les partenaires sociaux. Dans des rapports précédents, les magistrats avaient dénoncé, concernant la gestion des organismes collecteurs, "des dépenses de personnel trop généreuses", des rémunérations et des indemnités "confortables" ou encore des "coûts informatiques mal maîtrisés". Les magistrats proposent aussi la création de "fonds régionaux pour la formation tout au long de la vie" dans lesquels seraient présents l'Etat, la région et les partenaires sociaux. Ils y décideraient des "actions prioritaires" de formation ou "présentant un intérêt régional marqué". Des inégalités. Le taux d'accès des demandeurs d'emploi à la formation professionnelle est de 13 %, contre 34 % pour les salariés. A partir de 45 ans, le taux d'accès est très faible : moins de 15 %. De même, les femmes accèdent moins à la formation que les hommes (écart de 4 points). Enfin, la formation va aux formés : un diplômé du supérieur sur deux a suivi une formation contre un qualifié sur dix. Les PME désavantagées. Les entreprises versant le plus sont celles qui s'en servent le moins : les "2 000 salariés et plus" versent 11,3 % des fonds levés par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et en dépensent 15,3 %. Les "moins de 10" versent 13 % des contributions pour 12 % dépensés. Les "10 à 199 salariés" contribuent à 49,6 % et n'en perçoivent que 46,5 %. |
Injuste régulationAgnès van Zanten directrice de recherche au CNRS |
Extraits La carte scolaire, créée au début des années 60 pour accompagner la démocratisation de l’enseignement secondaire, visait à réguler l’offre et de la demande scolaires. Elle a aussi permis un certain brassage social. Il s’agit néanmoins d’un outil imparfait dont les limites ont été accentuées par les changements scolaires et sociaux des quarante dernières années. Ainsi, ce mode de régulation, qui ne s’applique qu’aux établissements publics, a permis aux établissements privés de jouer un rôle de recours et ce de façon plus intense avec le développement d’un rapport plus instrumental à l’école des usagers et d’une offre privée «sur mesure». Cet instrument a perdu en efficacité avec le renforcement de la ségrégation urbaine en haut et en bas de l’échelle sociale. Le système de carte scolaire s’appliquant exclusivement au secteur public, aveugle aux différences territoriales et avec des possibilités variables de dérogation doit donc être réformé. Les travaux conduits à l’étranger montrent une forte corrélation entre libre choix, ségrégation scolaire et inégalités entre établissements. Le dispositif mis en place par Xavier Darcos à la rentrée 2007 se situe dans la continuité des expériences antérieures d’assouplissement en produisant les mêmes effets mais avec deux changements majeurs. Le premier concerne l’impulsion forte donnée par le gouvernement. Elle s’est traduite par une augmentation sensible des demandes de dérogation et surtout de leur taux de satisfaction par les autorités locales, accentuant la fuite des établissements les moins réputés et renforçant les déséquilibres démographiques et les ségrégations. Le second est l’importance nouvelle accordée au critère de «boursier». Cette mesure pourrait se rapprocher des systèmes de quotas mis en place au nom de l’équité dans certains systèmes scolaires. Mais ce critère n’a pas été appliqué de façon systématique. Surtout, il accentue le problème des inégalités entre établissements. En effet, les boursiers qui bénéficient de l’assouplissement de la carte sont essentiellement de bons élèves. Leur départ a des conséquences négatives pour les établissements dont ils sont issus. Libé 30/09/08 Voir aussi : Un remède pire que le mal |
Contrer l’échec scolaireUn réseau d’étudiants, l’AFEV, lance aujourd’hui la première journée destinée à lutter contre ce fléau qui touche un élève sur quatre.
|
Extraits Prenez cent enfants. Parmi eux, vingt-six ne comprennent pas ce qu’on leur demande en classe. Éloquent, ce chiffre est l’un de ceux qui ressortent du baromètre présenté aujourd’hui par l’AFEV. Ce réseau d’étudiants bénévoles, qui lutte depuis 1991 contre les inégalités d’apprentissage, est à l’initiative de la première journée du refus de l’échec scolaire. De la même façon qu’ATD Quart-monde - partenaire de l’initiative - a fait du refus de la misère un mot d’ordre national, l’AFEV espère ainsi placer l’exclusion scolaire au centre des préoccupations de l’opinion et des pouvoirs publics. « Plus de 150 000 jeunes quittent chaque année l’école sans rien », rappelle Christophe Paris, son directeur. « Quand on mesure l’importance de ce chiffre et l’impact qu’il aura tout au long de leur vie, on ne supporte pas. On refuse. » « L’école n’assume pas les élèves en difficulté », assène Gabriel Cohn-Bendit. Pédagogue avant-gardiste et médiatique, celui qui lança le premier lycée autogéré, à Saint-Nazaire, a été choisi comme parrain de cette première journée. Féroce avec sa propre corporation - « beaucoup trop de profs refusent de voir ce qui pèche dans leurs propres pratiques » - il l’est également avec l’institution. « En ignorant, dans sa manière de faire, les inégalités qui persistent dans notre société, elle contribue à creuser les écarts. »L'Humanité 24/09/08 Voir aussi le baromètre de l’AFEV sur le rapport à l’école des enfants des quartiers populaires. |
Entre les MursDaniel Pennac: "La violence d'apprendre"Ancien enseignant, l'auteur de Chagrin d'écolea vu le film de Laurent Cantet. Il a aimé. Et dit pourquoi. |
Extraits "Formidable, ce film! D'abord par le jeu des élèves et des professeurs (Ah, Souleymane ! Ah, Esmeralda ! Ah, Khoumba ! Ah, M. Marin - François Bégaudeau - quels acteurs ! Et la mère de Souleymane, donc !). Ensuite par l'incroyable intensité du récit. Et, enfin, parce que le tout atteint ce rendu de fiction vraie que devait rechercher Laurent Cantet. Le spectateur est plongé tout vif dans cette classe où tout est rendu au plus près. Nous sommes dans une classe particulière, avec des problèmes bien à elle, et j'ai visité nombre d'établissements dont la composition sociologique était la même mais le comportement des élèves très différent, parce que l'équipe pédagogique s'y prenait, avec eux, autrement. Malgré cette effroyable cacophonie, le film révèle les invariants de la confrontation élève-enseignant, quelle que soit l'époque, quel que soit le milieu social : rechercher les limites du professeur, souligner ses contradictions, lui demander de justifier l'utilité du savoir, marquer en permanence le hiatus entre ce qui est enseigné et ce que l'élève affirme être le réel. Tout cela dit la violence intrinsèque à la nécessité d'apprendre et à l'obligation d'instruire. La difficulté du métier de professeur tient à ce choc perpétuel entre l'ignorance qui veut s'ignorer et le savoir toujours perçu comme venant d'ailleurs. Très violent, ici, le choc, entre ces murs, très ! L'art d'enseigner consiste sans doute à transformer cette violence en désir. L'Express 17/09/08 |
« La vraie motivation se construit dans le plaisir d’apprendre »Une idéologie de la mise en concurrence et de l’humiliation, dénonce Philippe Meirieu |
Extraits La politique du gouvernement remet à l’honneur des recettes en vigueur à l’époque où, nous dit-on, l’école fonctionnait bien. Elle part du principe que c’est en réimportant ces recettes que l’on créera de la réussite. Or c’est faux. D’abord, parce que cette fameuse réussite n’était autre que de la sélection : l’école que l’on nous vante était réservée à une minorité, et seulement 15 % à 20 % des enfants accédaient au collège. Ensuite, parce que ce n’est pas en glissant vers une folklorisation de l’école qu’on la démocratisera. La véritable motivation se construit dans le rapport au savoir, quand l’élève parvient à trouver du plaisir à apprendre. Les élèves des milieux populaires n’ont pas besoin d’une médaille pour vouloir le bac : ils le veulent. Ce n’est pas un gadget à caractère nostalgique qui leur permettra de le décrocher, mais un effort particulier porté à l’éducation et une transformation profonde des pratiques pédagogiques. Faisons une comparaison sportive. En judo, passer une ceinture noire est un rite difficile, exigeant, auquel certains accèdent et d’autres pas. Mais il est fondé sur le fait que tout le monde peut y accéder, s’y préparer et être soutenu. Le système n’est pas organisé sur la sélection mais sur la promotion. Et sur un tatami, on respecte le jeune qui échoue. Je crois à l’exigence et à la nécessité de rites de reconnaissance, à condition qu’ils n’impliquent pas l’exclusion et l’humiliation du perdant. Je ne suis hostile ni à la morale, ni à l’exigence, ni à la responsabilisation individuelle. Toutes participent de la formation du citoyen. Je m’inquiète en revanche de cette tendance à transformer les victimes en coupables. Cette injonction à la morale individuelle exonère la société de toute responsabilité collective. On peut demander aux jeunes de se prendre en main. Mais c’est tout de même plus facile quand on a une chambre pour travailler, un ordinateur pour accéder à Internet, que l’on vit dans un quartier tranquille et que l’on bénéficie de cours dédoublés, voire particuliers. L'Humanité 16/09/08 |
Bientôt une médaille pour les bacheliers ?
|
Extraits Dans un entretien au Parisien Dimanche, le ministre de l'Education estime «important que l'obtention du bac puisse être valorisée». «Nous envisageons même que les bacheliers puissent recevoir une médaille! Elle serait de couleur différente, peut-être sur le mode des médailles sportives, or, argent, bronze, selon la mention obtenue». «Il s'agit de reconstituer des rites, des modes de reconnaissance, donner un peu de solennité aux récompenses», a commenté M. Darcos pour qui «le mérite est aussi personnel». «Je ne suis pas un nostalgique, je suis résolument moderne», s'est défendu le ministre, parlant d'une «attitude pédagogique qui n'a rien de réactionnaire». «Ce n'est pas du tout une demande des lycéens», a affirmé Florian Lecoultre, président de l'UNL, premier syndicat lycéen. «C'est du bling-bling, c'est insignifiant. On peut multiplier les annonces inutiles comme celle-là, reste que pendant ce temps on ne s'attaque pas aux vrais problèmes», comme le fait que le bac est devenu un examen de «bachotage», a-t-il ajouté. «Il y a d'autres priorités à l'heure actuelle pour l'Education nationale». Daniel Robin (Snes-FSU) soupire: «c'est pathétique et dérisoire qu'un ministre de l'Education consacre son temps à faire des annonces de cette nature alors qu'il y a bien d'autres problèmes à régler. Tout ça c'est un coup de bling-bling». «Et pourquoi pas une médaille en chocolat pour les bacheliers obtenant leur bac au rattrapage», a ironisé Thierry Cadart (Sgen-CFDT), parlant de mesure «complètement déphasée renvoyant à une vision de la société particulièrement rétrograde». Le Figaro 14/09/08 Voir aussi : Revers de la médaille |
La carte scolaire assouplie «n'est pas un gage de mixité»
|
Extraits D'une rentrée sur l'autre, les demandes de dérogations en lycées et collèges ont augmenté de 17%, pour atteindre le chiffre 115 003, dont 86 668 ont été accordées. Pour la sociologue Agnés Van Zanten, directrice de recherche au CNRS et auteur du «Que sais-je ?» (PUF) sur la carte scolaire, cela ne change rien à l'absence de mixité sociale dans les établissements. Pour que cela soit le cas, il faudrait que les classes modestes demandent elles aussi massivement des dérogations, ce qu'elles ne font pas. Changer de collège, c'est aller dans un établissement plus éloigné, ce qui entraîne un coût de transport supplémentaire, mais aussi des frais de cantines. Certaines familles, notamment immigrées, considèrent que la proximité de leurs enfants est un élément important pour contrôler leur éducation. Surtout les familles de classe moyenne, comme les enseignants, les journalistes, qui accordent une grande importance à la scolarité de leur enfant mais qui n'habitent pas forcément près des meilleurs établissements [profitent de cet assouplissement]. A la marge, il y a également une petite fraction de familles modestes dont les enfants sont bons élèves. Certains chefs d'établissement en sont arrivés à trier leurs élèves. Parallèlement, il y a un risque que certains établissements de quartiers soient décapités, sans «tête de classe» puisque les meilleurs s'en vont. A l'étranger, il y a des exemples intéressants. Londres mène ainsi une politique de quotas : dans chaque établissement, il est prévu de scolariser 1/3 de bons élèves, 1/3 de moyens, 1/3 de mauvais. L'exemple belge est aussi intéressant, les chefs d'établissement d'une même région se mettent d'accord entre eux pour qu'aucun établissement ne soit lésé. Ce qui est sûr, c'est que la France ne doit surtout pas éliminer tout contrôle de la carte scolaire. Le Figaro 02/09/08 |
Principaux et proviseurs, chefs d’orchestre de la rentrée
|
Extraits De plus en plus sollicités par les parents et les pouvoirs publics qui « exigent » des résultats, les chefs d’établissement deviennent de véritables managers. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Anne Barrère, professeur à l’université Lille III, a choisi « Les Managers de la République » comme sous-titre de son ouvrage sur la Sociologie des chefs d’établissement (1). « Ils se trouvent désormais en tension entre deux objectifs : d’une part, celui des valeurs républicaines et de l’égalité des chances ; d’autre part, celui d’une modernité de l’organisation, avec, pour maître mot, le “pilotage par les résultats”. La formation qui leur est dispensée au sein de l’École supérieure de l’éducation nationale tend à faire d’eux de véritables cadres, dans une logique de rupture avec l’identité enseignante », analyse la chercheuse. « Parallèlement, en quelques décennies, sur fond de décentralisation, les politiques publiques ont fait des chefs d’établissement le relais des réformes. Eux qui avaient un rôle essentiellement administratif interviennent de plus en plus sur le terrain pédagogique, compris au sens large » Une évolution qui donne parfois lieu à des conflits. Certains professeurs contestent en effet le lien hiérarchique qui, selon les textes, les unit à leur principal ou à leur proviseur, estimant qu’ils n’ont de comptes à rendre qu’à leur inspecteur, qu’ils ne voient généralement qu’une fois tous les trois ou cinq ans… À ces attentes grandissantes, tant de la part des parents que des pouvoirs publics, les principaux et les proviseurs tentent de répondre par un « effet établissement ». « On parle même de “plus-value” ou de “moins-value” selon que les résultats obtenus – en termes d’orientation, de réussite aux examens, etc. – sont meilleurs ou pires que les objectifs définis par l’administration, en fonction notamment de l’origine sociale des élèves », note la chercheuse Anne Barrère. La Croix 29/08/08 Voir aussi : Les chefs d’établissement : qui sont-ils ? |
|
Rétrolecture 1964 "Les Héritiers" |
Extraits En 1964, un fils de cadre supérieur a quatre-vingts fois plus de probabilités d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole, quarante fois plus qu'un fils d'ouvrier, deux fois plus qu'un fils de cadre moyen... "Pour les classes défavorisées, constatent Pierre Bourdieu (1930-2002) et Jean-Claude Passeron, il s'agit purement et simplement d'élimination." Ainsi commencent Les Héritiers. Les étudiants et la culture. Certes, les dénonciations des inégalités sociales à l'école et dans l'enseignement supérieur sont antérieures à la seconde guerre mondiale. De même, dès 1950, l'Institut national d'études démographiques (INED), dirigé depuis sa création en 1945 par Alfred Sauvy, avait travaillé sur les origines sociales des élèves et leurs résultats scolaires en fin de primaire, puis lancé plusieurs études sur la poursuite des études secondaires chez des élèves de condition modeste. De son côté, Pierre Naville, en 1959, dans Ecole et société, avait publié une étude sur les origines sociales des élèves de l'enseignement technique. Avec Les Héritiers, le sujet atteint un public large dans une société française en mouvement. L'ascension sociale semble subjectivement possible. Dans les milieux ouvriers existe "une estimation empirique", écrivent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, des espérances objectives, tandis que dans la classe moyenne, "classe de transition", on adhère fortement aux promesses de l'école en matière de carrière et de statut social. Comment, dans ce contexte, ne pas être sensible à la mise en lumière d'une institution qui cache ses pratiques inégalitaires derrière le succès de quelques fils d'ouvriers ou d'agriculteurs qui ont eu la capacité de "forcer le destin social" pour échapper à "l'avenir objectif" de leur catégorie sociale ? L'université valorise d'abord le savoir-faire, le savoir-dire, les disciplines culturelles peu ou non enseignées. Tout ce patrimoine s'acquiert d'abord dans les familles et explique la réalité des inégalités sociales. Il est même illusoire, écrivent-ils aussi, de croire que l'égalisation des moyens économiques réglerait la question. C'est "le procès du système", écrit Dominique Fernandez. Le Monde 28/07/08 |
PHILIPPE MEIRIEU « La réforme suppose une redéfinition du service enseignant »
|
Extraits Aujourd'hui, le lycée pêche par un excès de formalisme, le manque de suivi individuel et le caractère artificiel des filières. La classe de seconde, dans ce cadre, est aujourd'hui un sas un peu aléatoire. Permettre aux élèves en seconde de découvrir un certain nombre d'hypothèses, pour se spécialiser ensuite, me paraît relever du bon sens. il faut donner la possibilité à l'élève d'explorer des domaines nouveaux et divers, de se confronter avec les exigences disciplinaires et le contenu des savoirs et de réfléchir avec les professeurs sur ce qui lui convient le mieux. Si une telle méthode est mise en place d'une manière à la fois sérieuse et volontariste, cela me paraît une très bonne chose. Mais il ne faut pas que la réforme concerne uniquement le lycée d'enseignement général. Si on veut supprimer les effets de hiérarchisation entre les filières d'enseignement général il faut aussi faire un effort pour supprimer la hiérarchie entre les trois lycées : général, technologique et professionnel et tendre vers un lycée unique avec certains cours communs. Cela suppose une redéfinition du service enseignant. Ceux-ci devront travailler ensemble et communiquer entre eux. Pour cela, il faut des enseignants impliqués autrement. Ce ne sera plus l'enseignant qui vient donner son cours et qui rentre chez lui corriger ses copies. Ce sera un enseignant pédagogue. On peut dès lors s'étonner de voir une telle réforme apparaître quand, par ailleurs, on supprime les IUFM et quand il semble que la formation des maîtres pour le collège et le lycée ne soit plus une priorité pour le ministère. Les Echos 18/07/08 |
|
Les années lycée seront découpées en modules et en semestres |
Extraits La nouvelle classe de seconde, qui sera en place dès la rentrée 2009, sera découpée en semestres, proposera des modules d’enseignement, du soutien, du travail interdisciplinaire, peut-être du droit et de la technologie, etc. L’objectif est de supprimer le redoublement - 15% en seconde - et de mieux préparer au supérieur, notamment en apprenant aux élèves l’autonomie - plus de 20% des étudiants abandonnent lors des deux premières années. Les trois années de lycée - la seconde puis le «cycle terminal» - devraient désormais être découpées en semestres, comme dans le supérieur. Plutôt que des horaires annuels, les cours seraient dispensés en modules de trois heures hebdomadaires par semestre. Enfin, en plus des enseignements généraux (maths, français, etc. ) les lycéens auraient le choix des enseignements «complémentaires» - trois ou quatre modules par an - et des enseignements «d’accompagnement» - du soutien pour les élèves en difficulté, un travail sur l’orientation ou de la découverte professionnelle pour les autres. Les lycéens avaient jusqu’ici deux options de détermination, dont une seconde langue vivante qu’ils prenaient à 97%. Elle pourrait être intégrée aux enseignements communs. Et les lycéens auraient quatre modules, soit «d’exploration» s’il s’agit d’une discipline qu’ils découvrent, comme le droit ou les sciences économiques et sociales (SES), soit «d’approfondissement», s’ils poursuivent les SES par exemple. Le ministère travaille sur une hypothèse de 60% du temps consacré aux enseignements généraux, 25% aux complémentaires et 15% aux activités d’accompagnement. En «cycle terminal», les lycéens commenceraient à se spécialiser vraiment et ces taux passeraient respectivement à 45%, 45% et 10% Les horaires de cours devraient diminuer mais le ministre a répété qu’il ne voulait pas réformer pour économiser des postes - «nous protégerons le lycée». L’organisation du travail des enseignants devrait évoluer, avec moins d’heures de cours et davantage de présence. Libé 18/07/08 Point de situation sur la réforme des lycées (MEN) On peut aussi relire le rapport "Quels savoirs enseigner dans les collèges" 1998 |
La droite affirme qu'elle a gagné la bataille idéologique
|
Extraits "Nous avons gagné la bataille idéologique", répète depuis quelques semaines le premier ministre. Le changement de pied opéré au premier semestre sur l'éducation illustre cette volonté. La "Lettre aux éducateurs" du président de la République, rendue publique le jour de la rentrée 2007, était encore une tentative de synthèse. A la veille de la rentrée 2008, le climat a complètement changé. Dans la Lettre aux éducateurs de 2007, l'invocation de l'autorité était très présente mais intimement liée à d'autres priorités. L'exigence à l'égard des élèves voisinait avec la compréhension devant leurs difficultés, la discipline avec l'émancipation par le savoir, le recentrage sur les apprentissages "fondamentaux" avec l'ouverture de l'école sur la vie. Quelques mois plus tard, les nouveaux programmes de l'école primaire ont été imposés sans prendre le temps de convaincre les professeurs ; des éléments propres à revigorer l'opinion de droite, comme "l'instruction civique et morale", ont été ajoutés. Le service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève est devenu un thème à traiter d'urgence, contre "la loi de l'emmerdement maximum" imposée, selon le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos, par les syndicats d'enseignants aux familles. Puis a été annoncée la suppression des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), accusés par la droite de "pédagogisme" depuis des années. Début juillet, l'appui du ministère aux attaques des milieux patronaux contre l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée, accusé de développer une "vision sombre" de la société, a parachevé l'offensive conservatrice. La rentrée de septembre se profile comme celle d'un conflit frontal avec les syndicats de l'éducation. Les échecs de la démocratisation par l'école sont mis en exergue pour programmer, au nom de la liberté des familles, la fin de la carte scolaire. Peu importe que les chercheurs, comme les expériences étrangères, aient démontré que la suppression du système contraint d'affectation des élèves développait la ghettoïsation sociale. Le Monde 14/07/08 |
"Il y a un effet spécifique de l'ordre de naissance dans la réussite scolaire"Robert Gary-Bobo, professeur des universités à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
Extraits L'étude, réalisée avec Ana Prieto (CNRS), portait sur un échantillon de 12 000 hommes et 10 000 femmes ayant quitté l'école en 1992. Il y a un effet significatif et spécifique de l'ordre de naissance dans la réussite scolaire. Plus on est jeune parmi ses frères et soeurs, moins on a de chances d'aller loin dans ses études, à niveau social égal. L'aîné réussit mieux que le deuxième, qui réussit mieux que le troisième, etc. Les probabilités d'accéder au niveau bac + 4 varient par exemple du simple au double entre le premier et le cinquième enfant, pour la population masculine observée. En moyenne, plus on a de frères et soeurs et moins on a de probabilités de pousser ses études. Les probabilités d'accès à l'enseignement supérieur se réduisent de 3 % en moyenne pour chaque enfant supplémentaire, indépendamment du rang de naissance. C'est dans les familles les plus pauvres que les effets sont les plus accentués. Dans les familles de niveau socioculturel élevé, le nombre de frères et soeurs semble être au contraire un avantage. Mais les plus jeunes vont quand même en moyenne moins loin dans leurs études. Par exemple, le cinquième enfant d'un cadre supérieur serait sur un pied d'égalité avec le fils unique d'un agriculteur. Il faut prendre tout cela avec prudence. Une corrélation n'est pas forcément une causalité. Le Monde 12/07/08 |
Le Haut Conseil de l'éducation préconise une profonde réforme de l'orientation scolaire
|
Extraits Traditionnels boucs émissaires de toutes les insatisfactions en matière d'orientation, les conseillers d'orientation psychologues (les co-psy) des collèges et lycées sont dans le collimateur du Haut Conseil de l'éducation (HCE). le HCE juge nécessaire de "simplifier un dispositif actuellement pléthorique, redondant et peu efficace". Il estime que "l'Etat devrait transférer aux régions, avec les moyens nécessaires" cette responsabilité. Parallèlement, la fonction de conseil en orientation "devrait être maintenue en établissement, mais elle ne peut plus être l'exclusivité d'un corps spécialisé de fonctionnaires", ajoute le HCE. Il assure que [les Co-Psy], placés sous l'autorité des directeurs de centres d'information et d'orientation (CIO), "ne sont pas réellement dirigés" et "ne sont pas non plus inspectés". les personnels qui "seront appelés à exercer" les fonctions de conseil en orientation au sein des établissements et sous l'autorité des chefs d'établissements "devront avoir des compétences garantissant l'ouverture aux réalités sociales et professionnelles". Le HCE souhaite également que les professeurs soient plus impliqués dans la fonction d'orientation et que celle-ci puisse être exercée par des enseignants à mi-temps, dont ce pourrait être une évolution de carrière. L'orientation consiste en effet "à trier les élèves en fonction de leurs seuls résultats scolaires dans les savoirs abstraits", note le rapport. Elle "tend à procéder par exclusions successives vers des voies ou des filières moins considérées", le problème étant encore plus vif pour les lycées professionnels où l'élève peut être affecté "dans une spécialité qui ne l'intéresse pas ou qui ne correspond pas à ses aptitudes". En outre, une mauvaise orientation est "difficile à rattraper", compte tenu du manque de passerelles de réorientation. |
Une Saint-Barthélemy des pédagogues
Jean-Louis Auduc, directeur des études-premier degré à l'IUFM de Créteil ; Rémi Brissiaud, maître de conférences à l'IUFM de Versailles ; Sylvain Grandserre, professeur des écoles ; Philippe Meirieu, professeur à l'université Lumière-Lyon-II ; André Ouzoulias, professeur à l'IUFM de Versailles.
|
Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont promis à la disparition. Le concours de recrutement des enseignants aura lieu désormais au milieu de la cinquième année d'université (en mastère 2), quelques éléments de formation professionnelle seront dispensés entre février et juin et la prise de poste s'effectuera dès la rentrée suivante, avec un simple "compagnonnage" par des professeurs expérimentés. En reculant d'un an l'entrée dans la carrière, l'Etat fera ainsi de substantielles économies sur les salaires. Y aura-t-il un cadrage national des mastères préparant à l'enseignement ? Cela serait nécessaire, mais c'est contradictoire avec l'autonomie des universités qui risquent, tout simplement, de fagoter en vitesse des ersatz de mastère pour ne pas perdre des étudiants. Pour les lycées et collèges, la formation professionnelle risque de passer tout simplement à la trappe : on se contentera d'une formation disciplinaire - évidemment indispensable - et de quelques observations censées donner les "recettes" du métier. Comment peut-on imaginer envoyer ainsi des professeurs débutants, sans préparation sérieuse, dans des collèges où les élèves, chauffés à blanc par la frénésie consommatrice, ont de plus en plus de mal à fixer leur attention... ou même dans des lycées qui exigent, aujourd'hui, une vraie formation pour faire face à des adolescents et de jeunes adultes qui n'entrent pas de plein gré dans les contraintes scolaires ? Et comment formera-t-on les étudiants qui se destinent à l'enseignement primaire ? S'agira-t-il d'un approfondissement dans la discipline de la licence, de compléments de formation dans les autres disciplines ou d'un cursus centré sur la pédagogie ? Quant aux professeurs de lycées professionnels, ils sont, une fois de plus, les grands oubliés : quel mastère pour les professeurs de cuisine ou de génie mécanique ? Le recrutement par concours cinq années après le baccalauréat interdit la mise en place d'une véritable formation en alternance. Au moment où cette dernière est plébiscitée dans de nombreux domaines, l'éducation nationale, toujours à la pointe du progrès, la supprime. C'est l'affirmation implicite que le métier d'enseignant n'a nul besoin d'être nourri par la recherche ni soutenu par des organismes de formation initiale et continue accompagnant les transformations sociales et permettant d'affronter les nouveaux problèmes qui émergent. Il faudrait organiser la formation en cinq années cohérentes : après trois années de licence, comportant une découverte progressive du métier, le concours de recrutement doit donner accès à deux années de formation professionnelle en alternance, correctement rétribuées et certifiées par un mastère professionnel... Avec une organisation des études permettant aux étudiants et aux stagiaires d'avoir prise sur leur formation et de ne pas se sentir infantilisés par des systèmes d'évaluation obsolètes. De Condorcet à Langevin et Wallon, de Carnot à Durkheim, en passant par Ferry, Buisson et Kergomard, la République a toujours considéré qu'il ne suffisait pas de savoir pour savoir enseigner et qu'elle devait à ses enfants des "maîtres pédagogues". On ne peut prétendre lutter contre l'échec scolaire et saboter la formation des professeurs. On ne peut vouloir rétablir les conditions du "vivre ensemble" et "enseigner à tous les fondamentaux de la citoyenneté" en réduisant au minimum la formation pédagogique des maîtres. On ne peut préparer l'avenir en ignorant l'héritage du passé et les acteurs du présent ! Le Monde 03/07/08 |
Les tirades de Darcos déchiffréesLe ministre de l’Education fait parler les statistiques pour conforter ses réformes. «Libération» a confronté ses calculs aux chiffres réels. |
Extraits «Pour convaincre du bien-fondé des réformes dans l’éducation, les politiques ont de plus en plus recours aux comparaisons internationales afin de mobiliser l’opinion, souligne Nathalie Mons, spécialiste des systèmes éducatifs dans le monde. On retient plus facilement les chiffres que de grands discours.» «Nous avons un des meilleurs taux d’encadrement au monde : 1 professeur pour 11 élèves» Le chiffre significatif, qui exprime la réalité des classes, est en fait celui de la taille, c’est-à-dire le nombre d’élèves moyen par «division». La France est l’un des pays les plus mal classés : 28 élèves par classe en lycée général, 19 en lycée pro. Selon l’enquête Eurydice de l’OCDE portant sur les élèves de 15 ans, avec des classes de maths en moyenne à 26,6, elle est même la lanterne rouge. En Finlande, le chiffre est de 18,2. «Un lycéen français coûte 22 % de plus que la moyenne des pays européens» Si l’on regarde les comparaisons internationales, le coût d’un lycéen français est en effet supérieur à la moyenne. En revanche, celui d’un collégien est dans la moyenne et celui d’un élève du primaire carrément en dessous. Sans parler des étudiants, à la traîne. «Un lycéen français a jusqu’à 35 heures de cours par semaine» On trouve quelques lycéens qui ont jusqu’à trente-cinq heures hebdomadaires. Mais la plupart des lycéens ont moins de trente heures. «Pourtant, trois ans plus tard, la moitié des lycéens n’a aucun diplôme du supérieur» Si l’on prend les derniers chiffres de l’OCDE (2004), 21 % des étudiants qui démarrent une formation de niveau universitaire sortent du système sans aucun diplôme. Au total, 79 % en décrochent donc un - 64 % obtiennent un diplôme au moins équivalent à la licence, 15 % se réorientent vers une formation courte technique (comme les IUT ou les STS). La spécificité française est plutôt le fort échec des bacheliers technologiques - sans parler des bacs professionnels - à l’université : seuls 18 % obtiennent un diplôme au moins équivalent à la licence et 64 % sortent du supérieur sans rien. «Chaque année 15 % des enfants sortent du primaire en grande difficulté, plus 25 % avec des acquis fragiles» Ces chiffres ne sont pas contestés. Ils sont tirés d’une étude du HCE (Haut comité à l’éducation). «Dans les évaluations du primaire, la Finlande est première en tout, nous sommes dans les six derniers en Europe» Le ministre se réfère à la dernière enquête PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), menée dans 45 pays, qui évalue les compétences en lecture des enfants de 10 ans (en CM1). La France est effectivement parmi les mauvais élèves. Le ministre pourrait aussi citer d’autres enquêtes - comme Pisa, sur les 15 ans - tout aussi respectables. On y apprend que les jeunes Français se défendent en mathématiques par exemple : ils sont au-dessus de la moyenne pour utiliser des faits scientifiques, en dessous pour expliquer des phénomènes de manière scientifique. L’enseignement français se caractérise aussi par de grands écarts entre le groupe des meilleurs et celui des plus faibles. Libé 27/06/08 |
La suppression de la carte scolaire renforcera les ghettos |
Avec la suppression totale de la carte scolaire annoncée pour 2010, en faveur de laquelle Nicolas Sarkozy s'est engagé dès sa campagne présidentielle, la mixité à l'école pourrait bientôt ne plus être qu'un fantasme républicain. C'est l'avertissement que lancent les inspecteurs généraux de l'éducation nationale Jean-Pierre Obin et Christian Peyroux dans un rapport sur les premiers effets de l'assouplissement de la carte scolaire, interdit de publication depuis octobre 2007 par le ministère de Xavier Darcos. Leur état des lieux, intitulé "Les nouvelles dispositions de la carte scolaire", établi entre juin et septembre 2007 et qui a porté sur 34 départements "pour la plupart à dominante urbaine", dresse le constat inquiétant d'une accentuation de la baisse de mixité scolaire. Il souligne aussi un renforcement des logiques de concentration ethnique. Pour MM. Obin et Peyroux, le principal effet de l'assouplissement de la carte scolaire a été de dégrader davantage la mixité scolaire, "accélérant les processus sociaux déjà à l'oeuvre depuis des années". "Dans la plupart des départements visités, la question de la survie de certains collèges est ouvertement posée, indique le rapport. C'est aux deux extrémités de la hiérarchie des établissements que la mixité sociale est mise le plus rudement à l'épreuve : dans les établissements les plus convoités, il y a peu d'élèves de condition modeste ; dans les collèges les plus évités, ce sont les catégories favorisées qui ont disparu." La création d'options ou de filières d'excellence dans les quartiers sensibles, ou les labels ZEP et "ambition réussite", n'y changent rien : "Non pas qu'il faille se contenter d'une offre médiocre dans ces collèges (...), mais jamais ces initiatives ne permettent de faire revenir les populations des classes moyennes qui ont déserté un établissement." Parmi les demandes de dérogations, [les élèves boursiers] apparaissent en effet "peu nombreux et mal traités", avec un taux de dérogation accordé "très variable selon les départements". "L'objectif d'amélioration de la diversité sociale n'a en général pas été l'objet d'une attention prioritaire" et c'est toujours la logique des bonnes notes des élèves qui prime, et relègue en bons derniers les critères sociaux dans le traitement des dossiers. Jean-Pierre Obin et Christian Peyroux affichent également leur attachement au maintien par les familles d'un "droit d'affectation dans l'établissement le plus proche du domicile" et à une régulation toujours "assurée par l'Etat" plutôt que par les chefs d'établissement ou les parents eux-mêmes. Le Monde 17/06/08 Voir aussi Carte scolaire assouplie : un rapport inquiétant Ouest-France 18/06/08 Illustré par une photo de J. P. Obin tiré de notre siteDarcos qualifie ce rapport de "double ânerie AFP 18/06/08 |
|
Un nouveau
bac en 2012 Lycée, ce qui devrait changer |
Extraits Le gouvernement vient de dévoiler un projet de modernisation de l'institution bicentenaire. Devant un parterre de recteurs réunis pour le bicentenaire [du bac], le président de la République, ancien élève médiocre de Saint-Louis-de-Monceau, a fustigé l'institution cacochyme : «La situation actuelle n'est plus tenable. Le système des filières, écrasé par la section scientifique, est déséquilibré et ne remplit pleinement aucun des objectifs recherchés.» Objectif affiché : réaménager la classe de seconde dès la rentrée de septembre 2009. Puis la première et la terminale afin de proposer en 2012 «un nouveau bac». Les maux de notre lycée sont bien connus. Il y a, d'abord, cette déprimante hiérarchie entre les filières depuis tout en haut la série S du lycée général, la plus recherchée, jusqu'à tout en bas, les filières professionnelles. Une effroyable complexité, ensuite - 14 spécialités en lycée général, 22 en lycée technologique, 54 en lycée professionnel -, coûteuse et difficile à gérer. Un travail trop scolaire, enfin, avec ses programmes pléthoriques, ses semaines surchargées où règnent les cours magistraux. Les lycéens français n'étudient pas, ils bachotent. Conséquence : ils sont mal préparés aux études à la fac, où on leur demande d'être autonomes. La feuille de route [du gouvernement] reprend les conclusions d'anciens rapports : ceux d'Antoine Prost en 1983, du pédagogue Philippe Meirieu en 1998, de l'ex-rectrice de Toulouse Nicole Belloubet-Frier en 2002... Qu'y trouve-t-on ? D'abord, le retour à un lycée «généraliste», défini par un tronc commun, français, maths, langues. Les élèves devront compléter leur cursus en choisissant des enseignements supplémentaires en fonction de leur projet personnel. Le redoublement devrait disparaître. Les élèves n'auront qu'à reprendre le module où ils ont échoué. «Cela va permettre de gagner plus de 10% de temps d'enseignement», calcule-t-on au ministère. Place à l'autonomie, à la créativité, à la recherche personnelle. Ainsi le nombre d'heures passées au lycée - 35 par semaine aujourd'hui ! - devrait diminuer sensiblement. Le travail en groupe autour de projets, comme c'est déjà le cas pour les travaux personnels encadrés, sera développé. «Hausser l'exigence, diminuer les contenus», résume l'historien Antoine Prost. «Il faudrait que les professeurs sortent de leur classe, et les élèves aussi, martèle la sociologue Marie Duru-Bellat. Il n'y a pas assez de réflexion sur l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle.» Nel Obs hebdo 12/06/08 Voir aussi Le rapport Meirieu de 1998 Quels savoirs enseigner dans les lycées ? |
|
Cité en
exemple par Xavier Darcos... Le modèle québécois |
En maths, en sciences, en lecture, les élèves de la province canadienne sont parmi les premiers de la classe mondiale. Pendant leur formation, [les futurs enseignants] passent le tiers du temps à étudier la discipline, le reste à travailler la didactique, la psychologie, la pédagogie. « Tout l'accent est mis sur les manières d'enseigner, de gérer la classe, voire de se remettre en question quand les élèves ne suivent pas.» «L'école doit susciter l'engagement des élèves dans leurs apprentissages.» «Au Québec, l'école a adapté ses attentes aux élèves qu'elle accueille. On apprend moins, mais on apprend mieux», résume Bernard Hugonnier, spécialiste de l'Education à l'OCDE. L'encouragement est la règle d'or. «Il y a un moindre rejet du système éducatif quand vous retrouvez des éléments de votre propre culture à l'école», souligne Eric Dionne, le directeur de Joseph-François-Perrault. Pour les adolescents en rupture de ban, il fallait inventer. Le système donne assez de latitude aux écoles pour le faire. Chaque établissement dispose d'un ou de plusieurs «professeurs ressources», sortes de bonnes fées qui offrent du rattrapage sur mesure dès [que les élèves] trébuchent. Le redoublement n'existe pratiquement pas. Ces pratiques portent leurs fruits : à 15 ans, le niveau des élèves est assez homogène. Le milieu familial a une incidence faible sur leurs résultats, à l'inverse de la France. «L'objectif commun est de créer une société égalitaire, où il n'y a pas de citoyens de seconde zone», explique Pierre Bergevin, sous-ministre de l'Education. Un vrai cauchemar pour le Snes ! Les profs font 18 heures de cours par semaine, mais ils restent 32 heures dans leur établissement, pour assurer toutes sortes de tâches annexes : organiser les cessions d'examens, surveiller les corridors ou la bibliothèque, rencontrer les élèves... et, ô sacrilège ! remplacer même un collègue absent. Nel Obs hebdo 12/06/08 Pour aller plus loin : des documents téléchargeables sur la formation des enseignants : http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/forminit.html |
| Apprendre à enseigner sur le tas ou à l'école : le débat est relancé |
Extraits "On a le sentiment d'avoir reçu le dernier coup de bambou", confie, sous le sceau de l'anonymat, un responsable [d’IUFM]. Cette perspective découle de l'annonce le 27 mai par Nicolas Sarkozy du recrutement des enseignants au niveau master 2, soit bac + 5. Les protestations se multiplient devant ce qui semble remettre en question le principe d'une formation professionnelle spécifique des enseignants, au profit du seul "compagnonnage", c'est-à-dire l'accompagnement des débutants par des enseignants aguerris. Jusqu'à présent, la plupart des enseignants sont formés (après, au minimum, la licence) en deux ans : une première année essentiellement académique, en IUFM ou non, pour préparer le concours, une deuxième en IUFM seulement et en tant que "stagiaire", payé par l'éducation nationale, pour se former au métier proprement dit. C'est cette deuxième année dont la disparition est programmée en 2010. "Ce ne sont pas seulement les IUFM qui disparaissent, c'est la professionnalité du métier enseignant qui est en cause", estime Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil. Selon lui, "c'est comme si l'on disait aux futurs magistrats : vous avez votre master de droit, maintenant jugez tout de suite, sans passer par l'Ecole nationale de la magistrature..." "Que signifie la liberté pédagogique s'il n'y a plus de pédagogie ?", demande pour sa part André Ouzoulias, professeur à l'IUFM de Versailles, rappelant que la loi Fillon d'avril 2005 (loi d'orientation sur l'avenir de l'école) avait décidé l'intégration des IUFM dans les universités, réalisée en 2007, " pour mieux articuler formation pédagogique et connaissances scientifiques". Le Monde 09/06/08 29 organisations demandent une véritable formation professionnelle des enseignants Communiqué |
Réforme du lycée : seize "points de convergence" soumis aux enseignants |
Extraits Voulant "rechercher le consensus le plus fort (…) autour du concept d'un nouveau lycée", le texte énonce quatre "objectifs" et douze "principes directeurs", en termes suffisamment ouverts pour ne compromettre d'emblée aucune signature. Les objectifs consistent à "garantir la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur", "assurer la réussite scolaire de tous les élèves", permettre à chacun de "mieux choisir son orientation" et "rechercher de nouveaux espaces d'autonomie" pour les établissements. Le lycée deviendrait "le lieu d'une réelle liberté de choix des lycéens en évitant l'enfermement trop précoce dans des filières". Les "parcours" des élèves seraient plus souples, divers et personnalisés (Le Monde du 12 mai). Le concept de filière, précise-t-on dans l'entourage de M. Darcos, ne serait toutefois pas remis en cause. Le texte prône "une nouvelle approche de l'organisation des études" et reprend la "perspective" d'une "modularité" des enseignements. Il insiste sur "le travail personnel autonome, la capacité de recherche documentaire et la maîtrise du travail en groupe". Le "temps destiné aux cours proprement dit" serait distingué de celui consacré "au travail sur projet, à la remise à niveau", à "l'approfondissement" ou à "l'accompagnement éducatif". Dans le cadre de la "nouvelle organisation des parcours", la classe de seconde resterait "de détermination" mais serait "repensée" pour éviter une spécialisation prématurée. Plus largement, l'organisation des études devrait "davantage tenir compte" du rapport que les lycéens "entretiennent avec le savoir et les adultes". Le travail des enseignants devrait également "mieux intégrer, en les articulant, la diversité des situations éducatives : cours, soutien, remise à niveau, projets interdisciplinaires, aide personnalisée, contribution au suivi et à l'orientation, préparation méthodologique aux études supérieures". Les professeurs pourraient "développer les liens" avec l'enseignement supérieur "selon des modalités qui restent à définir", notamment des "services partagés" ainsi que le "suivi pédagogique et l'encadrement d'étudiants de première année". Le texte constate que "la carte des options et l'offre éducative dans les domaines du soutien ou de l'approfondissement sont actuellement concentrées de façon aléatoire et ont tendance à accroître les inégalités". Il prône une "offre équitable" en ce domaine. Le Monde 03/05/08 Voir aussi : le Discours de X. Darcos |
Nicolas Sarkozy veut modifier le recrutement des enseignants dès 2010
|
Extraits "Je souhaite que l'enseignant de demain soit mieux formé, que la durée de ses études soit allongée d'un an. Je souhaite en outre que la place des universités dans cette formation soit pleinement reconnue" En échange de cette année d'études supplémentaire, "nous nous engageons à ce que les débuts de carrières soient revalorisés" Le chef de l'Etat a ainsi officialisé le projet de réforme du ministre de l'éducation, Xavier Darcos, afin que les concours de professeurs des écoles, le Capes et l'agrégation "puissent être intégrés au cursus universitaire (...) et soient ouverts à tout titulaire ou tout futur titulaire d'un master 2", de niveau bac +5, "dès la session 2010" . "Dans le système profondément renouvelé que nous préparons, le corps enseignant est appelé lui aussi à évoluer", a ajouté le chef de l'Etat, affirmant mesurer "l'étendue du malaise enseignant". Relever le "double défi" de la "démocratisation" et de l'"élévation du niveau général exige que l'éducation nationale entre résolument dans la culture de l'évaluation et du résultat", a-t-il affirmé. L'évaluation n'est "pas pour stigmatiser tel ou tel", mais "un instrument très concret du pilotage", a précisé Nicolas Sarkozy. Le Monde 02/05/08 |
|
«La carte scolaire a limité les dégats» Marie Duru-Bellat, professeure à Science-Po |
Extraits Les critères de dérogation sont plus transparents, ce qui est une bonne chose. Mais les gens qui vont demander des dérogations seront ceux qui en demandaient déjà, généralement des parents instruits ou obsédés par la scolarité de leurs enfants. Avec les critères fixés par le ministre, les nouvelles populations qui peuvent être tentées de le faire sont réduites : les élèves handicapés, boursiers, etc. Le motif des "parcours scolaires particuliers" - classes bilingues, options rares, etc - va rester largement dominant. Et le public des demandeurs ne va pas changer beaucoup : des gens qui ont les moyens d’envoyer leurs enfants dans des collèges éloignés. On propose une solution très individualiste, de type sauve-qui-peut : il y a des établissements où personne ne veut aller, et on nous dit : "On n’y peut rien, on vous donne simplement plus de possibilités d’en sortir." Or, il faudrait s’attaquer aux raisons pour lesquelles certains établissements sont fuis. Pour assurer davantage de mixité, j’avais préconisé une redéfinition de la carte scolaire en mêlant de façon très volontariste les différentes populations. Si on compare à la Belgique par exemple, où le libre choix est total dans le secondaire, on a des inégalités moindres entre établissements en France. La carte scolaire a donc limité les dégâts. De plus, elle pose problème surtout dans les grandes villes. Dans la France profonde, cela ne gêne personne. Libé 30/05/08 Voir aussi : Carte scolaire : le chacun pour soi Libé 30/05/08 |
Un Munich pédagogiqueAntoine Prost, historien de l’éducation Le Monde 28/05/08 |
Extraits La suppression de deux heures de classe dans l'enseignement primaire et la semaine de quatre jours risquent d'être irréversibles. Et personne ne dit rien ou presque. Le forfait s'accomplit dans l'indifférence générale. Munich s'était accompagné d'un "lâche soulagement". Ce lâche consentement, lui aussi, annonce une débâcle. Même le ministre n'a pas osé dire du bien de cette mesure que lui a imposée - dit-on - un président qui n'a décidément pas besoin de réfléchir pour décider. Avec trente-six semaines de quatre jours, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er et le 8 mai, le 11 novembre, cela fera moins de 140 jours de classe par an. Il y en a 210 au Japon, 200 en Italie et au Danemark, 188 en Finlande, 190 en Grande-Bretagne. Et l'on se plaint du niveau des petits Français ? Il n'y a qu'une chose vraiment importante en éducation : c'est le travail des élèves. Sur quel miracle, sur quelle potion magique, M. Darcos compte-t-il pour compenser les amputations qu'il décrète ? Où sont les défenseurs du niveau, si prompts à dénoncer toute innovation pédagogique ? La vague promesse d'un retour aux bonnes vieilles méthodes les rassure : elles ont fait leurs preuves, disent-ils. Et qu'on ne nous raconte pas qu'on va se concentrer sur les "fondamentaux", alors qu'on ajoute encore des matières. Cette mesure compromet, plus que bien d'autres qui provoquent des grèves, l'enseignement de haut niveau et la qualité du service public que les syndicats prétendent défendre. Ceux qui se prétendent démocrates et défenseurs du service public et ne dénoncent pas aujourd'hui cette entreprise de déconstruction sont des menteurs. Le Monde 28/05/08 |
La classe, Palme d'orBernard LE SOLLEU |
Extraits Entre les murs, de Laurent Cantet, Palme d'or à Cannes, tombe à pic en pleine querelle scolaire. C'est un film engagé comme l'était le livre de François Bégaudeau, le « prof » qui joue son propre rôle. Il réfute les idées de déclin et de désenchantement scolaire. Il refuse les descriptions réactionnaires des élèves en nouveaux barbares nourris de jeux vidéo, en crétins indécrottables incapables d'accéder à Racine ou à Flaubert. Bégaudeau et Cantet ne cultivent pas la nostalgie de l'école de jadis, celle que flattait, au contraire, le documentaire à succès Être et avoir. En chacun de nous sommeille un petit ministre de l'Éducation nationale nourri de ses propres souvenirs d'élève. On veut tous le mieux pour ses enfants, la meilleure école, les meilleurs enseignants. On se gave de classements entre établissements. Et on oublie l'essentiel : la réalité de la classe, beaucoup plus subtile que ne le laissent entendre les débats tranchés entre tenants de l'école classique et nouveaux pédagogues. En pleine bataille politique et idéologique autour de l'école, cette Palme d'or st célébrée comme un hommage vibrant au monde enseignant. Il en a bien besoin, lui qui se sent mal aimé, sous-estimé et sous-payé. Mais ce film célèbre aussi, et surtout, les élèves black-blanc-beur de ce collège parisien, métamorphosés, en quelques mois de répétitions, en vrais acteurs d'eux-mêmes. Ouest-France 27/05/08 Voir aussi : Le prof qui tacle les grincheux de l'écoleF. Begaudeau, auteur du livre, co-scénariste et acteur a participé à une émission de CAP-CANAL Débuter dans l'enseignement Le making of d'"Entre les murs", par François Bégaudeau Le Monde 27/05/08 |
"Entre les murs", Palme d'Or française à Cannes
|
ExtraitsLes salles de classe sont des pièces aussi mystérieuses que les chambres conjugales. Entre les murs éclaire ce mystère en mettant les outils de l'expérience directe au service de la fiction. Cette greffe est rendue possible par l'existence d'un individu qui occupe une multiplicité de positions au centre du film : François Bégaudeau en est à la fois le sujet (il a été professeur), l'inspirateur (il a écrit un roman tiré de son expérience d'enseignant), le coscénariste (avec Laurent Cantet et Robin Campillo) et l'interprète principal.Le parti pris est de ne montrer qu'une seule des classes de l'enseignant, une quatrième, de septembre à juin. L'essentiel du film est consacré à des cours qui prennent un tour comique, violent ou polémique (Entre les murs fait abstraction d'une des composantes essentielles de la vie scolaire : l'ennui). Ces heures de classe sont ponctuées de réunions (de conseils de classe, entre professeurs, entre enseignants et parents). Dans ce film sans acteurs professionnels, tout le monde joue très appuyé. Monsieur Marin veut à la fois séduire et en imposer, et se sert à loisir d'une ironie parfois cruelle pour amuser et tenir à distance ses élèves. A ce "jambon-beurre" narquois, ces derniers, en majorité issus de l'immigration opposent le langage de la rue – les mots, les gestes, les vêtements. Cantet et Bégaudeau font travailler à plein les contradictions de l'école en France : le souci de ne pas exclure et la volonté de maintenir la discipline ; la reconnaissance de la diversité et l'enseignement d'une culture unique... Le Monde 24/05/08Adaptée d'un roman du Vendéen François Bégaudeau puisé à sa propre expérience dans l'enseignement, cette chronique relate la vie quotidienne d'une classe de 4e dans un collègue du 20e arrondissement de Paris. Une classe difficile, comme on dit, mais pas forcément plus que la normale. Elle ressemble à la France, souligne le metteur en scène, elle est « multiple, foisonnante, complexe, avec quelques frictions. » Avec des « comédiens » forcément amateurs, venus d'un même établissement, ce récit est toujours alerte et vivant, sous ses allures de spontanéité. Le ton n'est jamais grave, et pourtant rien n'est occulté des vrais problèmes que peut connaître le système éducatif en France. Enseignants, élèves, administration, parents, chacun y trouvera leçons et devoirs... Par sa fraîcheur et sa vivacité, traduites notamment dans la présence des adolescents sur la Croisette, bousculant rituels et habitudes, ce film a fait souffler un tonus inhabituel sur la fin du festival. Ouest-France 36/05/08 Entre tolérance, complicité, ironie ou autorité, le dialogue y est parfois difficile et la pédagogie doit faire des concessions. François Bégaudeau est lui-même un ancien enseignant. Quant aux jeunes, ils s'animent, discutent, se révoltent, agressent… Et s'ils dérapent facilement, le prof lui aussi peut se laisser aller. Alors que faire ? Le film constate simplement sans parti pris en soulevant plusieurs questions cruciales. La transmission du savoir doit passer par un respect réciproque et un minimum de civilité de plus en plus mis en doute, l'intégration de certains est souvent difficile, l'agressivité le moyen immédiat de répondre aux conflits… Tout cela est inscrit sur le tableau de cette classe fictive et si représentative. C'est ce qui fait l'intelligence et la force de ce film aux frontières de la réalité qui a aussi la bonne idée de faire sourire avec quelques scènes pittoresques. Entre être et savoir, cette classe en apprend beaucoup plus sur l'école que nombre de discussions oiseuses ou de reportages démagogiques.Le Figaro 26/05/08
"Il y a un discours sur la jeunesse qui est vieux comme le monde et qui
a tendance à s'intensifier depuis quelque temps, à savoir: les jeunes
sont cons, les jeunes jouent au jeux vidéo, ils sont analphabètes,
etc.", a expliqué François Bégaudeau, auteur du livre dont s'inspire le
film réalisé par Laurent Cantet.
|
|
La mixité à l’école écornée en douce |
Extraits Sans crier gare, le gouvernement a fait inscrire dans la loi l’autorisation d’avoir des enseignements séparés filles et garçons à l’école. Ce qui n’était jusqu’ici qu’une simple possibilité - pendant les cours de sports notamment - prend ainsi valeur légale. Adoptée le 15 mai par le Parlement, la loi en question - sur la lutte contre les discriminations -, permet, dans l’alinéa 4 de l’article 2, l’«organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe». Mais il ne faut y voir aucun encouragement, souligne-t-on dans l’entourage du ministre de l’Education, Xavier Darcos : «Sans cet alinéa, la loi, qui est la transposition de directives européennes, aurait donné la possibilité à certains de contester les cas de non-mixité qui existent dans l’enseignement. Certaines écoles privées auraient pu être mises en difficulté. Nous avons simplement voulu préserver le statu quo.» «On peut attendre des demandes pour des séances séparées de piscine - notamment de communautés religieuses intégristes; certains peuvent aussi réclamer des cours de maths séparés car les garçons sont déconcentrés par les filles, s’insurge la sénatrice communiste Annie David. Et pourquoi pas revenir au cours de couture pour les filles et de mécanique pour les garçons?» Les directives européennes ne parlaient en effet nulle part d’éducation. Le gouvernement est notamment soupçonné d’avoir voulu faire une fleur aux écoles catholiques les plus réactionnaires, dans la droite ligne du discours de Latran de Nicolas Sarkozy estimant que l’instituteur n’arriverait jamais au niveau du curé pour inculquer des valeurs aux enfants. Libé 22/05/08 |
|
Une étude de l’Inserm et d’Ipsos se penche sur «le jeune». Des ados heureux de vivre |
Extraits 96 % des jeunes disent avoir beaucoup d’amis ; 79 % disent pouvoir parler facilement avec leurs parents (à condition que les parents ne les poussent pas dans les retranchements de leur intimité, ça le jeune déteste) ; 78 % se sentent bien à l’école, et c’est sans doute pour cela qu’ils ne veulent pas qu’on touche à leur bahut et descendent dans la rue. Au final : 71 % se disent «satisfaits de ce qui leur arrive». Evidemment, tout n’est pas si rose. Et 42 % se sentent sous pression, réussite scolaire oblige. Et il y en a quand même 17 % qui disent avoir des difficultés à aller vers les autres ; 18 % qui confessent se sentir mal dans leur peau. Revendication du jeune: avoir des cadres (pour mieux les rejeter?). 70 % des ados disent respecter l’autorité de leurs parents (donc 30 % non) ; 52 % affirment respecter celles des profs (mais que fait l’autre moitié, nom d’un non?) Dans le fond, ils recherchent «une autorité bienveillante et équitable». Libé 22/05/08 |
Xavier Darcos veut bâtir un "lycée à la carte" |
Extraits Xavier Darcos se lance dans une nouvelle bataille : il veut bâtir "le lycée à la carte" et il veut le faire en s'appuyant sur les lycéens, ceux-là mêmes, en partie, qui le contestent dans la rue depuis le mois de mars. L'esprit et le mode de fonctionnement de ce nouveau lycée se rapprocherait plus d'une logique universitaire (la construction d'un parcours individuel) que de l'organisation scolaire traditionnelle. M. Darcos juge ainsi que les emplois du temps devraient alterner les cours et des "moments d'étude". Et il propose surtout d'"offrir systématiquement du soutien à ceux qui en ont besoin". Il envisage aussi de "remplacer le redoublement par des enseignements complémentaires". Éliminer les redoublements au lycée permettrait d'économiser des milliers de postes. La réforme du lycée, estime-t-il, demandera un "aggiornamento important" de la part des enseignants, car "on ne peut pas la séparer de la commission Pochard sur l'évolution du métier". Le ministre a annoncé la mise en place "à titre expérimental", dès la rentrée 2008, d'un dispositif de "réussite scolaire au lycée" dans les 200 établissements rencontrant les plus grandes difficultés scolaires. Le ministre veut "permettre une plus grande autonomie des lycéens, s'appuyant sur un enseignement plus personnalisé et préparant mieux à l'enseignement supérieur". M. Darcos voit "une continuité" avec les travaux déjà menés, en 1996 par Roger Fauroux à l'occasion de son rapport sur l'école, puis en 1998 par Philippe Meirieu. Mais cette continuité, taxée de "pédagogisme", est violemment contestée à l'UMP et par ceux qui ont soutenu le ministre sur les programmes du primaire. Le Monde 11/05/08 |
Luc Ferry s'associe à Jack Lang pour dénoncer le "populisme scolaire" |
ExtraitsM. Lang, député PS et ancien ministre de l'éducation, avait, dans Le Monde du 4 mars, fustigé un "appauvrissement intellectuel de l'école"."En dépit de tout ce qui oppose nos choix politiques et philosophiques, écrivent MM. Ferry et Lang, nous avons pourtant les mêmes raisons de penser que les nouveaux programmes (...) risquent de nuire gravement à la santé (déjà bien fragilisée) de notre système éducatif." Reprenant sur trois pages d'analyse les principaux points des propositions de M. Darcos, les deux signataires stigmatisent la "paresse intellectuelle" et "l'imposture" de ces nouveaux programmes, venant remplacer ceux de 2002 dont ils sont les coauteurs : l'un (M. Lang) comme ministre, l'autre (M. Ferry) comme président du Conseil national des programmes, un organisme supprimé en 2005. "Que ce travail puisse et doive être amélioré, nous sommes les premiers à en convenir. Mais qu'on le liquide purement et simplement pour le remplacer par un vide abyssal est proprement consternant", poursuivent-ils. Selon eux, "la seule véritable visée" des nouveaux programmes est "un affichage politique", relevant d'une "catégorie relativement nouvelle" qu'ils qualifient de "populisme scolaire". "S'il suffisait d'être réactionnaire pour être génial, cela se saurait", insistent-ils, en appelant à "l'honnêteté" et au "sens des responsabilités" de M. Darcos pour "préserver ce qui a été fait de bon par le passé". Le Monde 13/03/07 L'intégralité de l'article dans le Nel Obs hebdo du 13/03/08 |
Une étude dévoile la loterie des notes du bacL'arbitraire de la notation pose la question de la suppression de l'examen, selon une récente étude
|
ExtraitsUne même copie de bac peut atteindre jusqu'à un écart de onze points d'un correcteur à l'autre ! Ce constat d'une récente recherche de l'Iredu (Institut de recherche sur l'éducation) intitulée «La loterie des notes au bac», ne va pas rassurer les futurs bacheliers. En 2006 et 2007, Bernard Suchaut a soumis trois copies d'élèves passant l'épreuve de sciences économiques et sociales à la correction d'une trentaine de professeurs, dans deux académies. Puis il a recueilli les notes et les appréciations sur chaque copie.il existe, pour chaque dissertation, des variations très fortes d'un correcteur à l'autre (de 5 à 16 sur 20 pour l'une d'entre elles ou de 8 à 18 pour une autre). L'écart de notation peut aller jusqu'à onze points, ce qui est énorme. En moyenne, il est cependant plus proche de deux ou trois points. Autre enseignement, il n'existerait pas de correcteurs «indulgents» ou «sévères», selon le chercheur : ces derniers ne sont pas «constants» dans leur pratique de notation. Ils peuvent noter très sévèrement une copie, puis généreusement les deux autres ou inversement !De telles variations «peuvent avoir, pour certains élèves, une réelle influence sur la réussite à l'examen», observe Bruno Suchaut. Comment «réduire l'incertitude», écrit-il, sachant que «les grilles de correction avec un barème précis» sont «loin d'être un outil parfait» et que «multiplier le nombre de correcteurs» n'est pas possible. Le chercheur s'interroge dès lors sur la légitimité du bac. «Il est évident, qu'au fil des décennies, cet examen a perdu de son intérêt en terme de sélectivité», affirme-t-il, mentionnant «son coût élevé» en terme de temps et d'argent pour la collectivité. Le Figaro 11/03/08 |
|
Pour un cessez-le-feu sur l'école Jacques Julliard |
Extraits Qu'on fiche la paix aux profs ! Que l'on arrête de les harceler avec de nouveaux programmes et de nouvelles exigences ! Contentons-nous de les soutenir !
J'en suis aujourd'hui à redouter que, sur les grands sujets
de société, Nicolas Sarkozy ne se prononce pour des solutions justes,
tant existe le risque qu'il les déconsidère durablement. Ainsi de son
discours de Périgueux sur l'école, dont, pour ma part, j'approuve
l'essentiel. Nicolas Sarkozy a proposé pour l'école primaire - il n'est,
hélas !, pas le premier ! - de revenir aux «fondamentaux», c'est-à-dire
à la maîtrise de la langue (lecture, grammaire, orthographe), du calcul,
ainsi qu'à l'instruction civique et à la morale. Dans sa modestie, ce
programme est à la fois sage et ambitieux. Il s'agit de diviser par
trois (pourquoi par trois ?) le nombre d'élèves dont le niveau à la
sortie du CM2 est nettement insuffisant, soit 40% des effectifs. Il
s'agit surtout, contre le bambinisme bêlant, de remettre «au centre
de la classe» non plus l'enfant mais «le savoir» et, par
conséquent, «le professeur qui en est le dépositaire et le
transmetteur». Oui, mille fois oui. Une telle démarche procède d'une
appréciation juste de ce qu'est devenue l'école : en priorité un lieu de
lutte contre l'illettrisme (Luc Ferry) , danger majeur pour la
société et source des inégalités futures. Il ne faut pas se le cacher : l'école vit aujourd'hui un grand naufrage que l'on met plus de temps et d'énergie à dissimuler qu'à combattre. Une heure avant la catastrophe, un orchestre jouait encore sur le pont du «Titanic». L'obligation scolaire a disparu et l'absentéisme systématique est le seul remède efficace à la surcharge des classes. On continue de s'étriper sur les horaires des diverses disciplines, alors que c'est la discipline au singulier qui est devenue la préoccupation principale de maint professeur tout au long de la semaine. Nel Obs hebdo 21/02/03 |
Darcos : l'école du progrès ? |
Extraits Dernière étape d’une réforme engagée en septembre 2007 avec notamment la suppression du samedi matin, les textes présentés fixent plusieurs objectifs tels l’acquisition des "savoirs de base", "diviser par trois" le nombre d’élève entrant en 6e sans savoir lire, et "par deux" le nombre de redoublements en primaire. « L’école ne doit plus chercher à transmettre en quelques années la totalité des champs du savoir, mais à donner à l’individu toutes les clés pour les approfondir ultérieurement », a déclaré le ministre de l’Education qui s’est dit « vigilant » afin que sa réforme conduise à « une amélioration significative des résultats de chaque école ». Si l’essentiel de ces mesures était connu, les acteurs du primaire ont regretté unanimement qu’elles « sentent le bonnet d’âne et la blouse grise » des années 50, a expliqué Gilles Moindrot, secrétaire général du SNuipp-FSU, plutôt qu’ « une école qui innove, qui donne goût de la vie, qui est gaie et qui épanouit ». Et le responsable du SNUipp-FSU de poursuivre : « (Xavier Darcos) dit qu’il n’impose pas de pédagogie, mais en réalité il impose des choix, des règles. Par exemple les consignes sur la rédaction sont détaillées sur seulement cinq lignes dans les programmes, tandis que l’étude de la grammaire et de la conjugaison occupent une page entière ». Le Sgen-CFDT a regretté la trop large place accordée aux exercices répétitifs, apprentissages par coeur, automatismes, « générateurs d’ennui, donc d’échec ». « On revient plusieurs décennies en arrière » a également déploré Luc Bérille, secrétaire général du SE-Unsa. Commentant la publication des résultats des écoles primaires : « les écoles sont mise en concurrence entre elles sur leurs résultats supposés, dans une logique qui va flatter le consumérisme L'Humanité 21/02/08 |
Les chefs d'établissements ont le moral en baisse |
Extraits Selon l’étude de Georges Fotinos, ancien inspecteur général et conseiller à la Mgen, 46 % des personnels de direction déclarent que leur moral "s'est dégradé" au cours des ces dernières années. 25 % ont un moral "médiocre, mauvais ou exécrable".Un quart également considère que l'utilisation de leurs compétences est "peu ou pas satisfaisante". 18 % des chefs d'établissement se déclarent "peu ou pas intéressés par leur travail".72 % estiment que "leurs conditions de travail ont connu une dégradation ces dernières années". Ils étaient seulement 52 % à le penser en 2004,. Entre 2004 et 2007, le climat scolaire de l'établissement s'est lui aussi dégradé, de même que les relations avec les parents d'élèves, ou la qualité des enseignements dispensés, estiment les proviseurs, les principaux ou leurs adjoints. L'Express 19/02/08 Le climat scolaire dans les lycées et collèges (en annexe Le baromètre du moral des personnels de direction) : L'étude téléchargeable |
|
Mémoire (devoir de…)
|
Extraits Après la lettre de Guy Môquet en octobre, voilà les enfants juifs en février. Et c’est reparti pour un tour de manège où Nicolas Sarkozy semble être le Mickey dont il faut attraper la queue pour gagner un nouveau tour de passe-passe. «L’idée», façon Géo Trouvetou, est de doubler chaque enfant français de 10 ans avec une jeune victime de la Shoah. Le président, en activant le devoir de mémoire, a-t-il seulement anticipé le souci des familles le soir après l’école ?: «Dis donc Toto, quand tu auras fini d’aider ta maman à faire à manger, mis la table, torché tes cinq frères et sœurs, fait la vaisselle, passé la serpillière et rentré les bûches dans la remise, n’oublie pas de faire ton devoir de mémoire.» Lequel aurait donc la valeur édifiante qu’on attribuait autrefois dans les sectes catholiques au devoir de ne pas oublier de faire sa prière. Ceci pour dire qu’au lieu de dégainer la mémoire sur son seul mode mortifère et intimidant, il faudrait plutôt proposer un moratoire linguistique qui suspende le collage, devenu automatique, entre «mémoire» et «devoir de…». Car, dès lors que quoi que ce soit devient un devoir, on sait que cette injonction comminatoire emporte avec elle la tentation légitime du cancre de ne pas les faire (ses devoirs) et de sécher le cours d’histoire quand il est aussi brutalement canalisé dans une seule direction. Libé 16/02/08 Shoah: Simone Veil juge «insoutenable et injuste» l'initiative de Sarkozy Libé 16/02/08 |
À quoi devra ressembler l'école, l'an prochain |
Extraits Les élèves auront 24 heures de cours par semaine au lieu de 26. Les enseignants, eux restent à 27 heures. Le 5 février, les syndicats Unsa et CFDT ont signé un accord précisant la façon dont les professeurs devront utiliser ces trois heures restantes : à 45% pour le travail d'équipe et la formation; à 55% pour aider les élèves en difficulté. «15 % des élèves sortent de l'école en grande difficulté », Xavier Darcos a annoncé, la semaine dernière, des stages de rattrapage gratuits pour les CM1 et CM2, dès 2008, à Pâques et en été. L'an prochain, les élèves décrocheurs auront également droit, en semaine, hors des cours, à un soutien individualisé de leur instituteur. L'année d'après, l'école du soir (avec de l'aide aux devoirs) complètera le programme. « Priorité absolue » au vocabulaire (dès la maternelle), à l'orthographe et à la grammaire. Grammaire à l'ancienne, pour que les parents comprennent les leçons de leurs enfants. Priorité, aussi, au calcul mental. Des cours « d'instruction civique et morale » porteront sur la politesse, la « bonne tenue », « le respect des valeurs et des emblèmes de la République : le drapeau, Marianne, l'hymne national, à l'écoute duquel nos enfants devront se lever » « La méthode m'indiffère, résume le Président. On va s'en tenir aux résultats » « Les deux évaluations nationales témoins serviront à mesurer chaque année les acquis des élèves au CE1 et au CM2 ». Et chaque famille « recevra les résultats de son école ». Pour mieux en changer ? Ce sera plus facile avec la disparition progressive de la carte scolaire. 0uest-France 16/02/08 |
Le ministère de l'éducation dément toute révision à la baisse de l'accompagnement éducatif |
Extraits Un courriel circule depuis le 29 janvier sur Internet en milieu enseignant : anonyme ou rendu anonyme, il exprime la rancoeur d'un principal de collège du Rhône classé "Ambition réussite" et auquel l'inspection d'académie aurait brutalement restreint les moyens alloués à "l'accompagnement éducatif" des collégiens de 16 à 18 heures. "Cela vient directement du ministère. C'est identique dans toutes les académies, l'inspecteur d'académie nous l'a confirmé, comme s'il voulait nous consoler" Cet accompagnement éducatif, destiné selon l'expression consacrée aux "orphelins de 16 heures", est une priorité de Nicolas Sarkozy, reprise par le ministre de l'éducation, Xavier Darcos. Mis en place depuis la rentrée 2007, ce dispositif concerne les établissements de l'éducation prioritaire et doit être généralisé à tous les collèges à la rentrée 2008. Il est abondamment financé, par attribution d'heures supplémentaires, transformables en vacations pour rémunérer des intervenants extérieurs. Le courriel – au moins à l'origine – est authentique. Bien que "remanié" et "manipulé" par ceux qui l'ont diffusé, "il a bien été écrit par un collègue chef d'établissement, mais dans un contexte purement privé et il circule sans son accord", indique Isabelle Gouleret, secrétaire académique du SNPDEN. Le cabinet du ministère de l'éducation, Xavier Darcos, attribue l'incident à un cafouillage local, l'inspecteur d'académie ayant omis de "faire le point avec son recteur sur les enveloppes budgétaires" disponibles. Le recteur, alerté par les réactions, a adressé le 1er février une note aux chefs d'établissement concernés "pour leur confirmer que le dispositif était intégralement financé". Le Monde 11/02/08 |
La frontière entre école et justice devient perméable |
Extraits
Coauteur d’un ouvrage
sur la violence à l’école, Claude Lelièvre n’hésite pas à parler de « judiciarisation »
de relations au sein des établissements. « En dix ans, les plaintes de
parents à l’encontre des profs ont quadruplé pour grimper à environ 1
000 dossiers par an. Dans 25 % des cas, il s’agit d’accusations de
pédophilie, accusations infondées dans trois cas sur quatre. Pour le
reste, il est surtout question de gifles, de coups de pied ou de
violence verbale », note ce spécialiste de l’histoire de l’éducation.
« Environ 70 % des
incidents déclarés se traitent au niveau de nos associations
départementales, qui jouent le rôle de médiateurs et qui, par exemple,
arrivent à convaincre des parents ayant insulté un prof devant sa classe
de lui présenter des excuses publiques », indique Alain Aymonier,
président de la Fédération des autonomes de solidarité (FAS). « La
judiciarisation produit souvent des inimitiés irréparables »,
commente-t-il. |
Quels remèdes au malaise enseignant ? |
Extraits Le malaise enseignant, vieille rengaine. La commission, présidée par le conseiller d'État Marcel Pochard a déniché un rapport datant de 1889, le rapport Ribot, qui l'évoquait déjà. À 87 %, les enseignants affirment aimer leur métier, leur discipline, le contact avec les élèves. Mais, à 80 %, ils ne croient plus à la démocratisation de l'Éducation nationale, à l'égalité des chances. L'identité professionnelle reste très forte, avec un attachement indéfectible à la liberté pédagogique. La classe et la discipline sont prioritaires, ce qui « ne facilite pas la coordination et le travail en équipe. » Favoriser ce travail collectif, développer de nouvelles formules pédagogiques : depuis dix ans, chaque ministre en fait son cheval de bataille. Sans succès. Par contre, relève le rapport Pochard, « c'est sur ce terrain que les établissements d'enseignement privé ont fait porter leurs efforts et assuré leur image de marque. » « L'effet établissement est au moins aussi déterminant que l'effet maître. » La commission s'est rendue à cette évidence : « les pays qui obtiennent les meilleurs résultats dans les évaluations internationales laissent à leurs établissements scolaires une grande autonomie pédagogique. » la commission suggère « d'autoriser et d'encourager les initiatives locales, seules capables de prendre en compte la diversité des publics et des ressources existantes ». Autonomie pour l'organisation du temps scolaire et du travail des enseignants. Ne plus raisonner seulement en heures de cours et salle de classe. Place au collectif. Avec évaluation, « interne et externe », « fiable et transparente », de chaque établissement. Sans évoquer des rémunérations au mérite, la commission propose de distinguer clairement le coeur du métier et ses obligations, et ce qui relève du soutien, tutorat d'élèves, actions de partenariat. « Une définition floue du métier contribue à faire apparaître comme optionnelles un certain nombre d'activités pourtant indispensables à la réussite des élèves. » Ouest-France 04/02/08 Le rapport Pochard téléchargeable Marcel Pochard au sujet de la Commission sur le métier d’enseignant : « Il y a eu arrière-pensée tactique du ministère » La Lettre de l'éducation 10/03/08 |
"Le temps n'est pas encore venu" d'une rémunération à la performance des enseignants |
Extraits La commission souhaite une "responsabilité" accrue de chaque établissement en matière pédagogique. La "complexité", écrit-elle, ne peut pas être gérée au niveau national, en appliquant "indistinctement" les mêmes normes, par exemple pour dédoubler une classe. Les établissements devraient avoir la maîtrise d'au moins 10 % de leur dotation en heures d'enseignement. L'instauration d'un "lien contractuel" entre l'établissement et l'enseignant est envisagée. "Plus libres", les établissements seront aussi "plus comptables de leurs résultats". "c'est la performance de l'établissement qu'il faut évaluer" La commission rappelle qu'un cahier des charges de la formation des maîtres a fixé, en 2006, un ensemble de compétences que chaque enseignant doit maîtriser en sus du savoir académique. Elle propose de distinguer trois parties : un "cœur du métier" commun à tous les enseignants (transmission des savoirs, préparation des cours, correction des copies, gestion de la classe); une liste d'activités "indissociables de l'acte d'enseignement" (de l'accompagnement des élèves à l'aide à l'orientation); enfin, des "activités modulables", selon les enseignants et les établissements. Les 18 heures de cours par semaine des professeurs certifiés, sur 36 semaines scolaires obligatoires pourraient définir une obligation annuelle de 648 heures de cours. Pour les jeunes enseignants, la commission ne dit pas comment éviter qu'ils soient nommés dans les zones les plus difficiles, mais préconise l'attribution d'une "dotation à l'installation" Le Monde 01/02/08 Voir aussi : Plus présent, plus réactif, plus performant : voici le "flexiprof" |
Rocard : «Améliorer l'évaluation des enseignants»
|
Extraits En moyenne, le pouvoir d'achat des enseignants, notamment en milieu de carrière, ne s'est pas détérioré, d'autant que l'écart par rapport aux cadres du privé s'est resserré. En outre, ils bénéficient de la sécurité de l'emploi. l existe cependant un vrai problème pour les jeunes enseignants du primaire en début de carrière, qui sont très mal payés.I Actuellement, les enseignants du secondaire sont tenus d'assurer dix-huit heures de présence devant la classe. Ce serait une révolution trop perturbante de changer ce système. En revanche, on peut réfléchir à des modifications, concernant notamment la multitude d'activités qui sortent de ce cadre : corrections des copies, préparation des cours, relations avec les parents, préparations des activités pédagogiques. Elles pourraient être mieux reconnues et prises en compte. Les enseignants sont notés. Mais le système de notation ne marche pas. Tout le monde a la même note ! Soit entre 18 et 19,5/20 ! nous n'évoquons pas directement dans notre rapport une rémunération au mérite. Mais c'est certain : il faut améliorer la prise en compte de la performance dans le déroulement des carrières des enseignants. L'éducation nationale souffre d'un excès de réformes à amples prétentions qui se superposent. Il faut se guérir de cela. Refaire une réforme semble illogique avant d'évaluer ce qui a déjà été fait. Il faut améliorer la gestion quotidienne, multiplier les améliorations de détail les miniréformes et accompagner les enseignants plutôt qu'accumuler les grandes réformes, et mieux connaître le système. Le Figaro 30/01/08 Voir aussi Michel Rocard : «Je suis l’objet d’une agression de la part du Figaro» Michel Rocard a démissionné de la commission Pochard sur la revalorisation du métier d’enseignant. En cause, la polémique sur la «rémunération au mérite» des professeurs, évoquée dans le Figaro. Libé 31/01/08 |
Ce que seront les enseignants de demainAlors qu’une commission à laquelle participe Michel Rocard doit rendre la semaine prochaine ses préconisations sur « l’évolution du métier d’enseignant », des personnalités évoquent les qualités qu’ils attendent des professeurs de demain |
Extraits
L’écrivain, Hervé
Hamon, voudrait qu’à l’avenir plus aucun élève ne soit considéré comme «
non éducable » et que les enseignants soient à même d’aider les élèves
en difficulté « autrement qu’en répétant ce qui n’a pas marché ».
Jean-Michel
Zakhartchouk, l’un des animateurs de la revue Les Cahiers pédagogiques,
pointe la nécessité croissante de « travailler avec les autres,
d’accepter de faire cours à deux, bref d’en finir avec la conception
d’un prof à l’abri des regards, qui reste le roi dans sa classe, même
s’il est souvent un monarque un peu ridicule, faute de reconnaissance de
la part de ses élèves ». Mais, pour Daniel Picouly, à vouloir dresser ce petit portrait-robot de l’enseignant de demain, on risque fort de faire peser toute la responsabilité sur les professeurs et d’oublier ainsi « l’essentiel », le fait qu’ils évoluent dans un système éducatif plus que perfectible. « Qu’attend-on des professeurs ? Qu’ils aident leurs élèves à devenir des citoyens ? Qu’ils les préparent à un métier ? Qu’ils leur apprennent à apprendre ? » L’écrivain a passé vingt-cinq années de sa vie à enseigner dans un système qu’il juge à la fois sur-administré et sous-encadré. « Jamais, dit-il, je n’ai eu l’impression que ce débat avait été tranché. » La Crois 28/01/08 Voir aussi : Les futurs professeurs devront être mieux évalués |
« Éduquer, ce n’est pas produire des individus calibrés »Pour le pédagogue Philippe Meirieu, le rapport Attali valide une vision utilitaire de l’école, au détriment d’ambitions culturelles déjà déficitaires. |
Extraits Faire croire [que la relance économique] s’obtiendra en mettant l’éducation au service de l’économie [est assez affligeant]. C’est au contraire en poussant l’école à mieux assurer sa mission culturelle, civilisatrice et émancipatrice que l’on y parviendra. En permettant aux citoyens de prendre en mains l’économie et de la faire conforme à leurs vœux. L’économie n’est pas une science exacte : il en existe des conceptions diverses. Or, je crains qu’elle ne soit envisagée que sous l’angle libéral. Que l’on ne laisse croire, par exemple, que les entreprises mues par la concurrence sont les seules à produire des richesses, en oubliant de dire que l’économie est également portée par ceux qui placent la solidarité au premier plan. Le socle commun de connaissances tel que le défend la commission Attali néglige les dimensions culturelles au profit de l’anglais commercial, par exemple. Déjà déficitaire, l’ambition culturelle passe à la trappe au profit d’une vision instrumentaliste de l’école. Associer élèves et parents à la réflexion sur l’école n’a rien à voir avec le fait d’en faire des évaluateurs, des consommateurs qui jugeraient du meilleur rapport qualité prix. La relation pédagogique se négocie dans la durée, une politique de prévention ne peut pas s’évaluer puisque prévenir c’est précisément empêcher d’advenir. Éduquer, ce n’est pas produire des individus calibrés. L'Humanité 23/01/08 |
Les jeunes et leur avenir compliquéJean-Michel Djian Professeur associé à Paris 8
|
Extraits Ils sont 26 % de jeunes Danois à croire que « l'avenir est prometteur ». Viennent ensuite les Américains (18 %), les Suédois, les Russes, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais... et, enfin, les Français avec 4 %. La plus surprenante des réponses est peut-être celle où les jeunes Français sont les seuls à affirmer que « l'obéissance est une qualité plus importante à développer chez l'enfant que l'indépendance ». Un jeune Français sur deux - 54 %, record mondial - estime que le regard des autres est déterminant dans ses choix professionnels. Interrogés sur l'emploi, ils ne sont que 27 % à être certains que la société leur procurera un « bon travail ». Dans le même temps, ils sont, avec les Russes, ceux qui « redoutent le plus le libre échange et la concurrence mondiale ». Si l'on en croit les conclusions de cette enquête, les jeunes se réfugieraient dans « l'intime », c'est-à-dire dans « la famille, l'amour et la fidélité ». Contrairement aux idées reçues, ils s'engagent dans les associations ; encore faut-il préciser si c'est pour adhérer à un club de tennis ou bien pour lutter contre le réchauffement planétaire. D'évidence, pour les enquêteurs, il « existe une crise de confiance des nouvelles générations dans les institutions ».Ouest-France 23/01/08 |
Alerte sur le "niveau" scolaire |
Extraits Réalisée dans 57 pays représentant 90 % de l'économie mondiale et publiée le 5 décembre, l'enquête internationale PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de 2006 montre que les compétences des élèves français de 15 ans se situent un peu en dessous de la moyenne des 30 pays de l'OCDE. Les nouveaux résultats marquent un recul de plusieurs rangs dans les classements par domaines de compétences. Consacré aux compétences des élèves de 10 ans, le rapport Pirls 2006 (" Progress in International Reading Literacy Study"), réalisé dans 40 pays par l'Association internationale d'évaluation (AIE) et publié le 28 novembre, classe la France à la 27e place. Depuis le premier rapport, en 2001, ses résultats ont stagné, alors que d'autres pays ont progressé. Dans leurs versions les plus virulentes, les discours sur la baisse du niveau - "une vieille idée de vieux", se moquaient Baudelot et Establet - souffrent d'un défaut historique : si toutes les personnalités éminentes qui se sont émues d'une baisse avaient eu raison, c'est depuis l'Antiquité que l'humanité serait en régression. Une étude sur les compétences des élèves en orthographe grammaticale, publiée en 2007 par les linguistes Danièle Manesse et Danièle Cogis, a établi qu'en vingt ans s'était produit un glissement de deux années scolaires : une cinquième de 2006 était au niveau d'un CM2 de 1987. En revanche, l'idée répandue d'un développement récent de "l'illettrisme" est démentie par l'Insee : dans la population française la plus âgée, sortie du système scolaire dans les années 1950 et 1960, la proportion de personnes en difficulté avec l'écrit est nettement supérieure à celle constatée dans les générations suivantes. Vincent Troger, maître de conférences à l'IUFM de Versailles, a recours à l'image de ces épreuves de marathon largement ouvertes aux amateurs : beaucoup abandonnent avant la fin, mais personne n'en conclut que le marathon "n'est plus ce qu'il était". Notre système scolaire de masse - où le collège accueille près de 100 % d'une tranche d'âge, le lycée environ 80 % et où 64 % d'une génération obtient le baccalauréat - est dans une situation comparable. Il fait monter le niveau moyen d'instruction, mais inclut des éléments défaillants au regard des normes d'antan. C'est le noyau d'élèves en difficulté, lui-même étroitement corrélé aux situations sociales défavorisées, qui "plombe" les scores nationaux. Pour Nathalie Mons, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Grenoble-II, "ce n'est pas en s'intéressant strictement aux élites que l'on remonte le niveau global mais en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'élèves qui décrochent". Le Monde 16/12/07 |
|
L’école française en difficulté |
Extraits «Les pays qui ont les meilleures performances ont réussi à limiter le nombre d’élèves en difficulté, sans comparaison avec les taux français, souligne Nathalie Mons, maître de conférences en sciences de l’éducation à Grenoble-II (1). Cela prouve que pour avoir de bons résultats, on ne peut pas se contenter de développer une élite.» Pour la chercheuse, la France doit mettre en place un enseignement individualisé pour chacun, une méthode qui a fait ses preuves en Finlande, par exemple, et ne plus se limiter à des heures de soutien individuel qui stigmatisent les mauvais élèves. Ce que le gouvernement s’apprête à faire dans le primaire. La part des élèves issus de l’immigration, qui réussissent moins bien que les autres, n’expliquent pas le retard de la France. Les dépenses d’enseignement ont, selon PISA, un impact limité. En dix ans, elles ont augmenté de 40 % dans l’OCDE alors que les performances ont pour la plupart stagné. Libé 05/12/07 PISA 2006 résultats : différents documents téléchargeables |
| La France paralysée devant ses mauvais résultats scolaires |
Extraits L'OCDE, qui teste près de 400 000 élèves de 15 ans scolarisés dans 57 pays, a choisi de se concentrer cette fois sur les sciences. Alors que les élèves finlandais caracolent une nouvelle fois en tête du classement, les Français plafonnent légèrement en dessous de la moyenne. En 2003, la France était à la 10e place pour les sciences, il est vrai avec des tests un peu différents. Elle recule cette année au 19e rang parmi les trente pays de l'OCDE. En lecture, la France a ainsi rétrogradé entre 2000 et 2006 de la 14e place à la 17e place. Même chose en mathématiques, où les Français sont passés en trois ans du 13e au 17e rang. "La France et le Japon ont vu leurs performances en lecture diminuer, mais pour des raisons diamétralement opposées. En France, c'est la proportion d'élèves en difficulté qui a augmenté, alors qu'au Japon c'est celle des bons élèves qui a baissé", développe Eric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Lundi 3 décembre, sur France-Culture, M. Darcos évoquait ainsi les mauvais résultats en mathématiques des élèves français pour justifier de "remettre de l'école dans l'école" et plaider en faveur d'un recentrage du primaire sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'un des axes de sa future réforme. Le Monde 05/12/07 Les recommandations de trois scientifiques sur l'enseignement des sciences Le Monde 05/12/07 |
|
Egalité des chances ? pour qui ? Patrick Savidan, président de l'Observatoire des Inégalités, maître de conférences en philosophie à l'université de Paris-Sorbonne |
Extraits La conception fortement individualiste de l'égalité des chances, telle qu'on la pratique aujourd'hui, se révèle, dans les faits, injuste. Car plus je crois au mérite individuel, moins je suis disposé à contribuer à l'effort de solidarité pour une société juste. L'école est dans une phase de régression au regard de la correction des inégalités. Le bac S est une filière socialement survalorisée. Or on sait qu'un enfant de cadre a huit fois plus de chances de le décrocher qu'un fils d'ouvrier ! Les classes préparatoires comptent 6% d'enfants d'ouvriers et 42% d'enfants de cadres ! Une sanction sociale s'installe : aux enfants de cadres les études longues, et aux enfants de milieux défavorisés la sortie rapide de l'enseignement général. La mise en cause du collège unique s'inscrit dans cette logique. Revenir à des formes de sélection précoce, c'est donner à terme le sentiment que les inégalités sont inscrites dans une nature ! Dans ce contexte injuste, l'égalité des chances est impuissante ! Le président Sarkozy ne s'adresse pas à des groupes, mais à des individus. Selon lui, la réponse aux problèmes sociaux passe d'abord par ces derniers. Prenons l'exemple de la carte scolaire. Cette réforme consiste à dire que les parents pourront choisir l'établissement scolaire de leurs enfants. Solution individuelle au problème de l'inégalité entre les quartiers ! Sarkozy n'essaie pas d'améliorer le système, mais donne aux personnes la possibilité de se mouvoir plus librement à l'intérieur d'un ordre qui demeure injuste. Si une pensée progressiste doit retrouver de la consistance, c'est en démontant ce «tout-individuel». Il ne s'agit pas d'en finir avec l'individualisme, mais d'en promouvoir une forme qui soit moins aveugle aux données extérieures à l'individu. Nel Obs hebdo 25/10/07 |
Ecole : les Français exigent de l'autorité
|
Extraits Les Français souhaitent le retour de l'autorité à l'école. Et ils veulent que les élèves respectent cette autorité. Pour cela, pas de mystère, ils attendent davantage de discipline de la part des enseignants. L'obligation de se lever quand le professeur entre en classe : 79 % des Français sont favorables à l'application d'une telle règle de vie dans les établissements. Même les plus jeunes - ceux qui la connaissaient le mieux puisqu'ils viennent de la quitter - y souscrivent. Ils sont en revanche unanimes à ne pas vouloir le rétablissement du port de l'uniforme. Un thème tout aussi fédérateur : le lien entre l'école et l'entreprise qui est estimé insuffisant par la majorité des sondés. Ils sont aussi très inquiets du trop grand nombre d'élèves par classe. Les parents d'élèves et les plus jeunes y sont plus sensibles que les autres. Ils estiment par ailleurs que le soutien aux élèves en difficulté et l'accueil des élèves handicapés ne sont pas satisfaisants. Les Français sont globalement plutôt satisfaits de leur école. La qualité de l'enseignement, la mixité sociale ou la charge de travail sont également considérées comme convenables. Le Figaro 09/10/07 L'école en mal de correction Le Figaro 09/10/07Ecole: les Français pour une pédagogie plus diversifiée et davantage de discipline AFP 09/10/07Les Français réclament plus d'autorité à l'école Libé 09/10/07 Ecole : les parents satisfaits mais qui demandent un retour de la discipline Le Monde 10/10/07 |
« Le collège unique est un idéal à défendre »Entretien avec le sociologue Choukri Ben-Ayed |
Extraits Construire le collège unique a pris des décennies. On ne peut pas le remettre en cause en quelques semaines. Cela posé, je pense que cette proposition,[ adapter les enseignements au profil des élèves], en apparence de bon sens, ne s’appuie sur aucun élément solide démontrant que la demande des familles est forte en la matière. Aucune enquête n’établit qu’elles jugent le nombre d’options insuffisant ou souhaitent une individualisation des parcours. On a ainsi le sentiment que le politique crée lui-même un problème que les intéressés ne formulent pas en ces termes. La même chose s’est produite au sujet de la carte scolaire. Ces deux propositions ont également en commun le fait de négliger le destin collectif et d’ériger la réussite individuelle comme matrice du fonctionnement social. Le système éducatif, aujourd’hui, souffre plus d’une trop forte différentiation que d’une trop grande homogénéité. Les établissements se différencient par leur recrutement social ou ethnique et par leurs résultats scolaires. Ce n’est pas parce que le collège unique n’existe pas que son idéal n’existe pas. Proposer le collège unique comme modèle implique une ambition : celle de la réussite de tous, inscrite dans la loi. Autrement dit, c’est un idéal au même titre que l’idéal démocratique. Le fait qu’il existe en tant que tel structure les représentations des professionnels. Ils savent qu’ils doivent faire des efforts pour amener tout le monde au niveau supérieur, parce que la nation l’a décidé. Les familles aussi le savent et nourrissent, de fait, un espoir vis-à-vis du collège. Cet objectif met en tension le système, mais positivement. Il force à résister au renoncement et à la logique du déterminisme scolaire précoce. C’est cela, la fonction du collège unique. L'Humanité 24/09/07 |
Dix-sept organisations de l'éducation appellent à ne pas enterrer le collège uniqueFSU, SNES-FSU (collège-lycées), SNEP-FSU (éducation physique et sportive), SNUipp-FSU (primaire), CFDT, SGEN-CFDT, FEP-CFDT (enseignement privé), UNSA-Education, SI-EN-UNSA (inspecteurs), SE-UNSA (enseignants), SNPDEN-UNSA (chefs d'établissement), UNL (lycéens), UNEF (étudiants), FCPE (parents), Ligue de l'enseignement et de la jeunesse en plein air (associations). |
Extraits Xavier Darcos avait déclaré, le 6 septembre, qu'il fallait "parler au passé" du collège unique et le remplacer par "une plus grande autonomie des établissements". Selon les organisations, le ministre "omet de préciser que le collège unique, c'est l'unicité de la nature des établissements et pas l'uniformité de ce qui y est fait"."Ce qui est en jeu, ajoutent-elles, c'est la garantie d'un même droit à la scolarité obligatoire pour tous les élèves." si la disparition du collège unique se traduit par une "sélection précoce", celle-ci, "associée à la suppression de la carte scolaire, ne pourrait qu'aggraver les inégalités scolaires". Ce "serait incompatible avec l'objectif fixé de 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur et entraînerait une régression des résultats (–30 % d'accès au bac), ainsi que l'ont démontré les études internationales" |
|
L’école française obtient la moyenne L’OCDE a comparé les systèmes éducatifs de plusieurs pays, du salaire des enseignants à la réussite scolaire |
Extraits Comparée aux autres, la France ne s’en sort pas si mal. En plein débat sur la crise de l’éducation, le dernier rapport annuel de l’OCDE (Organisation européenne de coopération et de développement économiques), dévoilé hier, relativise les hauts cris sur la catastrophe scolaire. Certes, en France les enfants d’ouvriers ont toujours deux fois moins de chances que les autres de faire des études supérieures. Et les salaires des enseignants sont à la traîne. Mais les diplômés du supérieur sont toujours plus nombreux, grâce notamment aux filières courtes. Pour le bac aussi, les experts de l’OCDE sont sur la même longueur d’ondes que le ministre, Xavier Darcos, qui est favorable à une réforme. «Une individualisation des cursus scolaires et la mise en place d’un baccalauréat avec options plutôt que divisé en filières semblent aller dans le bon sens pour augmenter le nombre de bacheliers et diplômés du secondaire [CAP ou BEP, ndlr]», estime Eric Charbonnier, de la direction de l’éducation à l’OCDE. En revanche, les spécialistes ne soutiennent pas les appels à la suppression du collège unique. Le rapport souligne la lourdeur des programmes français. De 7 à 14 ans, un élève passe 7 700 heures à l’école, au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Pour la première fois, l’OCDE se penche sur les résultats des populations immigrées. Un peu partout, la deuxième génération d’enfants d’origine étrangère réussit mieux que la première, en Suède et dans une moindre mesure en France, où leurs résultats restent inférieurs aux autochtones. Libé 19/09/07 Trop d'heures de cours au collège et au lycée Le Figaro 19/09/07Regards sur l’éducation 2007 : rapport de l’OCDE téléchargeable |
Éric Maurin tacle les « catastrophistes »L'ambition d'une même éducation pour tous, jusqu'à 16 ans, est aujourd'hui remise en cause. Jusque dans les rangs du gouvernement. Éric Maurin, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, vient de publier un livre à contre-courant qui fait beaucoup de bruit |
Extraits On s'inquiète aujourd'hui du fait que 60 % des enfants seulement auraient le niveau nécessaire pour suivre correctement la classe de sixième. Mais il y a quarante ans, ils n'étaient que 30 %, selon une très sérieuse étude de l'époque réalisée, académie par académie, sur le niveau de lecture, l'orthographe, les maths... Tout démontre au contraire que le grand élan de démocratisation de l'école depuis un demi-siècle - avec le collège pour tous et la fin de la sélection en classe de cinquième - a donné de bons résultats. Je ne nie pas les faiblesses de notre système. Il est trop inégal. Trop d'élèves en difficulté et d'étudiants en échec à l'université. Mais, au nom de ces problèmes réels, on ne peut pas disqualifier ce qui a été fait. La démocratisation de l'école doit être poursuivie. Un nouvel élan est d'autant plus nécessaire qu'en France, la sélection se maintient sous des formes déguisées : classes de niveaux, jeux d'options, fortes inégalités entre collèges.. Beaucoup d'élitistes pensent qu'il est contre-productif d'essayer de faire suivre les mêmes enseignements à tous les enfants jusqu'à 16 ans. Le collège pour tous conduit inéluctablement, à une perte de qualité des enseignements, à une dramatique baisse de niveau, tout cela débouchant sur une crise de civilisation. C'est une vision nostalgique de l'école sélective d'autrefois, très en vogue chez les souverainistes. L'école de la République fiche le camp et, avec elle, la nation française. Les malthusiens, eux, pensent que l'économie n'est pas au rendez-vous des efforts réalisés par le système éducatif. Trop de chômage. On formerait des gens pour rien, les diplômes seraient en monnaie de singe. Élitistes et malthusiens ne partagent pas les mêmes idées, mais une même conclusion: il est temps d'arrêter les frais de la démocratisation. Ces visions sont en totale contradiction avec les faits. Des générations d'enfants de paysans, de pêcheurs, d'ouvriers ont eu un destin social sans rapport avec celui qui aurait été le leur s'il n'y avait pas eu l'avènement du collège unique. On ne peut pas l'oublier, au nom d'un âge d'or de l'école qui n'a, de fait, jamais existé. Ouest-France 13/09/07 Indice de crème scolaire Eric Maurin souligne les bienfaits du collège unique, et propose de poursuivre la démocratisation Libé 13/09/07 École : fausses idées et vrais problèmes Ouest-France 24/09/07 |
|
La France devra choisir sa politique éducative parmi les modèles dominants dans les pays de l'OCDE Nathalie Mons |
"Avançant par touches, sans communication claire, sans cohérence globale ni envergure politique, la réforme à la française entraîne difficilement l'adhésion des acteurs du monde éducatif (...) Pour autant, cette laborieuse réforme des petits pas n'a pas conduit qu'à des erreurs." C'est l'une des conclusions de l'ouvrage de Nathalie Mons (Grenoble-II), "Les nouvelles politiques éducatives" (à paraître novembre 2007 aux PUF). Si "la France n'a pas choisi les voies optimales tant en termes d'efficacité et d'égalité scolaires", si "sa décentralisation timorée, son école unique monolithique, le dogme intangible d'une carte scolaire de fait contournable conduisent à des résultats médiocres et à des inégalités sociales bien supérieures à celles" qu'elle prétend produire, elles ont pu éviter certaines erreurs commises dans d'autres pays. En France, au Japon et au Portugal, des mesures de "décentralisation minimale" peinent à "remettre en cause les structures traditionnellement centralisées". D'autres pays, en Europe scandinave surtout, "ont réussi à mettre en œuvre des décentralisations tempérées mais réelles".
Les remise en cause
de l'école unique, "empruntent deux voies bien distinctes". Certaines
visent une "l'intégration individualisée" des élèves et tendent à
personnaliser les parcours scolaires "sans diversifier les objectifs
pédagogiques". Elles contestent "les méthodes traditionnelles de l'école
unique. Le principe de l'enseignement en classe entière, sans adaptation
aux profils des élèves et, son nécessaire corollaire, le redoublement,
sont rejetés." C'est "le seul modèle de gestion de l'hétérogénéité
capable de limiter les inégalités scolaires générales et d'origine
sociale"; il est associé à "un niveau éducatif général élevé, une
proportion d'élèves en difficulté faible et une élite développée". Dépêche n° 83197 © Copyright L'AEF - 1998/2007. Publié avec l’aimable autorisation de L’AEF |
|
40% des collégiens
n'ont pas le niveau Le Nouvel Obs publie un dossier entièrement rédigé dans l'esprit de "Sauver les lettres". On pourrait certes stigmatiser les journalistes du Nouvel Obs qui ont instruit leur dossier à sens unique, en ignorant les travaux des meilleurs spécialistes. Tant est grande la tentation du déclin. (Le Café pédagogique 06/09/07) |
Extraits Il faut crever l'abcès. Depuis des années, les signaux d'alerte se multiplient. On se lamente sur les élèves qui ânonnent en sixième. L'opinion s'enflamme sur les calamiteuses conséquences de la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Des parents effarés déplorent les copies truffées de fautes d'orthographe de leurs rejetons. Ils plaisantent - pour ne pas pleurer - sur cette grammaire fumeuse, le «groupe nominal sujet» et autres «complément d'objet second», qui embrouille petits et grands. Tout cela mis bout à bout finit par dessiner le tableau d'une authentique faillite : l'école échoue à enseigner correctement le français. En arrivant en sixième, le mal est déjà fait. Contrairement à ce que l'on ressasse, ce n'est pas au collège, le fameux «maillon faible», que la crise se noue. Mais au primaire, pendant ces années bénies où l'enfant, croit-on, est le mieux pris en charge. Le HCE recense en effet à l'entrée en sixième un premier noyau dur d'enfants (15%) qui ne maîtrisent rien du français écrit ou oral : ils souffrent d'un QI trop faible ou d'une dyslexie sévère, ou ils ont subi les conséquences d'un divorce ou de violences qui ont bousculé leur apprentissage. Au collège, ils vont être les premiers à décrocher et à quitter le système éducatif sans diplôme. On les retrouve, aux journées d'appel de préparation à la défense, étiquetés «illettrés»*. le Haut Conseil identifie un deuxième groupe d'élèves (25%) aux acquis fragiles, «condamnés à une scolarité difficile au collège et à une poursuite d'études incertaine au-delà» Quant au reste de la troupe, ceux qui n'appartiennent pas aux deux groupes sinistrés, il fait son chemin à la va comme je te pousse, écrivant dans une langue émaillée de fautes, ponctuée à la diable, bourrée d'abréviations venues du langage SMS.. * L’auteure de l’article n’a pas dû consulter les résultats de la JAPD, car elle aurait constaté que près de 8 jeunes de 17 ans sur 10 sont des lecteurs efficaces (78,7 %) et que les lecteurs en difficultés ne sont plus que 11,7 % au lieu de 15 (on ne « les retrouve » donc pas tous) Cf http://media.education.gouv.fr/file/25/6/5256.pdf Elle n’a pas lu non plus les enquêtes de l’INSEE sur l’illettrisme qui font apparaître clairement que celui-ci croît très significativement avec l’âge : 7% des 18-29 ans, 22 % des 60-65 ans en grandes difficultés (http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1044.pdf) |
|
Les Français et l'école |
88% des Français concernés (élèves âgés de plus de 15 ans et parents d’élèves), se disent satisfaits de leur école, de leur université, ou de celle de leurs enfants (dont 32% qui se disent très satisfaits). Une satisfaction qui s’avère relativement comparable selon que l’on est élève (84%, dont 27% de très satisfaits) ou parent d’élève (89%, dont 34% de très satisfaits). Les parents d’enfants en maternelle confirment cette tendance (94% pour 88% en moyenne). Les élèves et les parents se disent donc très satisfaits de l’école et de la formation des enseignants ; améliorations souhaitées : davantage de moyens et modernisation de l’enseignement ; des divergences entre les élèves et les parents apparaissent sur la perception des difficultés du milieu scolaire ; enfin, la violence à l’école est perçue comme verbale avant tout et variable selon les régions. TNS-SOFRES 06/09/07 |
|
Votre lettre a semé la confusion Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays de la Loire, président de la commission éducation de l’association des régions de France |
Extraits Non, l’échec scolaire n’a pas atteint récemment des niveaux qui ne sont pas acceptables, il a toujours existé et nous devons tous travailler à le résorber. Non, la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas plus brutale que celle d’hier. Non, on ne peut pas mettre au même niveau dans le processus éducatif le juge et l’enseignant ou le policier et le parent. Où sont les promesses sur les ZEP - vous parliez de plan d’urgence en faveur des établissements «en marge du progrès scolaire» -, où sont les écoles de la deuxième chance, où sont les efforts particuliers en faveur de l’enseignement professionnel et technologique ? Partenaires essentiels de l’éducation, les associations d’éducation populaire ouvrent les jeunes à la citoyenneté, à l’acquisition de l’esprit critique, à la curiosité sur le monde et à la diversité culturelle. Cette promotion du «faire ensemble» apporte aux jeunes des expériences irremplaçables qui structurent leur personnalité. Ils y apprennent que la vraie autorité, dans le champ social, c’est le savoir, mais aussi le savoir-faire, au travail, sur un terrain de sport ou dans la mise en œuvre d’un projet. Enfin, les collectivités locales, communes, départements, régions, ont investi le champ de l’Education nationale de façon massive : financement et entretiens des locaux d’enseignement, équipements pédagogiques, transport des élèves, mais aussi financement des actions sociales et éducatives et vie périscolaire. Or tout votre propos renvoie à une vision de la réussite scolaire fondée uniquement sur la réussite individuelle, indépendamment de tout environnement social. Là réside la grande différence entre la gauche et la droite. Libé 10/09/07 Le catalogue régressif de l’école néolibérale L'Humanité 12/09/07 |
Faut-il revenir aux « bonnes vieilles méthodes » ?Apprentissage . Face à l’échec scolaire, les promoteurs d’une pédagogie à l’ancienne gagnent du terrain. Sans pour autant convaincre le monde enseignant |
Extraits En 2006, Gilles de Robien a ainsi mené croisade contre la « méthode globale » d’apprentissage de la lecture, coupable, selon lui, d’avoir engendré des générations d’illettrés et de dyslexiques. Peu importe que celle-ci ne soit plus employée depuis des années. Il faut imposer la seule méthode syllabique et son B.A.-BA classique. Selon le récent rapport du haut conseil de l’éducation (HCE), environ 15 % des enfants, souffrant d’un QI trop faible ou d’un environnement social trop délabré, entre en sixième en ne maîtrisant rien du français écrit ou oral. Tandis qu’un autre noyau - 25 % des élèves - aurait, lui, des acquis fragiles occasionnant une « poursuite d’études incertaine ». Face à ce constat, Samuel Joshua, professeur en science de l’éducation à l’université de Provence, tempère : « La situation n’était pas meilleure il y a quarante ans. Sauf qu’à l’époque, on ne le voyait pas : l’école était beaucoup plus élitiste et excluait toute une partie de la population sans que personne n’en soit choqué. » « Qu’elle soit traditionnelle ou moderne, tout le monde fait de la pédagogie ! Celle-ci a toujours été discutée et reste en constante évolution. » « S’il est exact que les méthodes pédagogiques participent de la lutte contre l’échec scolaire, il ne faut pas, non plus, en faire un bouc émissaire. Elles peuvent être plus propices à la réussite de tous les élèves mais ne peuvent pas tout non plus ! Ni contrer le matraquage commercial des télévisions, ni réduire les inégalités sociales ou élaborer une politique ambitieuse dans les zones sensibles… » L'Humanité 07/09/07 |
|
«Sarkozy dit tout et son contraire» François Dubet, sociologue et spécialiste de l’éducation, analyse la lettre du président Sarkozy. |
Avec une expression très forte — «je veux», «il faut» —, le président dit des choses contradictoires, comme si on attendait de l’école qu’elle fasse tout. L’enfant est un individu singulier, dit-il par exemple, qui doit être reconnu comme tel, mais il explique aussi qu’il faut revenir aux vieilles méthodes d’autorité. Il parle d’égalité et de culture commune, mais, en même temps, le collège unique est menacé avec son allusion à une sélection à l’entrée en sixième. Il loue la civilisation universelle mais aussi l’école de la République, patriotique. Il défend la culture générale, mais aussi la science et la technique, de même pour les disciplines et l’interdisciplinarité. Enfin, il valorise la leçon traditionnelle — et dit qu’il faut ouvrir les fenêtres sur le monde. L’air du temps est au conservatisme, majoritairement au sein de la droite mais la gauche n’est pas épargnée. En fait, le discours présidentiel est très balancé: il donne des gages aux conservateurs mais, comme s’il savait que l’avenir de l’école n’est pas là, il donne aussi des gages au camp des «pédagogues». Il faut rappeler qu’on a eu quand même trente ans d’augmentation continue des moyens, le quota adultes-élèves, surtout au lycée, est exorbitant. En fait, ces moyens supplémentaires ont surtout été utilisés pour ne pas réformer, avec l’argument qu’avec plus de moyens on allait s’en sortir… On ne peut continuer à avoir un système scolaire qui est l’un des plus gros consommateurs de PIB avec des résultats aussi médiocres. Les inégalités ne sont pas corrigées et il y a toujours la même proportion d’élèves largués. Mais on ne voit pas du tout la direction qui va être prise. Libé 05/09/07 Nicolas Sarkozy critique à Blois le "collège unique" AFP 04/09/07Allocution du Président de la République : lettre aux éducateurs Selon Xavier Darcos, le collège unique est "aujourd'hui totalement dépassé" AFP 05/09/07
|
Repensons, maintenant, le métier d'enseignantJean-Pierre Boisivon, Michel Braunstein, Pierre Dasté, André Legrand, Jacky Richard, Georges Septours, anciens directeurs au ministère de l'éducation nationale, sont membres du club Par l'école
|
Extraits Alors qu'environ 150 000 [enseignants] devraient partir à la retraite dans les cinq prochaines années et que la pression des effectifs à scolariser n'est plus d'actualité, l'occasion est donnée d'adopter de nouvelles règles. Ce fut une erreur de ne pas concevoir des contenus de formation universitaire adaptés aux exigences spécifiques du métier de professeur des écoles, maître unique, de professeur des collèges, qui doit être polyvalent, de professeur des lycées, plus spécialisé dans l'enseignement d'une discipline. La réforme de notre système universitaire peut être l'occasion de porter à un haut niveau de compétence scientifique le master, la formation de tous les maîtres, en l'adaptant, non à des statuts préexistants, mais à des exigences pédagogiques manifestes. Saura-t-on faire [des IUFM], après une vraie réforme, de vraies écoles professionnelles, assurant tout à la fois la formation initiale et la formation tout au long de la carrière et dont l'Etat employeur déterminera le cahier des charges ? Le problème le plus criant se situe dans l'incapacité de l'institution scolaire de mettre en place des équipes stables d'enseignants motivés et expérimentés dans une minorité d'établissements situés dans les quartiers difficiles. Il faut, dans ces établissements, mettre en place des procédures dérogatoires en y associant fortement les chefs d'établissement : souplesse dans l'organisation des services, capacité de recruter localement des contractuels et de disposer d'enveloppes indemnitaires spécifiques modulables, réels avantages de carrière pour les enseignants titulaires... Notre système éducatif fondé sur des établissements du second degré de proximité ne peut fonctionner avec des enseignants (agrégés et certifiés) très majoritairement monovalents, qu'au prix de la multiplication des affectations sur plusieurs établissements, voire plusieurs communes, et d'un gaspillage de moyens. La seule solution est de mettre en place progressivement une bivalence chez les professeurs certifiés et de réserver les agrégés au lycée. Au collège, des enseignants certifiés bivalents, constituant une équipe pédagogique restreinte, donc plus facilement soudée, paraissent mieux en mesure de prendre en compte les besoins des élèves et le décloisonnement des disciplines. Les défauts du système actuel, qui amène presque tout le monde à progresser au même pas, et les voies d'une évaluation rénovée sont connus. Elles supposent que l'institution se préoccupe réellement du problème insupportable de ceux qui sont en difficulté professionnelle (ils ont en charge des jeunes et leur avenir...). Elles nécessitent une plus grande implication des chefs d'établissement, qui devraient être associés aux inspecteurs pédagogiques pour une évaluation globale. Le Monde 05/09/07 |
|
Christian Forestier, ancien recteur d'académie, membre du Haut Conseil de l'éducation "On a supprimé le bonnet d'âne mais on est encore loin de l'Europe du Nord"
|
Extraits Les 50 % d'élèves qui, à 15 ans, n'ont jamais redoublé dans le système français, et qui sont en seconde générale et technologique, obtiennent des résultats excellents, qui les placent très haut dans la hiérarchie internationale, alors que ceux qui ont redoublé, ne serait-ce qu'une fois, sont à des niveaux de performances médiocres, voire très médiocres. Le système est donc très clivé : très bon pour une moitié des élèves, médiocre pour l'autre. On a eu tort de stigmatiser le collège et de sanctuariser l'école primaire : l'ensemble de notre système doit être interpellé. Il ne serait pas sérieux de faire aujourd'hui à l'école maternelle un procès aussi faux que celui que l'on a fait au collège. Et si on changeait complètement d'approche ? En se disant, notamment au niveau de l'école primaire, que l'enfant n'est pas le premier responsable de ses difficultés. Nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces inégalités dues aux origines sociales et à un échec lourd important, de l'ordre de 15 % à 20% de chaque génération. Les pays qui font nettement mieux que nous ne sont pas nombreux. [Ils nous apprennent] l'importance d'une école obligatoire sans discontinuités, ce qui signifie pour nous le rapprochement de l'école et du collège. Et sans redoublement. [Ils] ont supprimé les structures à plusieurs vitesses en privilégiant un traitement individualisé de la difficulté. Ajoutons une grande liberté laissée aux équipes éducatives. Le Monde 04/09/07 |
|
Ecole : vive la démocratisation ! |
Extraits Un vent mauvais semble se lever. Il souffle en particulier sur l'école et, à travers elle, sur l'utopie d'émancipation dont elle fut à la fois le symbole et le laboratoire. Il faudrait, dit-on, avoir le courage de reconnaître tous les enfants ne sont pas égaux devant la connaissance et les apprentissages. La nature est ainsi faite qu'il y en aurait de capables et de moins capables. Et, par respect pour les capables autant que par égard pour les moins capables, la société aurait pour devoir de faire le tri le plus tôt possible de manière à sélectionner ses futures élites, à optimiser leur développement cognitif et leur utilité sociale, et à ne pas faire perdre trop de temps aux autres. Un certain malthusianisme est également de retour. Plus fatalistes qu'élitistes, les nouveaux malthusiens ne se prononcent pas tant sur la diversité des aptitudes individuelles que sur la réalité des débouchés offerts à la sortie de l'école Le marché du travail n'étant pas extensible à l'infini et le mouvement de recomposition des emplois étant en panne, l'offre d'insertion professionnelle ne parvient plus aujourd'hui à satisfaire la demande, ni en quantité ni en qualité. Les politiques de démocratisation scolaire, en augmentant déraisonnablement le volume et les exigences de la demande face à une offre désespérément fixe et décevante, auraient alimenté un processus de dévalorisation des diplômes et des titres en circulation. Les sceptiques utilisent des instruments souvent inadéquats pour mesurer l'effet des politiques de démocratisation scolaire. Il ne suffit pas de comparer à diplôme égal des jeunes gens de 25 ans aujourd'hui avec des jeunes gens de 25 ans il y a vingt ou trente ans, comme le font de nombreuses analyses. Car cet exercice compare ce qui n'est pas comparable et conduit immanquablement à des conclusions alarmantes, mais trompeuses, sur le déclassement des jeunes et la dévalorisation des diplômes. Nous ne pouvons plus, encore moins qu'hier, nous contenter de viser l'excellence pour quelques-uns, de sélectionner de petites élites et d'abandonner les autres à leur fragilité. Il nous faut au contraire penser un système éducatif capable de porter une large proportion de chaque classe d'âge à un niveau très élevé d'employabilité. De ce point de vue, l'objectif de justice sociale des politiques de démocratisation se double d'un objectif d'efficacité économique. Nel Obs hebdo 30/08/07 |
Blâme ou encouragements ?
Diplômes dévalorisés, échec massif : dans un documentaire choc diffusé lundi 3 septembre, Canal+ enfonce le clou du catastrophisme. Ces thèses, l’économiste Eric Maurin les conteste, chiffres et arguments à l’appui.
|
Extraits Il y a ceux qui fulminent, et ceux qui font les comptes. Ceux de l’intérieur – un certain nombre de professeurs des collèges et des lycées – qui tirent à boulets rouges sur le « pédagogisme » post-soixante-huitard, accusé d’avoir ruiné l’école. Et ceux de l’extérieur – des économistes et des statisticiens, notamment – qui n’hésitent pas à prendre la défense du « mammouth ». A la veille de la rentrée des classes, les deux clans dégainent leur porte-voix : avec un documentaire au vitriol, Education nationale : un grand corps malade, lundi soir, sur Canal+ ; auquel s’oppose un essai stimulant, La Nouvelle Question scolaire, de l’économiste Eric Maurin, qui salue les bénéfices de la démocratisation scolaire entamée dans les années 70. « Contrairement à une idée aujourd’hui ressassée, la qualité de l’insertion professionnelle à la sortie de l’école tend à s’améliorer de façon tendancielle depuis les générations des années 60 », écrit Eric Maurin. Eric Maurin entend démontrer les bénéfices du collège unique. Exemple éclairant : selon lui, à l’adolescence, chaque année de collège supplémentaire pour un élève lui promet une augmentation d’au moins 10 % de son futur salaire. Il démonte aussi avec habileté le « mythe de la dévalorisation des diplômes » « On dit souvent qu’avec l’inflation du nombre de diplômes le bac est devenu un simple parchemin sans valeur. C’est une perception tout à fait fausse de la réalité. On fait erreur en voulant comparer les bacheliers d’aujourd’hui à ceux d’hier. Aujourd’hui, ils sont plus de 60 % d’une génération, contre 20 % il y a trente ans. L’analyse révèle que les 40 % auxquels la démocratisation du bac a offert une voie d’accès à l’enseignement supérieur ont aujourd’hui un destin bien plus confortable que celui qui aurait été le leur sans cette démocratisation. » « La France est le seul grand pays du monde développé où les enseignants qui entrent dans la carrière sont choisis pour leur excellence dans leur discipline, non pour leur sens de la pédagogie. Dans le nord de l’Europe, la carrière d’enseignant se construit comme n’importe quelle autre carrière : tout le monde peut postuler au métier et seuls les meilleurs, les plus pédagogues, persistent et progressent dans la profession. La formation des maîtres, en revanche, si critiquée soit-elle, améliore le rendement pédagogique.» « C’est en grande section que l’on constate les plus grandes disparités entre élèves, souvent liées à leurs origines sociales. Les 15 % qui peinent à lire en sixième ne souffrent donc pas de telle ou telle méthode d’apprentissage de la lecture, mais de difficultés antérieures, liées à la pauvreté effroyable dans laquelle grandissent aujourd’hui 15 % des tout-petits en France. » Télérama 30/08/07 |
Le Café pédagogique vous dit tout sur les questions d'éducation
|
Extraits En mai, plus de 600 000 visites ont été enregistrées pour un million de pages vues. Et quelque 160 000 personnes sont aujourd'hui abonnées à l'ensemble des éditions du Café. Sans aucune publicité. "Notre métier nous isole. Nous avons donc fait le pari de l'intelligence collective", explique François Jarraud, le rédacteur en chef. Bien plus qu'une salle des profs virtuelle, l'idée est d'offrir "un lieu de rencontres et d'échanges pour tous les acteurs de l'école, enseignants, parents, enfants, collectivités locales". Tout en défendant une certaine vision de l'éducation. Car le Café pédagogique, ne bénéficiant d'aucune subvention ministérielle, ne dissimule pas ses convictions, loin des discours nostalgiques sur l'institution. "Nous faisons partie de la mouvance des "pédagogos". Pour nous, c'est l'école qui doit s'adapter aux élèves et non l'inverse. Et notre audience prouve que cette vision est partagée sur le terrain". Le Monde 28/08/07 |
| Le HCE critique une école "résignée" devant l'échec scolaire |
Extraits Le rapport du Haut conseil de l'éducation (HCE) consacré à l'école primaire critique les performances insuffisantes de ce maillon de la scolarité, qui englobe l'école maternelle (ou "pré-élémentaire") et l'école élémentaire. Le HCE s'exprime sans langue de bois mais sans agressivité. "Notre école primaire, peut-on lire dès l'introduction, se porte moins bien que l'opinion publique ne l'a cru longtemps. En particulier, elle ne parvient pas, malgré la conscience professionnelle de son corps enseignant, à réduire des difficultés pourtant repérées très tôt chez certains élèves et qui s'aggraveront tout au long de leur parcours scolaire". Chaque année "quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, entrent au CM2 avec de graves lacunes", que "près de 200 000 d'entre eux ont des acquis insuffisants en lecture, écriture et calcul", dont "plus de 100 000" qui "n'ont pas les compétences de base dans ces domaines". L'école semble "s'être résignée à l'échec des élèves qui accumulent les insuffisances" et "se révèle globalement incapable de mettre en place un soutien et un rattrapage efficaces". "Les chances d'accomplir une scolarité sans heurts et conduisant à une qualification réelle sont très fortement liées au niveau initial des compétences au cours préparatoire". "Les élèves qui sont en difficulté dès leur entrée au CP le sont toujours, dans leur quasi-totalité, par la suite".. Citant "deux enquêtes effectuées à plus de vingt ans d'intervalle", le rapport juge le redoublement précoce "inefficace" car les écarts de performance sont "spectaculaires" entre ceux qui redoublent le CP et les "promus de justesse" en CE1. L'organisation de l'école primaire en "cycles" "reste en général un trompe-l'œil, et les familles, dans leur grande majorité, n'ont pas conscience de son existence". Concernant l'école maternelle, le HCE estime qu'"elle ne met pas tous les enfants dans les conditions de réussir l'école élémentaire", alors que depuis 1994 "presque tous les enfants sont scolarisés en petite section dès l'âge de trois ans". Ses méthodes d'apprentissage et d'évaluation "s'alignent très souvent sur celles de l'école primaire", déplore le HCE regrettant aussi "la pression des familles pour que le petite école ressemble à la grande". Le Monde 25/08/07 Education: environ 15% des élèves du primaire en grande difficulté, selon un rapport AFP 23/08/07 École primaire : "insuffisant" pour 40 % des élèves à la sortie Le Figaro 25/08/07 Xavier Darcos promet une école plus réactive et recentrée sur les fondamentaux Le Figaro 25/08/07Un rapport sévère pour l’école primaire Libé 27/008/07 Mauvaise note pour l'enseignement jdd.fr 27/08/07Le rapport : Bilan des résultats de l'Ecole - 2007 - L'école primaire |
L'enseignement primaire sévèrement mis en cause |
Extraits Dans un rapport sur l'enseignement primaire, le Haut Conseil de l'éducation (HCE) critique sévèrement l'insuffisance de ses performances, notamment dans le traitement de l'échec scolaire précoce ce texte "se distingue de beaucoup de rapports par sa concision et son absence totale de langue de bois". La mise en cause officielle des performances du primaire n'est guère fréquente. Il y a toutefois un précédent : le rapport remis en 1998 à Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, par l'inspecteur général Jean Ferrier. Intitulé "Améliorer l'efficacité de l'école primaire", ce rapport estimait à "25 % d'une classe d'âge la proportion des élèves en difficulté ou en grande difficulté à l'entrée du collège" et appelait à un "recentrage" sur les apprentissages. Sur l'école élémentaire, il dénonçait notamment le "flou" des horaires d'enseignement, le défaut de pilotage des réseaux d'aides spécialisées et le caractère "embryonnaire" du travail d'équipe. Il jugeait aussi que la réputation avantageuse de l'école maternelle n'était étayée par "aucun état des lieux rigoureux" et qu'elle manquait d'objectifs précis adaptés à ce niveau de la scolarité. Dans son rapport, le HCE se limite au constat, et ne livre pas de recommandations : "Nous n'en ferons que si le ministre nous renvoie la balle". Le monde 24/08/07 Les mauvais résultats du primaire Libé 24/08/07 Améliorer l'efficacité de l'école primaire Rapport Ferrier |
Les enseignants "Freinet" assurés de la relève, malgré "l'air du temps" politique
|
Extraits Même les syndicats ne peuvent en faire autant : des centaines d'enseignants, réunis pendant plusieurs jours, à leurs frais et pendant les vacances, pour réfléchir ensemble sur leur métier. Le 48e congrès du mouvement Freinet a réuni 650 participants Cette participation, sensiblement supérieure à celle des congrès précédents, a réjoui des pédagogues qui se savent en décalage avec "l'air du temps" politique. Généralement respectée (jusque dans les rangs de ceux qui défendent le primat de la "transmission" sur "l'éducation"), la pédagogie Freinet comporte certes des "techniques" : le "texte libre" (à tout moment, un élève qui le désire peut écrire), et le "quoi de neuf ?" (un rituel quotidien de prise de parole) sont parmi les plus connues. Mais elle forme un ensemble, fondé sur la coopération et l'autonomie maximale de l'élève. Catherine Foucher, qui n'a pas toujours été "Freinet" a sa définition : "Nos élèves savent à tout moment ce qu'ils font et pourquoi ils le font, ils sont capables de faire le lien avec ce qui a précédé et de percevoir à quoi cela servira plus tard." Un des points forts du congrès a été la présentation par Yves Reuter, professeur à Lille-III, d'une étude menée avec son équipe pendant cinq ans sur une école Freinet de Mons-en-Baroeul (Nord) : bilan très positif, avec des élèves pourtant très défavorisés. Le chercheur relève cependant des obstacles au caractère "transférable" de cette pédagogie, reposant sur un investissement personnel hors du commun et qui devrait aussi, selon lui, être comparée "avec des modes de travail traditionnels, à condition qu'ils soient sérieux et respectueux des élèves". Les bonnes notes de l’élève Freinet Libé 24/08/09 |
Le supérieur malade de l'écoleAlain Bentolila professeur de linguistique à Paris-V-Sorbonne |
Extraits Aujourd'hui, mes étudiants de licence de linguistique sont pour un tiers environ incapables de mettre en mots oraux ou écrits leur pensée au plus juste de leurs intentions. Une université plus autonome sera plus exigeante! Mais si ce principe d'exigence n'est pas appliqué dès l'école maternelle, si la complaisance et l'aveuglement sont de règle jusqu'au baccalauréat, l'autonomie accrue des universités engendrera nécessairement une sélection féroce et d'autant plus cruelle qu'elle aura été inconsidérément différée. C'est en effet à l'école maternelle de veiller à une réelle maîtrise du langage (et notamment du vocabulaire) ; c'est à l'école élémentaire de livrer au collège des élèves lisant et écrivant avec pertinence ; c'est au lycée de former des jeunes étudiants capables de mettre en mots leur pensée avec précision. Dans le cas contraire, nous aurons à côté de quelques pôles d'excellence des universités poubelles (comme nous avons des écoles poubelles et des collèges poubelles). Nos étudiants ont été enfants de maternelle, élèves du primaire et du secondaire et que la qualité de la formation intellectuelle et linguistique qu'ils y ont acquise conditionnera la hauteur des ambitions de l'université. Ou bien nous nous battons pour qu'école, collège et lycée construisent un socle ambitieux et dûment vérifié de savoirs et de savoir-faire indispensables à la poursuite d'études supérieures, ou bien nous interdisons à un tiers de nos bacheliers l'entrée dans une université qu'une autonomie bien utilisée aura rendue digne du nom qu'elle porte. Le Monde 27/06/07 |
|
|
Extraits Après trente années de massification continue et de réformes avortées, souvent « illisibles » et épuisant les enseignants, le balancier idéologique se déplace aujourd'hui vers l'appel aux vertus d'une école républicaine traditionnelle d'autant plus parfaite que l'on oublie qu'elle produisait moins de 10 % de bacheliers et que plus de la moitié des élèves la quittaient au terme de la scolarité obligatoire. Si l'assouplissement de la carte scolaire permet aux meilleurs élèves de fuir les établissements « faibles » en permettant aux « bons » établissements de les regrouper, il est évident que les moins bons des élèves, qui sont aussi les moins favorisés socialement, verront leur sort se dégrader. Il n'y a rien de scandaleux à sélectionner les meilleurs et les plus méritants à condition que le sort des plus faibles et des moins favorisés soit une priorité. Autrement, l'égalité des chances, fût-elle républicaine, ne sera qu'une forme de darwinisme scolaire. On veut revaloriser le travail : c'est très bien. Mais encore faut-il que l'école ne contribue pas à le dévaloriser obstinément. Du sommet à la base du système sco- laire, l'orientation se fait principalement par l'échec, par la distance à une excellence qui reste celle des savoirs les plus abstraits et les plus généraux. Au terme du collège, les élèves les plus faibles vont dans l'enseignement professionnel, les autres vont au lycée d'enseignement général, où les moins bons sont orientés dans les filières techniques. Dans tous les cas, il va de soi que les métiers techniques, pratiques et socialement utiles sont dévalorisés, quand ils ne sont pas méprisés. La question du collège est loin d'être réglée. Est-il le premier cycle du lycée d'enseignement général ? Est-il le prolongement de l'école commune obligatoire ? Dans les faits, tout dépend de l'établissement où on se trouve, voire de l'enseignant auquel on a affaire. Là encore, l'ambiguïté est la pire des choses : nous devrons résolument choisir entre le collège unique et l'examen d'entrée en sixième dont le fantôme hante les nostalgies. Et dans ce dernier cas, que faire de ceux qui ont échoué ? Ce n'est pas une rêverie pédagogique que de se demander quel type de sujet et de citoyen l'école veut former ; de quoi ils ont besoin pour entrer dans la société et pour s'y sentir libres. Longtemps, l'école française a été pensée comme un sanctuaire protégé des désordres et des passions de la vie sociale : pas de parents, pas d'élus, pas d'employeurs à l'école. Cette école ne rendait de comptes qu'à elle-même. Bien sûr, l'école ne peut pas être ouverte à tous les vents de la vie sociale, bien sûr, l'autorité des maîtres devrait aller de soi. Mais dans une société moderne et démocratique, la légitimité de l'autorité tient moins à la capacité d'incarner des principes transcendants qu'à celle de participer d'un ordre négocié et reconnu comme juste. Alors, à qui « appartient » l'école ? A l'heure où l'on accuse l'esprit démocratique et libertaire de Mai-68 de tous les maux, l'école française ne fait guère de place aux parents et aux élus, et a farouchement refusé d'accorder quelques droits aux élèves, préférant leurs révoltes récurrentes. Nel Obs hebdo 14/06/07 |
|
L'école à la carte
|
Extraits Xavier Darcos. - Il faut remettre de la souplesse dans le système. Le jeu est pipé, entre les fils de famille - avec en tête, les enfants de journalistes, d'enseignants et de cadres supérieurs - qui détournent la carte scolaire, et les autres, pour qui elle est devenue une assignation à résidence. Philippe Meirieu me caricature en disant que je veux « supprimer le Code de la route parce qu'il y a des chauffards » . M. Duru-Bellat . - Mais avec cette réforme de la carte scolaire, que va-t-on gagner ? Si je comprends bien, on monte une usine à gaz, juste pour satisfaire quelques familles ? La République se doit quand même d'offrir les mêmes conditions d'éducation à tous. En gommant la carte scolaire, vous risquez d'aggraver les phénomènes d'inégalités. Vous allez créer une concurrence entre les établissements pour attirer les meilleurs élèves. Elle va plutôt creuser le fossé entre bons et mauvais établissements ! Il y a un risque ! Celui de voir les élèves les moins défavorisés des collèges défavorisés fuir ces établissements. Il n'y restera plus que les élèves les plus fragiles. Les études montrent bien que les bons élèves entre eux créent une dynamique positive, et que les faibles entre eux créent une spirale négative X. Darcos. - Je privilégie la liberté. Cela dit, relativisons ! Dans l'immense majorité des cas, la sectorisation marche bien. Les problèmes ne se posent vraiment que dans les grandes villes et les banlieues.
M. Duru-Bellat .
- Mais
revenons au coeur du problème : pourquoi les parents ne veulent-ils plus
mettre leurs enfants dans certains établissements ? La carte scolaire s'efface Nel Obs hebdo 14/06/07 La suppression de la carte scolaire favorise-t-elle la réussite de tous ? L'Humanité 16/06/07 Lycée coté ou pas ? La difficulté du choix... Ouest-France 21/06/07Attention : élèves à la carte = ghettos scolaires, Thierry Cadart secrétaire général de la fédération du SGEN-CFDT Le Monde 23/06/07 |
Les Français restent favorables à la carte scolaire mais...54 % des Français sont pour le maintien de la carte scolaire, mais les personnes interrogées par l'Ifop pour notre sondage lui trouvent beaucoup de défauts |
Extraits La majorité des sondés - y compris ceux de droite - jugent en effet qu'il s'agit d'un bon dispositif pour « assurer une mixité sociale dans les établissements ». Une majorité de sondés - y compris ceux de gauche, de justesse - estime que la carte scolaire est un « mauvais dispositif » car elle empêche les parents de choisir ! Cherchez l'erreur. la contradiction n'est pas si étonnante. Quand l'avenir de nos chers petits est en jeu, les cartes idéologiques sont vite biaisées. Dans les grandes agglomérations, on ne compte plus les beaux penseurs de gauche qui contournent la carte pour inscrire leurs enfants dans les collèges cotés. Ni les chauds partisans du privé qui changent d'avis à l'heure de l'inscription en seconde, dans les grands lycées publics. Les Français savent bien que la carte actuelle a partiellement échoué à construire cette école de la mixité, dont ils continuent pourtant de rêver, mais à condition que leurs fils et leurs filles soient dans la meilleure ! Pour attendre ce dernier objectif, les cadres sont confiants. Eux sont les plus favorables à la liberté de choix des établissements. Les ouvriers, à l'inverse, se montrent les plus réticents. Sans doute pensent-ils que leurs enfants ne seront pas gagnants si les établissements les plus demandés doivent refuser du monde (comme le craignent 70 % des sondés). On y verra plus clair à la rentrée 2007, quand le ministre testera les premiers « assouplissements ». Les établissements pourraient alors accepter 10 à 20 % d'enfants hors carte scolaire. Au profit d'élèves de banlieue ? A voir. Et même si c'est le cas, va-t-on pousser les murs pour les accueillir, ou refuser des élèves du « bon » quartier dont, immanquablement, les parents seront furieux ? Ouest-France 27/05/07 Trois Français sur quatre favorables à la suppression de la carte scolaire, selon un autre sondage (CSA) AP 29/05/07 |
|
La suppression de la carte scolaire, un projet pas si simple |
Extraits "Actuellement, la carte scolaire - principe selon lequel un enfant est inscrit dans un établissement en fonction de son lieu d'habitation - ne concerne que les familles des milieux populaires, ceux qui y dérogent le plus sont les personnels de l'Education nationale et les journalistes!", explique Bernard Toulemonde "Plusieurs ministres ont voulu ensuite s'attaquer à la carte scolaire", relate M. Toulemonde, mais ils ont vite abandonné l'idée de la réformer en profondeur, pour des raisons financières et toujours d'actualité. Par exemple, choisir son collège implique des réaménagements et des financements: "un collège qui sera très demandé à cause de la désectorisation devra faire des travaux ou assurer les transports scolaires", la sectorisation ne relève plus de l'Etat mais des conseils généraux pour les collèges depuis la loi de décentralisation de 2004. Donc si un département refuse de désectoriser, les autorités ne pourront pas l'y contraindre. Pour Faride Hamana, président de la puissante fédération de parents d'élèves (la FCPE revendique 325.000 adhérents) la suppression de la carte scolaire entraînera "la possibilité d'être librement choisi par le chef d'établissement" et sera "la voie ouverte (au) règne de l'arbitraire". AFP 26/05/07 Darcos tente de rassurer les parents de la FCPE sur la carte scolaire AFP 26/05/07 La carte scolaire corrigée par Darcos avant l'été Libé 28/05/07 La carte scolaire aura disparu en 2010 Nel Obs 29/05/07 Xavier Darcos invoque la mixité sociale pour justifier la suppression de la carte scolaire Le Monde 29/05/07 Carte scolaire: Xavier Darcos prévoit une expérimentation à la rentrée La Tribune 29/05/07 « Supprimer la carte scolaire n'améliorera pas la mixité » Les Echos 30/05/07 |
Des lycéens dispensés d'"interro surprise" |
Extraits Imaginez des questions d'évaluations dont le contenu serait connu par avance des élèves : il ne s'agit pas du rêve éveillé d'un écolier en difficulté mais d'une expérience menée au lycée Jacques-Prévert, à Pont-Audemer (Eure), par une dizaine d'enseignants. La méthode : quelques jours avant l'évaluation, les professeurs donnent une liste de questions déjà traitées et corrigées en classe (exercices, définitions, études de textes...). Les élèves bénéficient d'une séance de questions-réponses pour éclaircir les points qui ne seraient pas compris. Ils savent que pour la plus grande partie de la note (des deux tiers aux trois quarts), les questions seront piochées dans cette liste. Le tiers ou le quart restant sera issu de questions non connues. "L'arrivée en seconde est un passage difficile pour les élèves, qui voient leurs notes baisser, explique le proviseur, Bernard Le Dilavrec, qui encourage cette expérience. Tout ce qui peut les mettre en confiance me semble utile. Avec cette méthode, les lycéens savent que, s'ils travaillent sérieusement, ils auront la moyenne." André Antibi est à l'origine de ce système, qu'il appelle l'évaluation par contrat de confiance. Selon lui, quelques milliers d'enseignants auraient déjà adopté ce système censé corriger "l'échec artificiel" dont seraient victimes une partie des élèves. "Sous la pression de la société, les professeurs se sentent obligés de mettre un certain nombre de mauvaises notes, même dans les classes de bon niveau, pour être crédibles", assure-t-il. Un phénomène qu'il qualifie de "constante macabre", du nom d'un de ses livres paru en 2003 (Math'adore). Le Monde 23/05/07 Audition d'André Antibi par la commission des affaires culturelles du Sénat Téléchargeable format *.pdf "Faire évoluer les pratiques d’évaluation des élèves", entretien avec Philippe Joutard le 22 mai 2005 Observatoire des inégalités Le système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) Téléchargeable format *.pdf |
Le gouvernement prépare la suppression de la carte scolaireUne expérimentation sera lancée dès septembre 2007, avant la mise en place d'un nouveau système en 2008. |
Extraits L'assouplissement de la carte scolaire, qui doit aboutir à terme à sa «suppression», entrera en vigueur dès la prochaine rentrée, a annoncé hier Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale. Cet assouplissement pourrait d'abord concerner de 10 à 20 % des affectations en septembre prochain. « Dès 2008, un nouveau système sera mis en place. » Un système qui implique « d'assouplir la carte scolaire dont les familles sont prisonnières quand elles n'ont pas les moyens de la contourner » Il est difficile de savoir précisément quel est le pourcentage d'élèves qui dérogent réellement aujourd'hui à la carte scolaire pour « fuir » un établissement de mauvaise réputation. À Paris, selon une étude datant de 2005, un millier de dérogations, chaque année, soit 8 % du total, « s'apparentent à de l'évitement ». Sortie des milieux urbains, la carte scolaire n'est peu ou pas contournée, car les collèges sont souvent situés à plusieurs kilomètres les uns des autres. À l'école, les familles recherchent avant tout la proximité, tandis qu'au lycée, la diversité de l'offre de formations et d'options assouplit d'elle-même la carte scolaire. C'est donc surtout au collège, où les choix d'orientation sont stratégiques, que de nombreuses familles tentent de contourner la carte. Le but de la sectorisation, créée en 1963, était de réguler les flux d'élèves à un moment où la population du pays augmentait et où les établissements scolaires poussaient comme des champignons. C'était avant tout une question de planification. La question de la mixité sociale s'est progressivement ajoutée, avec l'émergence du collège unique. La carte scolaire a encouragé des situations de ségrégation : dans les quartiers défavorisés les élèves en difficulté et, en centre-ville, la population scolaire favorisée. Professeurs, journalistes et cadres supérieurs sont les professions les plus friandes du contournement de la carte... Le Figaro 22/05/07 Carte scolaire: Xavier Darcos espère un nouveau système dès la rentrée 2008 AP 21/05/07 Xavier Darcos propose de hâter la suppression de la carte scolaire Le Monde 22/05/07 Xavier Darcos rebat les cartes scolaires Libé 23/05/07 Darcos déchire la carte scolaire L'Humanité 23/05/07 En complément : Discours - Xavier Darcos 19/05/2007 (Clôture du 88ème congrès de la PEEP) Voir aussi "Politique urbaine, mixité sociale, carte scolaire" Table ronde Lyon |
"De l'ambition pour l'école !"réclame un collectif de spécialistes |
Extraits Un appel intitulé "De l'ambition pour l'école !" demandant que "dans la nouvelle période qui s'ouvre" avec l'élection de Nicolas Sarkozy, la politique de l'école ne se traduise pas par des "régressions", a été lancé lundi. "Aujourd'hui, une remise en cause du collège unique, un abandon des pédagogies capables de prendre en compte l'hétérogénéité des élèves, un retour à un enseignement sélectif constitueraient autant de régressions qui demanderaient de longues années pour être jugulées", constate le Crap-Cahiers pédagogiques. Le texte a été signé par Philippe Meirieu, Antoine Prost, Hervé Hamon, Stéphane Beaud ou Philippe Joutard… "L'école française a progressé à chaque fois qu'elle a su innover, se montrer hardie et capable de mobiliser les énergies comme au temps de Jules Ferry, puis au lendemain de la Libération, ou encore lors du mouvement de démocratisation des élèves". Il demande ainsi que le "socle commun de connaissances et de compétences que tout le monde doit avoir acquis en fin de scolarité obligatoire", ne se "réduise pas à des apprentissages mécaniques". Entre les deux tours de la présidentielle, un autre collectif, réunissant entre autres le fondateur de Sauvez les Lettres, Marc Le Bris, ou Jean-Pierre Chevènement, avait lancé un "appel pour la refondation de l'Ecole", défendant au contraire un retour au lire, écrire, compter, et la remise en place d'un examen d'entrée en 6e.AFP 15/05/07 |
La note de vie scolaire reste contestée dans les collèges |
Extraits La nouvelle "note de vie scolaire" attribuée à chaque élève depuis la rentrée 2006 est élevée, voire très élevée. "Dans une immense majorité des situations, cette note se situe au-delà de 15 sur 20, précise un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale de février. Dans plusieurs départements, 85 % des élèves ont 17 ou plus." Cette notation - attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal - prend en compte l'assiduité des élèves et leur respect du règlement intérieur (pour 10 points chacun). Des points supplémentaires peuvent être attribués pour récompenser l'engagement des élèves. Or nombreux sont ceux qui doutent que ces notes, qui contribuent à relever la moyenne trimestrielle, aient un effet positif sur le comportement des élèves. Sur le terrain, les chefs d'établissement sont dubitatifs. Les parents, eux, oscillent entre satisfaction et scepticisme. L'inspection générale préconise d'évaluer l'impact de la note de vie scolaire sur la réduction de l'absentéisme et des incivilités, et de l'arrimer à l'acquisition des compétences sociales et civiques ainsi que de l'autonomie et de l'initiative. Des compétences inscrites dans le socle commun que doit maîtriser tout élève à l'issue de sa scolarité obligatoire. Le monde 15/05/07 |
|
« Il faut s’interroger sur ce que l’on attend de l’école » L’association des étudiants (afev) demande l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur les raisons de l’échec scolaire. |
Extraits Début 2007, l’AFEV, une association d’étudiants d’aide aux enfants en difficulté scolaire, lançait un appel à destination des députés et sénateurs. « Pas de quartier pour les inégalités » Il faut en finir avec l’idée selon laquelle il existerait une recette miracle susceptible de résoudre le problème de l’échec scolaire. Nous sommes les champions du monde de la réforme du système éducatif. Or cela ne change rien. Il faut arrêter de repenser sans arrêt les tuyaux et s’interroger enfin sur le pourquoi de l’école et sur ce que l’on en attend. La dernière fois (en automne 2004 - NDLR), on a appelé cela « un grand débat sur l’école », et non « un débat sur l’éducation ». On oublie que l’école ne peut pas tout faire toute seule. On ne peut pas parler d’éducation et maintenir une cloison entre la famille, la commune et l’école. Généralement, dès que l’on parle accompagnement scolaire, on entend « répétition scolaire, aide aux devoirs ». Or, le problème des enfants auxquels nous nous adressons n’est pas d’avoir compris une leçon. Il est de ne pas avoir compris le sens de l’apprentissage, ni ce que l’école attend d’eux. http://www.afev.org |
|
Q.I. : la grande illusion |
Extraits "Affolante, cette course effrénée aux tests de quotient intellectuel ! Cela fait un moment que nombre de psychologues sont alarmés et appellent à un sursaut. Mais il est difficile de lutter contre l'air du temps. Pourtant quelle escroquerie ! Quelle horrible idéologie sous-jacente et, surtout, quel préjudice pour certains enfants !" Docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages et psychologue réputée, Claire Meljac signe sans réserve un texte-pétition intitulé "Des psychologues s'interrogent sur le Q.I. et certains de ses usages" Un trouble et une inquiétude qui soulèvent moult questions sur l'école, la performance et le surinvestissement de la famille, et de la société, dans l'enfant. Des parents se précipitent chez le psychologue afin de faire tester l'intelligence de leur enfant, généralement en échec scolaire, convaincus - et c'est la nouveauté - qu'il s'agit en fait d'un enfant surdoué, que son "surdon" explique l'ennui profond qu'il éprouve à l'école ou peut-être son insubordination, et qu'un certificat doté d'un chiffre élevé en guise de Q.I. - "la preuve qu'il appartient à une race supérieure", ironise Claire Meljac - permettra de mieux le comprendre, l'apprécier à sa juste valeur et l'orienter. Christine Arbisio, psychologue et psychanalyste, se méfie également de ce mouvement qui "valorise l'intelligence comme étant héréditaire et minimise l'influence du milieu culturel, qui est pourtant fondamentale". Mais, ce qui la frappe, ce sont les exigences croissantes de performances qui pèsent sur les enfants. Sélection dès la maternelle, pressions à la réussite... "On parle de l'enfant-roi ? Moi, je vois surtout des enfants surstimulés, priés de gratifier narcissiquement leurs parents. La quête du Q.I. n'est qu'un symptôme de cette société dingue de performances." Supprimons-le ! suggère le professeur émérite Jacques Lautrey, du laboratoire cognition et développement à l'université René-Descartes. "Il est trop souvent source de dérives, de malentendus, de rivalités, voire de dégâts dans une école ou une fratrie." Et surtout, dit-il, "il entretient une conception de l'intelligence totalement dépassée sur le plan scientifique. Fini, l'usage d'un chiffre unique pour traduire une intelligence que l'on sait désormais multidimensionnelle ! Et finis les tests survalorisant les aptitudes nécessaires à la réussite d'un cursus scolaire. Tant d'autres qualités, la créativité, l'intelligence sociale, méritent reconnaissance. Osons le vrai débat !" Le Monde 02/05/07 |
|
Un débat sur la langue française Kel ortograf pr 2m1 ?
La tchatche et le SMS menacent-ils l'identité linguistique française ? Pour en débattre, Aude Lancelin a réuni Alain Bentolila, qui lutte contre l'illettrisme, et Vincent Cespedes, qui croit à la révolution de l'orthographe
|
Extraits Entre nostalgiques d'un paradis scolaire perdu et adversaires échevelés des méthodes de grand-papa, les barricades ne sont jamais tombées. Réformes controversées de l'orthographe, ravages supposés de la méthode globale, progression de l'illettrisme, autant de sujets passionnels dans un pays où une suppression de l'accent circonflexe risquerait pour certains de menacer jusqu'à « l'identité nationale ». Prof de philo durant cinq ans en banlieue, Vincent Cespedes relance le débat dans « Mot pour mot ». Il débat aujourd'hui avec le linguiste Alain Bentolila, auteur du « Verbe contre la barbarie » et inspirateur des réformes du ministre Gilles de Robien sur l'apprentissage de la grammaire et les « leçons de mots ». Alain Bentolila Quand on est en infériorité linguistique, on est nécessairement à la merci des nantis du langage, de ceux qui ont une parole plus forte. Vincent Cespedes . - Ce qui me gêne, c'est votre présupposé : croire qu'on va rectifier une déficience issue d'une condition sociale ghettoïsée par une politique linguistique. Vous inversez totalement les choses. C'est parce qu'on est relégué qu'on n'accède pas à une langue normée et bourgeoise, et même qu'on la rejette. Ce n'est donc pas par une politique de la langue qu'on abolira des différences sociales bien réelles. A. B. - Je n'ai jamais écrit qu'il suffisait de bien parler pour bien penser. La capacité à respecter l'intégrité physique de l'autre a partie liée avec celle de l'accueillir au seuil de son intelligence grâce à la langue. Je pense que l'école est là pour rompre la connivence et instaurer de la distance. J'irai même jusqu'à dire que la langue est avant tout faite pour parler à « ceux que l'on n'aime pas ».
V. C.
- Paul Valéry voyait dans les bizarreries de l'orthographe un moyen de
sélection sociale. Les déformations graphiques et la souplesse
grammaticale ne corrompent en rien les exercices les plus hauts de
l'intelligence. Il y a deux moments historiques où la faute
d'orthographe explose. Le premier, c'est à la fin du A. B. - Je ne m'arc-boute nullement sur les incongruités imbéciles de l'orthographe française. Seulement, il faut faire très attention à ne pas supprimer les marques qui participent de la logique même de la langue.
V. C.
- Je ne peux m'empêcher de voir dans vos mesures une sorte de rappel à
l'ordre, même si c'est d'ordre grammatical qu'il s'agit. Un de vos
postulats est de dire que ces jeunes sont barricadés dans une langue
bâtarde où une dizaine de mots à tout dire ont remplacé un lexique
dévasté. Mais vous inversez le problème. S'ils ne disent pas « succulent
» ou « exquis », s'ils disent «grave bon», c'est parce qu'ils ne veulent
pas dire ce genre de mots. Ce sont des cancres militants : ils rejettent
un système qui les rejette. V. C. - Cela ne passera pas par le retour à un conditionnement culturel devenu obsolète. Or c'est ça qu'on se borne à nous proposer désormais. Une sorte de contre-révolution par rapport à l'esprit pédagogique des années 1970. Nel Obs 05/04/07 |
|
« Prof : pas une vocation, un métier »
|
Extraits Il existe un syndrome du « Cercle des poètes disparus » : le « bon prof » serait celui qui monte sur la table, qui a du charisme, qui est comédien, qui captive son auditoire et, au final, séduit ses élèves. Je récuse cette vision. C'est la figure d'un prof qui dépossède l'élève, en créant un courant de fascination. Or la mission de l'enseignant est au contraire la construction de l'élève, sa formation au jugement et à la citoyenneté. Au départ ce qui les passionne, ce ne sont pas les élèves, mais leur discipline. D'où leur résistance à la bivalence, le fait d'enseigner deux disciplines : l'amour, ça ne se partage pas. Cette culture disciplinaire nuit au travail collectif. L'autre problème est celui de la qualification à vie attachée aux concours de recrutement. Aujourd'hui le métier est plus complexe, plus ambitieux, et requiert une formation permanente. Le collège est ouvert à tous, avec l'ambition de tirer l'ensemble des élèves vers des études relativement longues. Et ça a marché : entre 1985 et 1995, nous avons doublé le nombre de nos bacheliers. Au prix de classes plus hétérogènes. Le chahut folklorique a été remplacé par des difficultés nouvelles. Enseigner n'est pas une vocation, c'est un métier. Un « bon prof » est d'abord un professionnel. Or les IUFM ne sont pas encore des écoles professionnelles centrées sur le métier. L'institution est suradministrée et sous-encadrée. Ce qui manque, c'est une réelle formation pédagogique initiale et un véritable encadrement en cours de carrière. Le principe de l'inspection individuelle des profs est archaïque. C'est un rituel infantilisant. Les enseignants sont insécurisés par le dispositif censé les sécuriser. Seule une culture professionnelle partagée pourrait les sortir de là. Les expériences étrangères montrent que mieux ils sont évalués, plus ils vont bien dans l'exercice de leur métier. A l'étranger on évalue le travail collectif, l'établissement et non les individus, le partage des expériences et des savoirs, la prise en charge collective des difficultés. Nel Obs hebdo 05/04/07 |
|
Malaise dans l'école de la République |
Extraits Pas contents, les enseignants. Ils accusent Nicolas Sarkozy de vouloir cisailler leurs effectifs, reprochent à Ségolène Royal de flinguer la carte scolaire et font grève contre le décret Robien qui augmente leur temps de travail tout en les incitant à enseigner deux disciplines... A les entendre, il n'y aurait guère que l'agrégé de lettres classiques François Bayrou - crédité par l'Ifop de 27% d'intentions de vote parmi les profs - pour les comprendre ! Qu'est-ce au juste qu'un bon prof ? «Il faut absolument avoir un bon niveau dans la matière qu'on enseigne» : Bruno Descroix, professeur de maths, confirme l'évidence. En France, les savoirs restent la clé de voûte du métier. «Les enseignants français titulaires sont exclusivement sélectionnés sur des critères de connaissances», résume Georges Felouzis, sociologue de l'éducation. «Nous avons des professeurs qui parlent mieux l'espagnol que leurs homologues d'autres pays, mais qui ont globalement de moins bons résultats», constate Lauro Capdevilla, inspecteur pédagogique régional dans l'académie de Rennes. Et la recherche le confirme : «Ce qui fait la différence entre un professeur et un autre, ce n'est pas tant le grade qu'il a obtenu que ses pratiques, son expérience, la façon dont il sait prendre la classe», confirme Marie Duru-Bellat, sociologue de l'éducation. En un mot, sa pédagogie. Un métier qui s'apprend. Le bon pédagogue sait adapter ses pratiques à son public. «Il sait qu'avec les élèves aisés on est plus efficace en étant un peu raide. Alors qu'avec les élèves de milieux populaires il faut être chaleureux pour leur donner confiance», rappelle Marie Duru-Bellat. Mais combien sont-ils, ces champions de la transmission ? «15 à 20% sont excellents, 15 à 20% sont moyens», estime un expert du système éducatif. Jusqu'à présent, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) se préoccupaient assez peu de pédagogie. «On considère encore qu'il suffit que le candidat veuille devenir professeur pour qu'il sache se débrouiller dans sa classe», explique Jean-Louis Auduc, le directeur adjoint de l'IUFM de Créteil. Donc pas d'évaluation préalable de l'aptitude naturelle des candidats à bien communiquer avec un jeune public. «Ce professeur de maths connaît le théorème de Pythagore. On lui a appris à l'expliquer à des élèves. Mais si un gamin lui dit «Nique ta mère» pendant le cours, il ne sait pas comment réagir», résume le pédagogue Philippe Meirieu. «L'école doit faire réussir tous les élèves» : en 2004, le débat national sur l'éducation avait accouché d'un nouvel impératif catégorique. [Le] bon prof «pose comme postulat que tous les élèves sont éducables», rappelle le pédagogue Philippe Meirieu. Il inculque autant des savoirs que des méthodes de travail, pour permettre aux élèves plus fragiles de devenir autonomes. «Certains professeurs, purs produits d'un système élitiste, ont du mal à renier leurs origines», constate Bernard Toulemonde, inspecteur général honoraire de l'Education. Alors on les entend dire, d'un ton définitif : «Cet élève n'a pas sa place dans ma classe»; ou «celui-là a décroché, je ne peux plus rien pour lui». Ce professeur-là note, classe et étiquette. Comme le théorise le mathématicien André Antibi avec la «constante macabre», il a pris l'habitude inconsciente de répartir systématiquement les copies en trois groupes, quel que soit le niveau de la classe : les bonnes, les moyennes et les mauvaises. Quitte à dégoûter des élèves qui dans d'autres contextes s'en sortiraient mieux. Pas de différence notable dans l'évolution de carrière entre le militant surinvesti qui accompagne des voyages, anime le ciné-club, siège au conseil d'administration et ne compte pas ses heures, et le «pointeur» qui assure le minimum syndical. «La prise en considération du mérite est insuffisante», résume Claude Thélot. «L'agrégé assure 15 heures de cours par semaine, et le certifié, 18 heures. Mais il faut y ajouter les préparations de cours et les corrections de copies.» Soit entre 39 heures hebdomadaires de travail, selon le ministère, et 45 heures, selon le Snes. Ces moyennes ne prennent pas en compte, naturellement, les bienheureuses 14 semaines de vacances. «En moyenne, les professeurs ne travaillent pas assez avec leurs élèves. Même si nous en connaissons qui travaillent beaucoup! La preuve? Certains ont le temps d'avoir des activités secondaires rémunérées : l'un fait du soutien scolaire dans une officine privée, l'autre écrit des livres scolaires, celui-là est répétiteur dans un établissement d'enseignement supérieur, celui-ci fait de la formation continue..., rappelle Claude Thélot. C'est un gâchis collectif. L'organisation du métier, trop peu orienté vers l'accompagnement des élèves, ne permet pas de rendre le meilleur service à la nation.» Nel Obs hebdo 05/04/07 |
|
Défendre le service public de l’Education Nicole Belloubet ancienne rectrice d'académie, professeur des universités
|
Extraits A quelques jours de l'élection présidentielle, il s'agit de savoir quelles orientations vont choisir ceux qui ont à cœur de défendre le service public de l'éducation, au premier rang desquels se situent les enseignants. Après avoir réussi la démocratisation de l'accès à l'école, il est aujourd'hui impératif de relever les défis de la réussite scolaire pour tous. Ils s'organisent autour de 5 enjeux majeurs. Affirmer les valeurs laïques face aux communautarismes et aux violences susceptibles d'en découler. Donner une qualification à tous ceux qui sortent de l'école. Ceci suppose une double volonté : contre le décrochage des jeunes, offrir aux niveaux de qualification les plus bas mais aussi au sein de l'université où plus de la moitié des inscrits abandonne dans les deux premières années, des réponses qualitatives (en termes de pédagogie et d'orientation) et quantitatives (par les moyens adaptés). Il faut aussi lutter contre la ségrégation sociale qui renvoie toujours les mêmes avec les mêmes, dans les mêmes filières, souvent dévalorisées. Prendre en charge la diversité des élèves. Avec l'accueil de tous les enfants la diversité est entrée à l'école. L'institution doit faire confiance [aux initiatives des enseignants] pour encourager la diversification pédagogique indispensable au traitement singulier du à chaque élève. Nul besoin ici d'injonctions de l'administration centrale, mieux vaut s'appuyer sur l'expérimentation et l'échange entre pairs ! Accompagner les évolutions du métier d'enseignant en reconnaissant l'étendue de leurs missions et de leur engagement auprès des élèves.
Garantir l'égalité entre élèves en veillant à assurer la
gratuité de fait des études (soutien scolaire gratuit, dotation d'achat
d'équipement, allocation d'autonomie pour les jeunes ...) et en |
|
L’école à la croisée des chemins Deux conceptions fondamentalement différentes s’affrontent lors de cette campagne électorale : un enseignement fondé sur la sélection ou l’école de la réussite pour tous
|
Extraits Près de 150 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. La faute au système ? Ou la faute aux élèves ? En 2003, la droite tranche. Ramenant l’échec à un problème individuel, elle déclare que tous les jeunes n’ont pas vocation à être scolarisés jusqu’à seize ans et que la réussite de certains passe par des voies dérogatoires. La loi sur l’égalité des chances met en place le retour à l’apprentissage dès quatorze ans et au travail dès quinze ans. Cet « apprentissage junior » programme la sortie du système de 30 000 jeunes de moins de seize ans chaque année. C’est l’éclatement du collège unique et le rabaissement de la scolarité obligatoire. On peut y lire la volonté de mettre l’école au service d’un tri social économique. Ainsi, le Centre d’analyse stratégique espère-t-il, pour 2015, une hausse des emplois à faible qualification, comme les emplois d’aide à domicile (+ 28 %) ou de manutention (+ 22 %). Ce même Centre plaide contre « l’inflation scolaire » et programme, toujours pour 2015, près de 120 000 sorties du système scolaire sans diplôme. Le socle commun de connaissances et de compétences vise à assurer une culture de base à ceux qui en sortiront après la 5e. Dans ce cadre, Gilles de Robien a consacré l’année à réformer l’instruction de la lecture, de la grammaire ou encore du calcul à l’école primaire, privilégiant la mécanisation des apprentissages. Les futurs programmes scolaires du collège, présentés hier devant le Conseil supérieur de l’éducation, distinguent formellement les « fondamentaux », destinés à tous, des connaissances réservées aux futurs lycéens. La réussite n’est plus actée comme droit, mais comme un privilège, dont les plus pauvres doivent prouver qu’ils sont dignes. L'Humanité 03/04/07 |
|
«Il existe plusieurs façons de réformer la carte scolaire» Inégalitaire, le système français de sectorisation exige une adaptation. Nathalie Mons maître de conférences à l'université de Grenoble II |
Extraits Historiquement, la carte scolaire est l'organisation dominante dans les pays de l'OCDE. Dans les années 50-60, les pays développés ont fait ce choix, principalement pour planifier l'explosion de l'offre scolaire. Iil n'y a pas qu'une seule façon d'envisager la levée de la carte scolaire. On ne peut pas opposer d'un côté la carte scolaire et de l'autre la désectorisation totale, la rigidité bureaucratique ou la jungle scolaire. Un premier groupe de pays, principalement asiatiques, est resté fidèle à une sectorisation stricte. Dans une seconde famille se classent les pays qui, tout en gardant le principe de la sectorisation, multiplient les exceptions à la marge pour alléger la rigidité du système. Une troisième famille, donc, s'est orientée vers ce que j'ai appelé «le libre choix total» : les parents choisissent l'école en toute liberté, et les établissements choisissent leurs élèves. Il ne concerne qu'un quart des pays de l'OCDE. De plus, ceux-ci ont pour la plupart fait machine arrière depuis les années 2000, car ces systèmes finissent par conduire davantage à un libre choix accordé aux établissements qu'à de nouvelles libertés pour les parents. Certains pays le quatrième groupe , les Scandinaves en particulier, ont adopté un modèle davantage administré que j'ai appelé «le libre choix régulé». Les parents se prononcent sur l'école de leur choix, mais les affectations sont décidées par les autorités locales et tiennent aussi compte de considérations d'ordre général (mixité sociale, ethnique...). Le modèle français de la carte scolaire à dérogations est associé à un niveau d'inégalités sociales aussi fort que le système du libre choix total. Cela s'explique parce qu'il autorise un choix par les parents les plus éclairés et que la ségrégation résidentielle recouvre la ségrégation scolaire. C'est le modèle de libre choix régulé qui est associé aux inégalités sociales les plus faibles. Ce résultat s'explique par le fait que l'ensemble des parents doit se prononcer sur le choix de l'établissement et que des considérations d'ordre général interviennent dans l'affectation des élèves. Libé 03/04/07 |
L'école, notre cause communeJean-Pierre Boisivon, Christian Forestier, Jean-Claude Luc, Jacky Richard, Georges Septours, Bernard Toulemonde ont été directeurs au ministère de l'éducation nationale. Avec une vingtaine de personnalités ayant la même expérience, ils ont créé le club Par l'école.
|
Extraits La décennie 1985-1995 a montré la capacité d'adaptation, trop souvent contestée, de notre système éducatif : le taux d'accès par génération au baccalauréat a doublé et s'est stabilisé autour de 60 %, entraînant un doublement des effectifs de l'enseignement supérieur et plaçant la France, avec 2 millions d'étudiants, au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Depuis dix ans, cette élévation générale du niveau de qualification s'essouffle, pire, le système se dérègle. Le taux d'accès au baccalauréat dissimule une forte baisse du taux d'accès au baccalauréat général, surtout dans les milieux les plus modestes où elle est compensée par un accès plus large au baccalauréat technologique ou professionnel. Aujourd'hui, sur 750 000 jeunes quittant chaque année le système éducatif, près de 160 000 partent sans diplôme et un peu plus de 160 000 ont obtenu un diplôme de niveau égal ou supérieur à la licence, résultat inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Depuis des décennies, la nécessité d'augmenter les moyens apparaît comme une panacée : ainsi, par exemple, le coût d'un élève du premier et du second degré a pratiquement doublé en euros constants entre 1975 et 2004, et la nation consacre aujourd'hui 6,7 % du PIB à son système éducatif. L'efficacité de certains choix coûteux n'est étayée par aucune démonstration probante. C'est le cas du recours excessif au redoublement des élèves ; de la scolarisation à 2 ans et de ses 7 000 postes ; de la gamme trop étendue des enseignements optionnels qui font de notre lycée le plus coûteux du monde ; ou de la carte trop confortable des formations post-bac... Une autre illusion doit être combattue : celle qui consiste à croire qu’un ministre ou un parti très éclairés pourraient trouver enfin la bonne formule de "LA réforme de l'éducation nationale". La véritable réforme ne consisterait-elle pas à inverser la méthode, c'est-à-dire à permettre au système de s'ajuster en fonction des situations et, pour cela, à assouplir les règles ? Acceptons de ne pas définir à l'échelon national, de façon pointilleuse, l'organisation des apprentissages de tous les élèves de sixième, mais de définir des objectifs collectifs et des démarches d'évaluation et de régulation ! Aidons les enseignants à faire bon usage de marges de liberté accrues ! Privilégions l'initiative, la responsabilité et le travail en équipe. La nécessaire acquisition par tous, en application de la loi de 2005, d'un socle commun de connaissances et de compétences constitue, à ce titre, une vraie opportunité. Elle constitue à la fois un objectif et un moyen de transformation progressive de l'école. Il faut revaloriser l'enseignement professionnel et technologique secondaire s'il correspond à des emplois réels, non s'il s'agit d'en faire une variable d'ajustement. Il faut accorder une priorité budgétaire forte à nos universités et faire évoluer leur gouvernance pour permettre une autonomie accrue et une régulation efficace par l'Etat. Le Monde 31/03/07 |
|
Même s'il est l'inverse de ce qui peut s'enseigner, il est indispensable pour que l'Homme se confronte à lui-même. Pourquoi l'art doit entrer à l'école Alain FRANCON, Michel VITTOZ |
Extraits L'art n'est jamais entré dans les écoles. Il y a de bonnes raisons à cela : l'art est l'envers exact de tout ce qui peut s'enseigner. L'art a comme fonction de décomposer tous les savoirs de la société afin qu'ils puissent se renouveler. Il est création du nouveau sur les ruines de l'ancien il a besoin de l'ancien, mais pour s'en nourrir, et donc sans cesse il le mastique et le détruit. Le mettre à l'école l'outil de transmission des savoirs de la société, dont il assure la pérennité , c'est tuer l'art ou tuer l'école. Une des choses les plus utiles [que les enfants] apprennent au fil des ans est l'écart qu'il peut y avoir entre la façon dont ils imaginent le monde et la façon dont la société a besoin qu'ils l'imaginent. Une société composée d'enfants qui continueraient à imaginer qu'ils sont le centre du monde et qu'il suffit de crier assez fort pour qu'un géant maternel se penche sur eux et leur donne à manger ne tarderait pas à voir tous ses enfants mourir de faim. Autrefois, les hommes avaient compris que les dieux exigeaient des sacrifices pour apaiser leur courroux. Mais, aujourd'hui, que savons-nous de ce qu'exige l'homme ? Les sacrifices humains ne l'apaisent pas : nous ne cessons de lui en offrir, il les ignore ou les oublie. Lui faut-il des connaissances nouvelles sur le monde et sur lui-même ? De nouvelles philosophies, de nouvelles religions ? Du progrès, encore plus de progrès ? De la culture, encore plus de culture ? Rien de tout cela ne l'a jamais calmé. peut-être faut-il malgré tout introduire l'art dans les écoles, organiser la rencontre du savoir et de ce qui le met le plus radicalement en question, peut-être que cela n'a jamais été plus urgent pour que l'homme «apprenne» à entrer en contact avec son propre pouvoir de destruction. Libé 29/03/07 |
|
L'école laisse trop d'élèves sur le bord de la route
|
Extraits En 1959, 10 % d'une génération décrochait le bac. Aujourd'hui, c'est 60 % (dont la moitié de bacs pros et technos). Un succès. Le problème, c'est que le système scolaire se casse le nez sur ce « plafond » depuis 15 ans ! Surtout quand on regarde les étages du dessous. 20 % d'une génération quitte l'école sans diplôme. L'écart entre les jeunes des Zones d'éducation prioritaire et ceux des quartiers cossus s'amplifie. On parle désormais « d'apartheid scolaire ». Les meilleurs élèves filent directement vers des études longues. Les moins bons sont dirigés vers l'apprentissage et les lycées professionnels. Bonjour la revalorisation des métiers manuels ! On a créé, en 1987, un bac professionnel que les élèves baptisent parfois bac ouvrier. Échec quasi garanti s'ils osent aller en fac, voire en IUT. Au collège, au lycée, quand on parle orientation, on pense études, rarement métiers. Les professeurs ignorent tout des professions. Les meilleurs bacheliers se ruent vers les filières sélectives : prépas, IUT, BTS... Les autres prennent d'assaut les filières universitaires aux débouchés incertains. Ouest-France 27/03/07 Schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelleLes politiques de l’orientation scolaire et professionnelle INRP |
Les parents d'élèves critiquent toujours la note de vie scolaire |
Extraits Haro sur la note de vie scolaire ! En vigueur depuis septembre dans les collèges, cette note doit mesurer l'assiduité d'un élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Mais également prendre en compte sa participation à la vie de l'établissement. Selon un rapport de l'Inspection générale, les notes dépassent 15 sur 20 dans 80 % des cas. Selon Faride Hamana, président de la fédération des parents d'élèves FCPE, « nous sommes plutôt favorables à l'idée d'une citoyenneté dans les collèges. Mais cette note est vécue par certains parents comme totalement arbitraire ». La FCPE a décidé de dresser un petit bêtisier sur l'éclectisme de cette note ramasse-tout. Sur la participation à la vie de l'établissement, un collège du Bas-Rhin donne des points aux élèves qui sont délégués de classe. Or, forcément, tous les élèves ne peuvent pas être élus ! En Meurthe-et-Moselle, on attribue des points aux élèves qui participent à un club où ils jouent à... des jeux vidéo. Dans un collège de Charente-Maritime, on compte les absences injustifiées des enfants et on y inclut celles des jours... de grève des enseignants ! Autre exemple : dans un établissement parisien, la moitié de la note est aléatoire, donnée par différents professeurs sans qu'aucun critère précis ne leur ait été donné. Le Figaro 24/03/07 Rapport IGEN - n° 2007- 017 février 2007 Mise en œuvre de la circulaire n° 2006-105 du 23 juin 2006 relative à la note de vie scolaire |
Une trop grande liberté de ton coûte son poste au recteur de l'académie de Lyon |
Extraits Le recteur de l'académie de Lyon, Alain Morvan, qui s'était publiquement opposé à la création du collège musulman Al-Kindi et avait pris une part active dans les poursuites judiciaires contre Bruno Gollnisch, a été remplacé, mercredi 21 mars, sur proposition du ministre de l'éducation. Selon l'entourage du ministre, Gilles de Robien a proposé son départ en raison de "manquements multiples à l'obligation de réserve" et de "commentaires de décisions de justice". M. Morvan "a l'habitude de commenter, ce qui est rare chez les hauts fonctionnaires". "Au-delà, il a une tendance à faire comme si les valeurs de la République n'avaient qu'un défenseur : Alain Morvan." L'association étudiante lyonnaise Hippocampe, qui regroupe des étudiants de l'université Lyon-III "contre le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme", avait publié une lettre ouverte, adressée au président de la République, l'exhortant à ne pas "céder aux pressions" et assurant que M. Morvan avait "su incarner avec honneur et courage la lutte contre l'extrémisme et toutes les tentatives communautaristes". Le Monde 22/03/07 Le recteur de Lyon démis de ses fonctions Réagissant à son limogeage, Alain Morvan s'est dit mercredi "Kärcherisé". "Il ne s'agit pas d'une mutation, mais d'une sanction, une révocation", a jugé le recteur. "Je quitte cette académie le coeur lourd mais serein, et surtout la tête haute. Aujourd'hui, c'est une grande journée, pour le négationnisme, l'extrême-droite, l'antisémitisme et les adversaires de la laïcité. C'est surtout une grande journée pour moi (qui considère ma révocation) comme un honneur qui justifie les combats que j'ai menés".La Croix 22/03/07 Le recteur de Lyon, Alain Morvan, remplacé en conseil des ministres AFP 21/03/07 Le recteur de Lyon se dit «kärcherisé» Libé 22/03/07 L'ex-recteur de Lyon affirme avoir été "kärcherisé" Le Figaro 22/03/07Alain Morvan, l'intransigeant de la laïcité Le Monde 24/03/07Ça lui a coûté chaire Alain Morvan, 62 ans, ex-recteur de l'académie de Lyon limogé par Robien (et Sarkozy ?). Libé 30/03/07 |
Ecole, mythe et mirage de la démocratisationAlain Bentolila professeur de linguistique à l'université Paris-V
|
Extraits Jusqu'en 1965, l'entrée en sixième, avec ou sans examen, n'ouvrait les portes du collège - et pour quelques-uns du lycée - qu'à moins du quart d'une classe d'âge. Tous les élèves ont aujourd'hui accès à l'enseignement secondaireAuparavant, les exigences affichées de l'examen de sixième imposaient aux programmes de l'école primaire une très forte contrainte : on savait ce que l'on attendait du primaire en termes de contenus et de savoir-faire communs. Lorsque s'est levée la barrière d'une sélection qui, reconnaissons-le, était injuste et cruelle, s'est trouvé précipité dans un système, jusqu'ici soigneusement protégé, un nombre considérable d'enfants qui en étaient jusqu'ici écartés. Le filtre culturel et social a été retiré et l'école se trouve ainsi mise au défi d'instruire des enfants de moins en moins éduqués : de l'école on leur a donné des représentations confuses et parfois négatives ; du langage ils n'ont acquis qu'une maîtrise très approximative. Lorsqu'il a été décidé d'ouvrir largement les portes de l'école à tous les enfants de ce pays, a été pris en même temps l'engagement de les y recevoir tous, tels qu'ils étaient ; ceux issus de catégories sociales peu favorisées et aussi, de plus en plus nombreux, ceux "venus d'ailleurs", en équilibre culturel et religieux instable. Mais ce défi ne pouvait certainement pas être relevé par une école qui était conçue pour accueillir des privilégiés préalablement triés. Il aurait donc fallu que cette école se transformât en profondeur dans ses contenus, sa pédagogie, la formation de ses maîtres et ses finalités professionnelles. Elle est en fait restée identique à elle-même. Si elle a réussi la massification de ses effectifs, l'école a raté sa démocratisation. Sur la base de cette définition erronée on a mis en place un fonctionnement pervers qui a permis de décider a priori des taux de succès à des examens peu à peu dévalués et d'afficher ainsi une façade démocratiquement présentable. Le Monde 16/03/07 |
Le tabou de la carte scolaire |
Extraits Dès mars 2006, [Nicolas Sarkozy] propose de "supprimer la carte scolaire" et met en avant l'idée du " libre choix" de l'établissement par les familles. A la rentrée de septembre, le ministre de l'éducation, Gilles de Robien, parle d'"assouplir" la carte scolaire. D'accord sur l'idée, Jacques Chirac déclare, le 18 septembre, que la carte scolaire est "le garant de la mixité sociale". A gauche, Ségolène Royal lance le débat avant même d'être investie par son parti. La carte scolaire "fige et cristallise les inégalités", déclare alors la candidate à l'investiture du PS qui prône un "assouplissement" et le choix entre plusieurs établissements. " Là, on verra quels sont les établissements qui sont délaissés", ajoute-t-elle en envisageant que l'on "donne plus" à ces établissements, dans une perspective de "reconquête de l'égalité scolaire". Il n'y a guère que le candidat de l'UDF pour défendre le statu quo. C'est même, selon lui, "une faute républicaine" que de vouloir supprimer la sectorisation. François Bayrou estime, en janvier 2007, que la carte scolaire est loin d'être "périmée, comme le croient conjointement Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal", mais il insiste sur la nécessité de garantir, sur tout le territoire, "l'égalité de traitement des enfants". Mme Royal place l'éducation "au coeur de tout et en avant de tout", le candidat centriste lui donne "la priorité absolue". Les deux candidats s'engagent à "rétablir", dès la rentrée 2007, les postes d'enseignants supprimés et à "garantir les moyens" sur cinq ans. M. Sarkozy se distingue nettement de ses deux concurrents. Le candidat de l'UMP promet, certes, aux maîtres de "rétablir leur autorité" et de défendre leur pouvoir d'achat. Mais il continue d'affirmer son intention " de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant en retraite". Le Monde 15/03/07 |
Carte scolaire: le grand gymkhana
|
Extraits Ils sont prêts à tout. Les parents sont devenus très inventifs pour contourner la carte scolaire. Le système a été créé en 1963 par Christian Fouchet, ministre de l'Education nationale, pour répondre à l'afflux d'élèves dû à l'extension de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Au fil du temps, il a été présenté comme un instrument de la mixité sociale. Les catégories qui recourent en majorité à la stratégie d'évitement sont les plus aisées. Privilégiés, les enseignants: l'usage veut qu'on permette à leurs enfants d'étudier dans la même école que celle où ils professent. Ce que Marco Oberti, sociologue, chercheur au CNRS et auteur de L'Ecole dans la ville (Presses de Sciences po), a mis en lumière dans une étude réalisée dans les Hauts-de-Seine. Il montre que la part d'enfants de cadres fréquentant un autre collège que celui de leur zone peut monter jusqu'à 60%, contre 28% chez les professions intermédiaires, 21% chez les employés et 18% chez les ouvriers. Les parents les mieux informés ont compris ce que développe le sociologue Eric Maurin dans Le Ghetto français. Enquête sur le séparatisme social (Seuil). Bon quartier = bonne école = bons élèves = bonnes notes. Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de dérogations accordées chaque année, mais on en estime le taux jusqu'à 40% à Paris, entre 3 et 10% ailleurs. La façon la plus sûre d'obtenir l'inscription de ses rêves reste le choix d'une option rare, les langues vivantes en particulier. Chinois, polonais, italien, japonais. Afin de «contourner le contournement», des options rares sont peu à peu proposées dans les lycées les moins cotés. L'ultime méthode d'évitement, sans doute la plus fréquente, consiste à se tourner vers le privé. Qu'ils veuillent l'assouplir ou la supprimer, les détracteurs de la carte scolaire, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en tête , prônent en tout cas un lifting de la sectorisation à la française. L'organisation qui apparaît comme la plus équitable socialement est celle dite «du libre choix régulé», pratiquée en Suède et au Danemark, où tous les parents, et non une poignée de favorisés, peuvent formuler plusieurs vœux d'établissements. Les experts, de gauche comme de droite, [multiplient] les pistes de recherche: aide accrue aux établissements contournés, redécoupage de la carte en «portions de camembert», afin de mélanger centre et périphérie; intégration des écoles privées dans la sectorisation. La plupart mettent la politique de la ville au cœur de leurs réflexions. L' «école ghetto» est d'abord la résultante de la ségrégation résidentielle. L'Express 15/03/07 |
|
« Apprendre, ce n’est pas empiler, c’est mettre en relation » |
Extraits Le chercheur Alain Bentolila a remis au ministre de l’Éducation, hier, le rapport qui lui avait été commandé sur l’enseignement du vocabulaire. Visant à réduire la « fracture linguistique » qui persiste entre les enfants, celui-ci préconise « le retour de leçons de mots » dès l’école maternelle. Éveline Charmeux, agrégée de grammaire, ex-formatrice IUFM et chercheuse à l’INRP, aujourd’hui à la retraite [estime que] e qui est préconisé ici repose sur des erreurs. Or, lorsque l’on fait, à l’école, des choses dont les recherches démontrent qu’elles sont erronées, on met en difficulté les enfants qui n’ont que l’école pour s’en sortir. La première [erreur] consiste à dire qu’apprendre, c’est empiler les connaissances nouvelles - c’est ce que l’on retrouve dans la proposition d’enseigner 365 mots nouveaux par an. Les savoirs ne peuvent pas se construire un par un. Si jeune qu’il soit, l’enfant dispose d’un savoir. Apprendre consiste à le transformer, à le rectifier. On apprend en se heurtant. Ce conflit cognitif implique de mettre en relation ce que l’on savait déjà avec ce que l’on vient de découvrir. Le vocabulaire n’est pas un ensemble d’étiquettes posées sur le monde extérieur et identique pour tous. C’est un facteur d’organisation du réel. La façon dont on perçoit le monde est déterminée par la langue que l’on parle. L’exemple le plus célèbre est celui du mot neige, qui n’existe pas en inuit, la langue des Esquimaux. En revanche, ils ont quatorze mots radicalement différents pour désigner quatorze sortes de neiges. En français, ils n’ont aucun sens : tout dépend du contexte. Si je dis « volume », de quoi je parle ? Du son de la télé ou du contenu d’un verre ? Sans compter les emplois figurés... Vous imaginez le nombre de définitions qu’il faudrait donner ? Une langue, ce n’est pas une accumulation de mots. |
|
Un rapport préconise d'enrichir le vocabulaire des élèves du primaire. Robien veut plus de mots pour les marmots Libé 14/03/07
|
Extraits Après la lecture, la grammaire et le calcul, voilà venu le temps du vocabulaire. Le linguiste Alain Bentolila rend aujourd'hui son rapport sur l'acquisition du vocabulaire à l'école élémentaire au ministre de l'Education, Gilles de Robien. Pour faire progresser le niveau, il propose de mettre en place des leçons de mots, deux fois une demi-heure par semaine, d'équiper les élèves d'un cahier de vocabulaire et enfin de déterminer 365 mots à acquérir chaque année. Alain Bentolila est parti d'un constat simple. Tout petits, les enfants ont déjà d'énormes différences de niveau. A la fin du CE1, c'est-à-dire autour de 7 ans, les meilleurs possèdent 8 000 mots, contre 3 000 pour les plus faibles. Les enfants issus de milieux défavorisés ont généralement le lexique le plus pauvre, les enfants des milieux favorisés le plus riche, comme on s'en doute. Alain Bentolila refuse de dire si le niveau général a baissé dans ce domaine : «On manque d'études.» Sans doute aussi est-il soucieux de ne pas apparaître dans le camp des «déclinistes» et autres nostalgiques de l'«école de papa». Il préfère dénoncer les ghettos où, enfermés dans une même culture, les enfants se limitent à un vocabulaire réduit «de connivence». «La ghettoïsation scolaire engendre la pénurie et l'imprécision lexicale», souligne son rapport, «c'est en organisant une mixité contrôlée que l'on apprendra à tous les élèves que la langue est d'abord faite pour parler à ceux qui ne leur ressemblent pas. » Le linguiste préconise des leçons de mots «régulières et systématiques», non pas ennuyeuses à l'ancienne, mais vivantes. «Le maître réunit un petit groupe d'élèves les autres sont occupés à autre chose , et quatre à cinq mots sont étudiés pendant la séance, explique-t-il, chacun dit le sens qu'il a pour lui, le dictionnaire sera l'arbitre suprême.» Libé 14/03/07 Gilles de Robien s'attaque à l'enseignement du vocabulaire Nel Obs 14/03/07 Portrait d’Alain Bentolila, 57 ans, linguiste, consulté par Gilles de Robien sur la réforme de l'enseignement du français. Ses détracteurs l'accusent de servir de caution à une politique passéiste. Libé 14/03/07 La "leçon de mots" revient à la maternelle : l'objectif est l'apprentissage de 365 mots par an Le Monde 15/03/07La "leçon de mots" à l'école pour réduire les inégalités AFP 14/03/07 L'apprentissage des mots dès la maternelle AP 14/03/07 "La leçon des mots" introduite dans les écoles Reuters 14/03/07 Gilles de Robien s'attaque à l'enseignement du vocabulaire Nel Obs 14/03/07 Leçon de mots pour la Semaine de la langue française La Croix 14/03/07 Gilles de Robien s'attaque au vocabulaire des enfants Le Figaro 14/03/07 Rapport de mission sur l’acquisition du vocabulaire à l’école élémentaire (téléchargeable) |
Ecole : redoubler à la française
|
Extraits Le redoublement ne sert quasiment à rien, sauf, peut-être, au lycée. Toutes les études l'attestent, et pourtant la France s'obstine dans cette pratique. Elle est en tête des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en ce qui concerne le redoublement des élèves. En 2003, 38 % des élèves français âgés de 15 ans avaient déclaré avoir redoublé au moins une fois. La loi d'orientation du 23 avril 2005 sur l'avenir de l'école, dite loi Fillon, a légitimé une pratique dont on connaît les effets néfastes. Plus un redoublement est précoce, plus les effets en sont néfastes. "Un élève qui redouble au cours préparatoire ou au cours élémentaire première année a près d'une chance sur deux de sortir de l'école dix ans plus tard sans diplôme", écrit-Christian Forestier dans son dernier ouvrage (Que vaut l'enseignement en France ?, mars 2007, Stock). Les élèves qui redoublent leur CP réussissent moins bien que les élèves de même niveau admis dans la classe supérieure (CE1). Depuis le début des années 1990, les redoublements ont diminué de manière constante sous l'impulsion des recteurs et des inspecteurs de l'éducation nationale. Ils sont passés de 10 % en 1996 en sixième et en cinquième à respectivement 7,2 % et 3,6 % en 2005, de 8,5 % en 1992 en CP à 7,2 % en 2000. En revanche, leur taux reste très élevé en seconde, le niveau de l'enseignement secondaire où on redouble le plus, avec 14,7 % en 2005 contre 15,8 % en 1993. Le Monde 13/03/07 |
|
La présidentielle sur les bancs de l'école Thomas PIKETTY |
Extraits Pour Nicolas Sarkozy, la cause est entendue : la mise en concurrence généralisée des écoles doit permettre de tirer par le haut l'ensemble du système éducatif. Il suffit en particulier de mettre fin à la carte scolaire, de supprimer les ZEP (zones d'éducation prioritaire) et de les remplacer «par rien». Le simple jeu de la concurrence entre écoles et collèges permettra alors d'augmenter la qualité de tous les établissements, chacun pouvant librement développer son projet pédagogique et trouver sa niche sur le marché scolaire. Ségolène Royal propose, pour la première fois en France, la mise en place d'un véritable ciblage des moyens en faveur des écoles faisant face aux plus lourds handicaps. Son pacte présidentiel annonce ainsi qu'en ZEP les effectifs des classes de CP et de CE1 seront réduits à 17 élèves par classe. Cette mesure, qui concernerait l'ensemble des écoles classées en ZEP (environ 15 % des écoles, soit plus de 250 000 élèves par an en CP et CE1), et non pas une infime fraction d'entre elles, constitue la première tentative pour doter les écoles défavorisées de réels moyens supplémentaires. Tout laisse à penser que les vertus de la concurrence, au niveau de l'enseignement primaire, sont limitées. Les expériences de mise en concurrence des écoles primaires et des collèges à partir du système de vouchers (chèques-éducation que les parents donnent à l'école de leur choix) promu par l'administration Bush ont donné des résultats décevants en termes d'amélioration de la qualité du service éducatif et de performances scolaires. A contrario, les recherches les plus récentes suggèrent qu'une politique de ciblage des moyens en faveur des écoles défavorisées pourrait avoir des effets tangibles. La réduction de la taille des CP et des CE1 à 17 élèves en ZEP permettrait ainsi de réduire de près de 45 % l'inégalité entre ZEP et hors ZEP aux tests de mathématiques à l'entrée en CE2. Pour une mesure qui coûtera moins de 700 millions d'euros, le rendement apparaît excellent. Bayrou insiste surtout sur des questions de méthode (aucune réforme éducative ne peut être menée sans les enseignants et leurs organisations représentatives, etc.) et ne se prononce clairement ni sur la question de la concurrence scolaire ni sur celle des ZEP. Libé 12/03/07 |
|
« leçons de mots » de Robien |
Extraits La fracture linguistique existe : un rapport, qui sera rendu public mercredi 14 mars, le confirme. Commandé par le ministère de l’Éducation nationale, il doit servir de base à « rénover » l’apprentissage du vocabulaire, dans le cadre de la refonte des programmes induite par le socle commun de connaissances. « En étudiant une classe de CE1, nous avons constaté un écart de niveau équivalant à cinq années scolaires entre les élèves les mieux dotés en vocabulaire et ceux les moins bien pourvus », explique Alain Bentolila. Autrement dit, dans cette même classe, certains ont un niveau équivalent au CM1, tandis que d’autres utilisent un lexique comparable à celui de la grande section de maternelle. « Ces groupes d’élèves se définissent très nettement en fonction du niveau socioculturel des familles ainsi que de la disponibilité que les parents sont en mesure d’accorder à leur enfant. » Première concernée, l’école, laquelle ne parvient pourtant pas à résorber ces inégalités. « Elle ne s’en donne pas les moyens », estime le linguiste, qui rappelle que la « bibliothèque de mots » d’un enfant s’alimente dès le début de sa scolarité. « Accueillir les enfants de deux à trois ans dans des classes dépassant dix élèves condamne forcément les plus faibles » Alain Bentolila défend ainsi la mise en œuvre de leçons de mots, soit des moments entièrement consacrés à l’apprentissage du vocabulaire. À raison de deux fois une demi-heure par semaine. L'Humanité 07/03/07 |
M. de Robien dit vouloir achever la réforme des "apprentissages fondamentaux"
|
Extraits Gilles de Robien, doit présenter, mercredi 7 mars, une circulaire réformant l'apprentissage du calcul à l'école primaire. Gilles de Robien entend aller au bout de ce qu'il présente comme une "remise en ordre" des "apprentissages fondamentaux" il avait publié, en mars 2006, un arrêté modifiant les programmes. En insistant sur l'apprentissage du code "dès le début" du CP, mais en complémentarité avec d'autres approches, ce texte décevait les partisans exclusifs du b.a.-ba. Convaincu d'avoir rétabli "le bon sens", M. de Robien a été approuvé par l'opinion publique, persuadée qu'il venait de terrasser la "méthode globale". Le ministre a rapidement étendu sa démarche aux autres composantes des savoirs fondamentaux : la grammaire, avec la circulaire du 11 janvier rétablissant un horaire spécifique pour cet apprentissage, et à présent le calcul. Exaspérés par des mesures jetant "la suspicion" sur les professeurs des écoles, leurs syndicats jugent qu'il ne fallait pas toucher aux programmes du primaire de 2002, validés après "large consultation". Auteur de Que vaut l'enseignement en France ? (Stock), Christian Forestier, inspecteur général, ex-directeur de cabinet de Jack Lang, se dit préoccupé par l'échec scolaire lourd qui, dit-il, "se construit entre la grande section de maternelle et les premières années d'école", mais il ne croit pas aux "méthodes miracles". Pour lui, la priorité est "le statut que l'on accorde à l'élève" déclaré en France "en échec", mais qu'on appelle ailleurs "à besoins particuliers". Autrement dit, il faudrait plus de pédagogie et de sur-mesure. Laurent Lafforgue, médaille Fields 2002, ne partage pas cette analyse. Selon lui, "les savoirs fondamentaux que l'école primaire doit donner à tous sont, par ordre de priorité : la pratique exacte et sûre de la langue écrite et orale (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire), la maîtrise du calcul des nombres et des grandeurs, de la proportionnalité, des constructions géométriques, de solides éléments d'histoire chronologique, de géographie physique et de sciences". Le Monde 07/03/07 Le calcul nouvelle sauce L'Humanité 07/03/07 Robien signe la circulaire instaurant 15 minutes de calcul mental par jour AFP 07/03/07 Circulaire : MISE EN ŒUVRE DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES : L’ENSEIGNEMENT DU CALCUL |
Le baccalauréat "porteur d'inégalités"Pour Christian Forestier les enfants issus de milieux défavorisés sont surreprésentés dans les voies technologiques et professionnelles |
Extraits « Depuis maintenant plus de dix ans, le système est en panne ». C'est le constat que dresse Christian Forestier, inspecteur général de l'Éducation nationale, du système éducatif français dans un ouvrage à paraître demain et intitulé Que vaut l'enseignement en France ? Alors que le taux de bacheliers est passé entre 1985 et 1995 de 30 % à 60 % - il était de 10 % à la fin des années 1950 -, il stagne depuis dix ans ! Selon l'Éducation nationale, la proportion de jeunes qui obtiennent le baccalauréat a atteint l'an dernier 63,8 %. Elle était de 29,4 % il y a vingt ans et de 62,7 % il y a dix ans. L'augmentation de l'accès au baccalauréat s'est faite au profit de l'émergence des bacs technologiques, créés en 1968, et professionnels, créés en 1985. Le taux d'accès des jeunes issus des milieux les plus défavorisés reste inférieur à 50 %, essentiellement dans les voies technologiques et professionnelles. « La probabilité pour un enfant d'ouvrier d'avoir le bac général n'a pas bougé depuis le début des années 1980, elle est toujours de 15 % » 20 % d'une classe d'âge, s'arrêtent au baccalauréat, dont la moitié après avoir tenté les études supérieures. « Et les deux tiers de ces jeunes laissés sur le bord du chemin de l'enseignement supérieur ont passé bac technologique ou professionnel ! » Le Figaro 06/03/07 |
« La meilleure école du monde pour 50 % d'élèves »Et la pire pour l'autre moitié des jeunes Français ! On peut y remédier sans faire sauter le budget. Interview de Christian Forestier, fin connaisseur de l'Éducation nationale, qui vient de sortir avec J.C. Emin « Que vaut l’enseignement en France ? » (Stock) |
Extraits Jeter un discrédit excessif, avec des titres racoleurs comme La Fabrique du crétin, est dévastateur. Surtout pour les plus modestes, pour lesquels faire des études ne va pas forcément de soi. En plus, c'est contraire à la réalité. L'étude internationale Pisa, qui compare le niveau des jeunes de 15 ans dans les 60 pays les plus développés, le montre bien. Nos petits Français y apparaissent comme, disons, un peu mieux que moyens... Mais si l'on n'étudie que les 50 % qui n'ont jamais redoublé, ils obtiennent des résultats extraordinairement élevés. A contrario, l'autre moitié obtient des résultats franchement mauvais. Donc, on a aussi l'un des systèmes les plus médiocres lorsqu'il s'agit d'aider les élèves en difficulté. Toutes les évaluations montrent que le redoublement est inefficace ! Et même dangereux, lorsqu'il est pratiqué précocement, au début du primaire. Pour les très jeunes enfants, il est vécu comme une sanction démobilisante. Qu'on fasse pression sur un ado de 14 ans en le menaçant de redoubler, ça peut éventuellement lui faire du bien. Mais sur un môme de six ans, c'est une catastrophe. Les redoublants des petites classes vont constituer plus de la moitié des 150 000 élèves qui sortent chaque année du système sans diplôme. Ouest-France 03/03/07 |
|
Une école simplement humaine Sylvain Grandserre, maître d’école |
Extraits Lors d’un journal télévisé [un] reportage tentait de comparer deux conceptions opposées du travail scolaire : l’une basée sur le tâtonnement, l’activité des élèves et l’exploitation de leurs erreurs ; l’autre conçue à partir de l’écoute du maître, de la répétition et de la mémorisation d’éléments à restituer. L’enseignant du continent aride, celui où l’on promet l’oasis de la connaissance à ceux qui traverseront ce désert scolaire, a expliqué qu’il n’était ni « facho » ni « réactionnaire », « seulement technique ». Or, justement, dans un travail avec des petits humains, n’est-ce pas cette approche « seulement technique » qui lui fait recueillir de si radicaux qualificatifs ? Quand on est éducateur, croire que l’on peut s’exonérer de toute critique parce que l’on a rempli froidement sa mission clinique et agi en technicien appliqué est une faute. Il est vrai que chez ces gens-là, « on n’éduque pas monsieur, on instruit, le reste ne nous regarde pas ». Certains l’avaient compris, notamment le pédagogue Célestin Freinet qui préférait que l’on parle de « pédagogie » plutôt que de « techniques » Il ne s’agit pas d’opposer ce qui se complète nécessairement : instruction et éducation, technique et projet, expression et écoute, émergences et apports, individus et collectif, découverte et réification des connaissances, élèves et savoirs. Pour finir, la parole revient à Haim Ginott, qui écrivait à de futurs professeurs : « Je suis un survivant des camps de concentration. Mes yeux ont vu ce qu’aucun homme ne devrait voir : des chambres à gaz construites par des ingénieurs instruits, des enfants empoisonnés par des médecins éduqués, des nourrissons tués par des infirmières qualifiées et entraînées, des femmes et des bébés exécutés et brûlés par des diplômés de collèges et d’universités. Je me méfie donc de l’enseignement. Ma requête est la suivante : aidez nos élèves à devenir des êtres humains. Vos efforts ne doivent jamais produire des monstres éduqués, des psychopathes qualifiés, des Eichmann instruits. La lecture, l’écriture, l’arithmétique ne sont importantes que si elles servent à rendre nos enfants plus humains. » L'Humanité 17/02/07 |
Un rapport controversé de l'Inserm sur les "troubles des apprentissages"
|
Extraits Intitulée "Dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, bilan des données scientifiques", cette expertise se trouve au croisement de deux polémiques récentes : l'une sur l'apprentissage de la lecture, l'autre sur la question du "dépistage" précoce des "troubles du comportement". Fondée sur une analyse de la littérature scientifique disponible, elle est signée par une douzaine d'experts, en majorité neurologues et psychologues cognitivistes. Parmi ces derniers figurent Michel Fayol (CNRS), Jean-Emile Gombert (Rennes-II), Franck Ramus (Ehess) et Liliane Sprenger-Charolles (CNRS). Ces experts avaient été cités par Gilles de Robien à l'appui de ses mesures sur l'apprentissage de la lecture, avant que la plupart d'entre eux ne finissent par protester contre l'usage, à leurs yeux abusif, de leurs travaux par le ministre de l'éducation. Les troubles étudiés, qui "ne peuvent être attribués ni à un retard intellectuel, ni à un handicap sensoriel, ni à une pathologie psychiatrique avérée (...), se rencontrent chez les enfants de tous les milieux socioculturels" et concernent "environ un quart des enfants en échec scolaire". Les auteurs proposent de développer la prévention en milieu scolaire grâce à des tests étalonnés selon l'âge de l'enfant et permettant de "détecter" les "signes prédictifs" des troubles. "A nouveau, on confond prévention et signe prédictif, écrit le psychanalyste Roland Gori, qui proteste contre cette "rhétorique scientiste". "On ignore les effets des contextes culturels, socioéconomiques et pédagogiques" Les experts ne prennent pas en compte une des causes déterminantes des troubles : la sécurité affective", regrette [le Professeur H. Montagner] Le Monde 17/02/07 L'Inserm se penche sur les troubles des apprentissages scolaires AFP 16/02/07 Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie Bilan des données scientifiques Rapport téléchargeable |
Sortir de l'hypocrisie scolaireHervé Hamon Écrivain, auteur de Tant qu'il y aura des élèves (Seuil) |
Extraits Il a suffi qu'un candidat évoque l'opportunité d'une plus ample présence des maîtres dans les établissements, pour qu'on récolte une controverse ringarde sur le temps de travail global des enseignants. De l'énergie perdue et un vrai sujet gâché. Le premier impératif est de se mettre d'accord sur des constats. On divergera ensuite. Notre système d'enseignement est un des meilleurs du monde pour la moitié de ses élèves. Pour la seconde moitié, en revanche, c'est une autre affaire. 30 % s'en sortent plus ou moins. Et 20 % - c'est énorme - sont en grande ou très grande difficulté scolaire. Chaque année, 150 000 jeunes gens quittent l'école sans véritable diplôme ni qualification. Or ce sont les plus pauvres à l'origine et ils seront les plus fragiles à l'avenir. Notre école sait très bien s'occuper des bons élèves. Les autres, elle les fait redoubler (véritable « mal français »), ce qui est la manière la moins efficace et la plus coûteuse de leur porter secours. Entre 1985 et 1995, dans un contexte de crise, nous avons parié sur l'éducation. De l'argent, du travail, de l'imagination. Et ça a marché. Les familles ont joué le jeu, les enseignants ont joué le jeu, les parlementaires ont voté les budgets, les élèves ont travaillé. Nous avons doublé en dix ans le nombre de bacheliers, et transformé l'enseignement professionnel. Mais depuis dix ans, nous sommes en panne. Le peloton de tête est plus étoffé qu'hier, roule plus vite et va plus loin. Mais ceux qui restent à l'arrière sont plus distancés, plus marginalisés et humiliés. Les filles se sont affirmées comme les meilleures élèves. Mais la médiocrité et le conservatisme de l'orientation les privent du salaire de leurs efforts : on continue de les orienter à la baisse. L'ascenseur social n'est pas complètement en panne (nous amenons au niveau de technicien supérieur des jeunes qui, naguère, n'auraient pas dépassé le CAP). Mais seuls les enfants de cadres supérieurs ont accès à tous les étages. Ou bien nous maintenons l'ambition énoncée voilà plus de trois décennies d'ouvrir le collège à tous et de tirer chaque élève vers le haut. C'est possible, mais au prix d'importantes réformes et pas seulement du sempiternel accroissement des moyens. Ou bien nous nous contentons de dire « Que le meilleur gagne ! » C'est un choix, mais sachons que « le meilleur » ne sera pas le plus démuni. Ouest-France 16/02/07 |
M. de Robien remet ses propositions sur l'aménagement de la sectorisation |
Extraits La sectorisation des collèges publics qui, jusqu'à présent, était du ressort des conseils généraux pourrait "être déléguée aux maires des grandes villes et aux présidents de communautés d'agglomérations". Ces collectivités auraient la possibilité de "participer à une redéfinition, à titre expérimental, des anciens secteurs, en ouvrant une possibilité d'affectation sur un territoire élargi regroupant deux ou trois établissements". Les recteurs, "en liaison avec la collectivité régionale", seraient chargés de "réguler l'offre de formation et l'affectation dans les lycées professionnels et d'enseignement général et technologique, par territoire et par pôle de spécialisation". La troisième piste confie à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances "une mission de coordination des politiques publiques en matière de mixité sociale dans les grandes agglomérations et leur périphérie". Enfin, la quatrième mesure vise à rendre moins opaque le processus de sectorisation. L'éducation nationale s'engage "à publier des indicateurs officiels permettant aux parents de disposer de toutes les informations nécessaires (...). De même seront diffusés les critères et procédures d'élaboration de la carte scolaire". Le Monde 14/02/07 |
Orthographe : les collégiens de cinquième sont tombés au niveau des élèves de CM2 de 1987 |
Extraits Les performances des élèves en orthographe sont en baisse sensible, au point que le niveau d'une classe de cinquième de 2005 est celui d'une classe de CM2 de 1987. Cette baisse est démontrée par un travail universitaire. Leur enquête est présentée dans un ouvrage qui doit être publié le 22 février sous le titre Orthographe : à qui la faute ?, aux éditions ESF. Réalisée en 2005, elle reproduit à l'identique, selon le même protocole, une enquête précédente menée en 1986-1987 par le chercheur André Chervel et Danièle Manesse sur le niveau orthographique des élèves de 10 à 16 ans. Celle-ci procédait à une comparaison à un siècle de distance, en s'appuyant sur les dictées collectées entre 1873 et 1877 par l'inspecteur général Beuvain d'Altenheim. Les résultats de cette comparaison étaient alors en faveur des élèves de 1987. la comparaison des résultats entre 1987 et 2005 témoigne d'une chute importante du niveau. Les erreurs ont considérablement augmenté : là où les collégiens en faisaient huit en 1987, ils en font treize en 2005. Là où les élèves de CM2 faisaient douze erreurs, ils en font dix-huit. En 1987, 50 % des élèves faisaient moins de six fautes. Ils ne sont plus que 22 % en 2005. Le Monde 09/02/07 La dictée: de passable à médiocre 20 minutes 09/02/07Les élèves nuls en orthographe ? Le Figaro 09/02/07Des élèves moins bons en orthographe La Croix 13/02/07 Les élèves régressent Le Point 16/02/07 |
A l'école, Marianne ne serait plus qu'un fantôme
|
Extraits On parle relativement peu de l'école, pour un temps d'élection. De débat de société sur les fondations, les murs, la charpente, la toiture scolaire, sur l'institution qui, peu ou prou, structure la société française et façonne les jeunes consciences à la citoyenneté, point. Dommage, quand on observe les tensions qui animent celle-ci (l'obscurcissent ? la malmènent ?) sous le poids des mutations sociologiques, et, notamment, de l'individualisation, qui bouscule tout idéal collectif - et donc la République. Maroussia Raveaud, maître de conférences en civilisation britannique à l'Université du Maine, a ouvert ses yeux dans de petites classes (4-7 ans), où se forge la citoyenneté (De l'enfant au citoyen, PUF, 2006). Si les deux systèmes [ont] leur cohérence, forte, sur des fondements opposés (la tradition républicaine ici, un idéal multiculturel là-bas), en France, certes, "Marianne règne toujours en maîtresse à l'école", mais "elle n'est plus qu'un fantôme". L'école française fonctionnerait bien toujours sur un modèle "d'indifférence aux différences", au sens où l'école doit permettre de neutraliser celles jugées illégitimes. Et ce modèle inspirerait toujours les pratiques des enseignants. Mais, remarque-t-elle, celles-ci seraient, comme déconnectées de leur justification initiale, notamment des valeurs qu'elles sont censées étayer pour la construction de la citoyenneté. Ainsi, si des enseignants répartissent des responsabilités dans une classe en fonction d'un roulement, ce n'est plus nécessairement par souci d'appliquer des principes civiques ou égalitaires : ce pourra être ici par souhait pédagogique, là par commodité, voire plus abruptement, "parce que c'est comme ça". Comme si les pratiques n'étaient plus investies de sens par ceux-là mêmes qui les mettent en oeuvre. Ou comme si une forme de pragmatisme finissait par avoir raison des idéaux républicains. Or "l'école peut-elle aujourd'hui continuer à donner aux élèves l'impression d'être indifférente à leurs différences, sans se justifier ? Si les élèves ressentent ce mode de fonctionnement comme une négation de leur individualité, est-ce par opposition au principe (républicain) de séparation des sphères publique et privée ou parce que ce principe n'est pas ressenti, compris, expliqué ?" Car faute de pédagogie sur ce point, le divorce des individus d'avec l'école peut bien sûr aller croissant. De même que la tentation, pour certains, en réaction, de reporter sur l'individu (et non pas le système) la responsabilité d'un éventuel échec dans la construction de la citoyenneté. Le Monde 04/02/07 |
|
« Aidons les enseignants à dépasser leur peur » Dominique Guy, secrétaire générale du Cercle de recherche et d’action pédagogiques |
Extraits Enseigner, ce n’est pas seulement étaler ses propres connaissances. C’est faire passer les savoirs. C’est aussi travailler à la citoyenneté, s’intéresser à ce qui se passe en dehors des cours. Tout changement met dans l’insécurité. Ça fait peur, entre autres aux enseignants. Ce n’est pas choquant. Ce qui l’est, c’est qu’on ne les aide pas à dépasser cette peur. On réfléchit comme si tout était affaire de vocation. Ceux qui échouent, c’est de leur faute, ceux qui réussissent, c’est qu’ils ont « le don ». Jamais la question n’est posée en termes de formation. Il s’agit de se demander sans arrêt comment faire pour qu’un élève ait envie d’aller chercher des savoirs. Cette question est bien plus forte en ZEP quand, par ailleurs, il n’est pas question de transiger sur ce qu’on exige des élèves. On n’apprend pas à faire du vélo en regardant les autres pédaler. C’est un peu pareil pour les maths. Les élèves n’arrivent pas vierges, ils ont déjà des connaissances. Ils sont en mesure de chercher, en tâtonnant, une solution qui fonctionne dans un cas, puis dans tous les cas semblables, jusqu’à déduire le théorème. Comme pour le vélo, ils commencent par se faire des bleus. Ils se trompent, ils trébuchent... Mais ils y arrivent. L’une [des difficultés des mouvements pédagogiques] se résume par une formule : nous avons des convictions, pas de certitudes. Aujourd’hui, le débat pédagogique s’est imposé parce que tout le monde comprend que les politiques en œuvre visent à détruire l’école publique. On fait croire qu’elle ne joue plus son rôle pour mieux la casser. L'Humanité 03/02/07 |
|
Robien veut enseigner les quatre opérations dès la maternelle. Le calcul n'attend pas le nombre des années
|
Extraits Gilles de Robien, a annoncé hier que les élèves feraient dès la rentrée prochaine quinze à vingt minutes de calcul mental par jour, à partir du CP et jusqu'en CM2, et qu'ils commenceraient à apprendre les quatre opérations dès la grande section de maternelle. Il a expliqué «la nécessité absolue» d'un exercice systématique du calcul mental pour «la mémorisation et les automatismes». Dès la grande section de maternelle, les enfants devront commencer le calcul, a-t-il ajouté, afin qu' «à la fin du CE1 les élèves sachent additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers simples». Les syndicats lui reprochent en vrac «une frénésie incontrôlée» de réformes, un mépris à peine voilé pour les professeurs, un prétendu dialogue mais sans vraie écoute, enfin une idéologie d'un autre temps. La façon de faire du ministre est en outre souvent ressentie comme arrogante. «Nos élèves apprennent mais le ministre n'apprend rie. C'est grotesque, ces déclarations montrent qu'il ignore tout de ce que font les enseignants dans leur classe, a [déclaré] Luc Bérille [SE-UNSA], Gilles de Robien n'a rien appris de ses déclarations calamiteuses sur la lecture.» Libé 24/01/07 «Le partage des bonbons» Libé 24/01/07 Calcul mental, apprentissages précoces: Robien dessine sa réforme des maths à l'école AFP 23/01/07AVIS SUR LA PLACE DU CALCUL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE adopté par le Comité secret du 9 janvier 2007(téléchargeable) Académie des sciences 23/01/07 Académie des Sciences : place du calcul dans l'enseignement primaire Discours - Gilles de Robien 23/01/2007 |
En finir avec l'élitisme scolaireFrançois Dubet, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (Ehess) |
Extraits Face à l'école, nous vivons sur un certain nombre d'illusions. Première illusion : le salut est dans le passé. L'air du temps est au conservatisme, voire aux appels réactionnaires à un âge d'or d'autant plus enchanté qu'il n'existe que dans la nostalgie des images d'Epinal. Les succès de librairie, les éditoriaux les plus fracassants et quelques déclarations politiques bien senties dénoncent en vrac le "laxisme", les "délires" pédagogiques, la chute du niveau, l'effondrement de la discipline, les instituts universitaires de formation des maîtres assimilés à des "goulags"… Dès lors, revenons au bon temps d'avant, aux bonnes vieilles méthodes, à l'orientation et à la sélection précoces, afin que l'école rompe avec les idées délétères de Mai68. Deuxième illusion : il n'est d'autre justice que l'égalité des chances. Bien sûr, tout doit être fait pour tendre vers cet idéal, et l'on propose donc de multiplier les parrainages entre les grandes écoles et les établissements difficiles, de créer des filières prestigieuses dans les zones défavorisées… C'est très bien, mais ce serait une lourde erreur que de croire que ces mesures feront, à elles seules, office de politique scolaire. Cette politique ne dit rien du sort qui sera réservé à la masse des élèves les moins favorisés et les plus faibles. Les plus libéraux et les républicains les plus rigides s'accordent sur une politique qui ne se soucie que de l'équité du recrutement des élites. Troisième illusion : tout est affaire de moyens. on propose de ne rien changer sur le fond et de donner plus de moyens pour faire la même chose. Dans cette perspective, on entend généraliser les systèmes d'aide et de soutien scolaires, comme si, ne pouvant changer l'école, on devait mobiliser les élus locaux, les travailleurs sociaux, les familles et les associations pour qu'ils fassent ce que l'école ne parvient plus à faire. Faut-il se résigner au fait que les programmes sont construits pour les élèves qui feront de longues études et doit-on continuer à orienter les autres par défaut vers les formations techniques et professionnelles parce qu'ils sont indignes des voies royales ? Dans une société où chacun va à l'école longtemps, les diplômes sont indispensables et l'échec scolaire se transforme en handicap social. En même temps, les diplômes protègent de moins en moins des risques de la précarité et du déclassement. Dans ce contexte, notre société doit-elle continuer à tout miser sur l'école et ne faut-il pas imaginer que la formation scolaire s'articule à d'autres types d'apprentissage ? Il n'est ni juste ni efficace que tout semble joué à la sortie des études, et c'est faire peser sur l'école une espérance qui sera fatalement déçue. Peut-on construire une école civique rompant avec la fausse alternative entre instruire et éduquer en donnant à chaque élève la confiance et l'estime de soi auxquelles il a droit ? Le Monde 23/01/07 |
M. de Robien pourrait réintroduire les quatre opérations du calcul dès le CP
|
Extraits Après l'apprentissage de la lecture et celui de la grammaire, le ministre de l'éducation, Gilles de Robien, s'apprête à réformer l'apprentissage du calcul à l'école primaire. L'Académie des sciences a réuni une commission de spécialistes. Celle-ci doit officiellement lui remettre, le 23 janvier, un avis. ce texte va dans le sens d'une possible réintroduction dès le CP de l'apprentissage des quatre opérations, pour lequel les programmes actuels privilégient la progressivité, particulièrement en ce qui concerne la division posée, qui n'est introduite qu'à partir du CE2. L'avis est résumé en huit points. Le premier point suggère que soit apportée "une attention toute particulière à la formation des maîtres". Le deuxième plaide pour un enseignement du calcul "en étroit contact avec les autres matières". Le troisième insiste sur "la mise en place d'automatismes". Le quatrième point affirme que "l'enseignement du calcul doit commencer par une pratique simultanée de la numération et des quatre opérations, manipulant aussi bien nombres "concrets" (nombre de pommes) qu'"abstraits" (nombre de fois)". Le cinquième point juge "toutes pertinentes, nécessaires et complémentaires" les modalités que sont le "calcul mental, calcul posé écrit, calcul approché, calcul instrumenté" (avec une calculette), et préconise de "fixer et structurer les connaissances en s'appuyant sur l'écrit". Le sixième point affirme que "les liens entre géométrie et calcul doivent être introduits très tôt", et souligne que "la recherche cognitive montre l'existence de liens étroits entre la représentation des nombres et celle de l'espace, qui font en partie appel aux mêmes régions cérébrales". Le septième insiste sur "l'importance de la proportionnalité" et préconise "une bonne maîtrise de la règle de trois en fin de primaire". Le huitième rappelle le rôle du jeu dans l'apprentissage du calcul. L'avis de la commission représente un succès relatif pour les adversaires du "pédagogisme", en premier lieu le groupe de recherches interdisciplinaires sur les programmes (GRIP). Le Monde 18/01/07 |
|
Une étude met en évidence l'obsession de la France pour les notes
|
Extraits Une étude internationale* sur les acquis des élèves et la méthode d'évaluation de ces acquis dans neuf pays met en évidence une France maniaque des notes, où "la dictature de la moyenne" entraîne une forte "angoisse scolaire". Intitulée "Que savent les élèves ?", cette étude réunit la réflexion de neuf chercheurs sur le système éducatif de leurs pays : les Etats-Unis, Singapour, le Japon, le Brésil, l'Allemagne, le Royaume Uni, la Finlande, le Portugal et la France. "En France, on fait des moyennes. Entre un 8 en anglais et un 12 en biologie, sait-on vraiment ce que sait un élève" qui a 10 de moyenne ?, a interrogé Alain Bouvier, professeur d'université membre du Haut conseil de l'Education (HCE) Les résultats décevants de la France aux évaluations de l'OCDE semblent prouver que la Finlande, par exemple, régulièrement aux premiers rangs mondiaux, tire les plus grands bénéfices de son absence de notation jusqu'à la fin du collège. En France, "le système est bon pour les bons élèves et, pour une frange conséquente, 40%, nous sommes au niveau des pays qui accueillent 100 élèves par classe et où les professeurs sont recrutés au niveau du bac". * Revue internationale d'éducation de Sèvres on peut consulter l'introduction, les résumés des articles et la bibliographie du dossier |
|
Robien très fier de sa réforme Le ministre a vanté le succès de ses collèges «ambition réussite» |
Extraits Le ministre de l'Education nationale a célébré le succès de son initiative, quatre mois à peine après son lancement. Les 249 collèges «ambition réussite», qui travaillent avec les écoles primaires voisines, sont les établissements classés ZEP les plus difficiles. Depuis la rentrée, ils bénéficient de moyens supplémentaires, notamment de professeurs «référents», censés renforcer l'équipe pédagogique, et d'assistants pédagogique. «Nous avons très largement tenu les objectifs que nous avions annoncés», s'est félicité Gilles de Robien. Le ministre s'est aussi projeté dans l'avenir, annonçant la création d'une quarantaine de lycées «ambition réussite» et assurant avec un bel aplomb que les moyens supplémentaires «seraient naturellement confirmés pour la prochaine rentrée». Or l'un des «grands» candidats, Nicolas Sarkozy, a déjà dit clairement tout le mal qu'il pensait de l'éducation prioritaire. Libé 17/01/07 Ouverture du séminaire des réseaux ambition réussite : l'excellence au service des élèves Discours - Gilles de Robien 16/01/2007 |
Colloque au centre PompidouL'objectif et l'intérêt de l'éducation artistique au crible de l'évaluation
|
Extraits L’éducation artistique et culturelle est-elle un moyen de développer des compétences dans d'autres domaines, par un mécanisme de transfert ? Une meilleure aisance verbale grâce au théâtre, des progrès en mathématiques via l'apprentissage du piano ? Mais est-il seulement souhaitable de mesurer l'impact de l'art à l'école à l'aune de tels objectifs ? Un débat joliment résumé par Jean-Marc Laubet, l'un des principaux initiateurs du colloque : "L'éducation artistique et culturelle a-t-elle pour but de préparer les enfants à "habiter poétiquement la Terre", selon l'expression de Hölderlin, à transformer leur rapport au monde et à eux-mêmes, ou à améliorer leurs performances dans les différentes disciplines scolaires ? On conviendra que, selon le cas, l'ambition n'est pas la même." L'évaluation est un enjeu politique, a souligné le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres : Mieux appuyer nos arguments en faveur de l'éducation artistique et culturelle, par des travaux scientifiques, peut contribuer à renforcer sa place dans le système éducatif et à assurer la continuité des politiques dans ce domaine" Personne n'est allé jusqu'à établir de lien de causalité entre l'enseignement d'une discipline artistique et la réussite dans une matière scolaire. Les arts plastiques stimuleraient "cinq aptitudes qui gravitent autour de l'idée d'autonomie", a soutenu Pierre Gosselin, spécialiste des arts visuels et professeur à l'université du Québec à Montréal. L'une d'elles est l'aptitude à "transcender" une proposition et à la faire sienne. Créer, c'est explorer une multitude de possibles, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Le Monde 16/01/07 |
|
Quel avenir pour la littérature ? Alors que paraissent en cette rentrée de janvier pas moins de 353 romans français, Tzvetan Todorov et François Bégaudeau s’interrogent sur le rôle de la littérature et sur l’enseignement du français.
|
Extraits
TZVETAN TODOROV :
L’enseignement scolaire a subi une mutation au lendemain de 1968, à
laquelle j’ai participé activement. Nous voulions équilibrer les
approches externes, biographiques et anecdotiques, par une analyse plus
attentive des œuvres elles-mêmes. FRANÇOIS BÉGAUDEAU : Le professeur de français que je suis réfute le constat que vous faites sur l’enseignement. Nous sommes forcés au pragmatisme, notamment dans les collèges difficiles, et prenons de fait des latitudes par rapport aux instructions officielles qui inciteraient selon vous au formalisme, ce que d’ailleurs je ne crois pas : se demander si Kafka est du registre comique ou tragique est une question qui nous emmène très loin, sur le sens et pas seulement sur la forme. Passer par des procédures d’analyse formelle permet de créer une connexion, y compris avec ceux à qui a priori un texte n’évoque rien. Avec Entre les murs, plutôt que d’élaborer de grandes théories sur l’école, j’ai choisi de me placer dans une salle de classe pour regarder ce qui s’y passe. À chacun d’en déduire ce qu’il veut sur l’état de la société. T.T. : La lecture doit être associée au plaisir, on n’y amènera personne par la contrainte. Elle peut l’être parce qu’il y a une joie à suivre une histoire, à imaginer des êtres autres que soi, à saisir le sens et à découvrir la beauté. F.B. : Un prof de français ne rêve que d’une chose : que les élèves prennent du plaisir à lire les textes qu’il leur propose, or on se retrouve avec 80 % d’élèves pour qui a priori ce plaisir ne va pas de soi. Le décret du plaisir peut même être d’une grande violence, et créer de la discrimination en mettant certains élèves au ban de cette communauté littéraire. À partir de là, nous avons à inventer des approches pour aller à ce plaisir, et l’étude formaliste en est une parmi mille autres. La Croix 10/01/07 |
|
Quelle littérature pour l'école ? |
Extraits Marc Fumaroli. - J'ai été chargé par Gilles de Robien de présider une commission de réflexion* sur le minimum de « culture humaniste » qu'il est souhaitable de rétablir dans l'enseignement primaire et au collège. Sur quelles œuvres littéraires les maîtres peuvent-ils étayer l'enseignement du bien-lire, du bien-dire, du bien-écrire ? Que doit connaître un élève de troisième de l'histoire littéraire et de l'histoire de l'art, mais encore du chant, du dessin, des sciences naturelles ? Les programmes actuels sont interminables, étouffants, écrits dans le jargon concocté dans les IUFM (instituts universitaires de formation des maîtres), ils noient l'essentiel dans la routine. Notre tâche est de ramener les instructions à la clarté et à la simplicité - sans perdre de vue l'éducation du jugement. Chacun le sait, l'école n'a plus la même situation dans la société actuelle qu'il y a un demi-siècle. Aujourd'hui enfants et adolescents sont d'avance « éduqués » (ou « déséduqués » ?), en dehors de l'école, par les moyens de communication dont ils sont les consommateurs privilégiés. L'école est tenue de refaire ce qui a été défait par ce bain d'images et de bruits. Elle doit relativiser les idoles, construire l'attention, la concentration, la mémoire, la considération d'autrui. Il faut doter l'élève de cette arrière-boutique - au sens de Montaigne - où il puisse prendre du recul à l'égard de la grande machine à émotions préfabriquées, tsunamis compassionnels et téléthons politiques ! L'enseignement public français a beaucoup souffert des épigones de la linguistique dite scientifique, du structuralisme, de la sémiologie et de la sociologie néomarxiste qui ont colonisé les instances de décision pédagogique. C'est devenu en trois générations un drame national, qui a retenti sur notre langue, sur le sérieux de notre presse et sur la tenue de notre littérature, au moment même où nous passions d'un enseignement pyramidal à un enseignement de masse. La linguistique chassant la grammaire, plusieurs générations de jeunes Français ont été privés du plaisir de l'analyse des textes, de la joie de construire une phrase, un paragraphe, de distinguer un adverbe d'un adjectif... Les grands textes, poèmes et prose, ont été rendus insipides par une prétendue science transcendante qui les met sur le même plan que des comptes de blanchisseuse. Je vois tous les jours d'ex-étudiants qui ne connaissent que deux temps du verbe : le présent et l'imparfait ! T. Todorov La bonne connaissance des classiques chinois n'a pas empêché Mao de devenir l'un des plus grands meurtriers de l'histoire de l'humanité. C'est que les deux activités restaient enfermées dans des compartiments étanches. Faire l'éloge de la littérature ne doit pas conduire à l'esthétisme, ou éviction de l'éthique par l'esthétique. La littérature n'est pas destinée à une tour d'ivoire. Nel Obs 11/01/07
*
Le groupe de travail sur la culture
humaniste sera présidé par
Marc Fumaroli
de l'Académie française. |
|
Programme
indigeste, élèves dégoûtés, niveau scientifique insuffisant... |
Extraits Une fois leur diplôme en poche, de plus en plus de bacheliers [S] votent avec leurs pieds en partant vers d'autres horizons, cursus en commerce, sciences humaines, droit ou encore en Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives). Là où ce gâchis fait encore plus mal, c'est que, dans notre pays mais aussi un peu partout sur la planète, se creuse une pénurie de jeunes professionnels au profil scientifique ou technique. Si le nombre de bacheliers a bien explosé, passant de 60 000 dans les années 1960 à 500 000, celui des bacs S a, lui, tout juste doublé. Il diminue même depuis 1995. Préférant les grandes écoles, médecine ou d'autres filières, ils ne sont plus que 15% à choisir un cursus scientifique à la fac, où, année après année, les bancs se vident inexorablement. Pourquoi, alors, ne formons-nous pas davantage de bacheliers scientifiques ? En raison d'un absurde malthusianisme, d'une obsession de la sélection qui n'est sans doute que le masque de la vertu posé sur une réalité moins reluisante : «Je crois que les classes favorisées veulent des filières d'élite pour leurs enfants et qu'elles se débrouillent toujours pour les fabriquer...», suggère ainsi Pierre Arnoux, professeur à l'université d'Aix-Marseille-I. «La détermination de la série du bac est d'abord commandée par le degré de réussite en mathématiques», constate ainsi un tout récent rapport de l'Inspection générale, qui s'effraie de la possible disparition du bac L faute de candidats. «La série S fonctionne comme une filière de sélection pour l'accès à l'enseignement supérieur... Elle accueille non seulement les meilleurs scientifiques mais aussi les meilleurs littéraires.» Le bac S n'offre plus, selon certains spécialistes, les fondamentaux nécessaires en mathématiques. Nel Obs 11/01/07 |
|
Les violences racistes à l'école ont baissé de 20 % |
Extraits Durant l’année scolaire 2005-2006, les violences des élèves à motivation raciste ont diminué de 20 % par rapport à l’année précédente. Et les actes antisémites ont chuté quant à eux de 40 %. « On assiste depuis quelque temps à un reflux incontestable de ces violences », analyse Mouloud Aounit, président du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap). « Nous accueillons ces chiffres avec prudence mais satisfaction », réagit pour sa part Élisabeth Cohen-Tannoudji, chargée de mission au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). Au début des années 2000, dans un contexte de regain des tensions communautaires, plusieurs essais publiés par des enseignants dénoncent le développement de l’antisémitisme dans les banlieues, et les associations juives critiquent la passivité des pouvoirs publics. « Ces manifestations ont toujours été minoritaires mais les tags antisémites ont totalement disparu », explique Ghislaine Hudson, proviseur. Cela dit, le recul des violences antisémites s’explique aussi par le fait que des familles juives ont fui les établissements publics situés dans les quartiers populaires. L’école est rattrapée par la « ghettoïsation ». La montée des incivilités, du sexisme, la violence au quotidien entre élèves fait dire à beaucoup d’éducateurs que si les dérapages racistes sont mieux maîtrisés, la bataille pour le respect de l’autre ne fait que commencer. La Croix 11/01/07 note d’information 06.30 décembre Les actes de violence recensés dans SIGNA en 2005-2006 (téléchargeable) |
Robien : ''Les écoliers auront trois heures de grammaire''Le ministre signe aujourd'hui une circulaire sur la grammaire dans une école, accompagné de Bernard Pivot. Il assistera aussi à une leçon illustrant la façon dont il entend désormais la voir appliquer dans les écoles
|
Extraits Elle indique que l'« enseignement de la grammaire doit se prolonger par une série d'exercices d'application. C'est par eux que peut être assurée (...) la connaissance des règles que les élèves doivent mémoriser ». La leçon de grammaire doit constituer un « temps pédagogique spécifique » dévolu à l'étude d'un fait de langue particulier. « Il s'agit de travailler systématiquement les notions les plus importantes afin de mettre en place des automatismes. Cela exige une phase d'appropriation et de mémorisation permettant de faire usage d'une notion dans des situations nouvelles. » « Désormais, à l'école, les élèves auront au minimum trois heures hebdomadaires de grammaire et une heure et demie au collège. Elles seront consacrées à l'enseignement de la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe et du vocabulaire. Ce seront des cours bien spécifiques et structurés au sein des heures habituelles consacrées au français. Il faut travailler à une progression rigoureuse des apprentissages. Commencer par la « grammaire de phrase », apprendre ce qu'est un verbe, un complément, un adjectif, avant de les découvrir au hasard des textes. Désormais, il s'agira de repérer les règles et de les apprendre par coeur. Posséder les fondamentaux, c'est une vision d'avenir et non une vision passéiste. Les pédagogistes fumeux, eux, ont en revanche fait prendre beaucoup de retard à beaucoup d'élèves. » de Robien. Le Figaro 11/01/07 Gilles de Robien va à l'école pour promouvoir l'apprentissage de la grammaire AP 11/01/07 Rappel : une circulaire n’a aucune valeur « réglementaire » cf Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires Légifrance 1.3.7 http://www.legifrance.org/html/Guide_legistique/guide_leg.pdf |
Le calcul mental va revenir en force à l'école |
Extraits Après la lecture et la grammaire, le ministre Gilles de Robien s'apprête à réformer, au pas de charge, l'apprentissage des mathématiques. Plus de temps à perdre avant l'élection présidentielle. Gilles de Robien met la gomme avant de rendre son tablier de ministre de l'Éducation. Le B.A-ba obligatoire pour l'apprentissage de la lecture en CP ? C'est une réalité depuis la rentrée. Le grand retour de la leçon de grammaire dès le CE1 ? Il a été présenté avant Noël. Et voilà que déboule, avec la galette des Rois, le renouveau du calcul mental en CM... Ce triptyque de réformes sent bon le tableau noir des années 50 et marque, une fois de plus, la rupture avec le « pédagogisme » des années 70. Succès garanti dans les sondages. [Dans] un rapport* sur l'enseignement des maths en cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) on lit que, globalement, le niveau des élèves est « stable » mais suggère « de commencer systématiquement une séance de mathématiques par un temps de calcul mental ». « Les problèmes » abordés sont « trop complexes ». « On joue à être mathématicien » Les experts suggèrent de « faire une place plus large » aux machines à calculer et aux « outils informatique Ouest-France 10/01/07 Robien veut réhabiliter le calcul mental à l'école Le Figaro 10/01/07Gilles de Robien veut renforcer le calcul mental à l'école Le Monde 11/01/07* Rapport - n° 2006-034 juin 2006 L’enseignement des mathématiques au cycle 3 de l’école primaire (téléchargeable) |
Un nouvel outil pour mesurer les violences scolaires
|
Extraits Gilles de Robien, annonce, lundi dans le Parisien, la création dans les prochaines semaines d’un nouveau logiciel de recensement et de traitement des données sur les violences scolaires. Un outil statistique intitulé Sivis (système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) qui viendra remplacer l’ancien, Signa, en livrant "des analyses plus fines, trimestrielles, établissement par établissement, et au cas par cas", assure le ministre.. Contrairement à Signa qui s’éparpillait "sur 22 rubriques différentes, Sivis se concentrera directement sur l’essentiel. Il comptabilisera évidemment les faits pénalement répréhensibles, mais aussi tous ceux qui entraînent des soins médicaux et psychologiques et toutes les violences qui font d’ordinaire l’objet d’un signalement des chefs d’établissement à leur hiérarchie, c’est-à-dire à l’inspection académique ou au rectorat", [Le ministre tire] la sonnette d'alarme à propos de l'augmentation de 7 % des violences envers les enseignants en 2005-2006 : "Ce n'est pas acceptable. On paie là les dérives soixante-huitardes qui ont mis l'élève-roi au centre du système" Le Figaro 09/01/07 |
|
Des enseignants commentent les reproches sur leur temps de travail. Le sentiment d'être attaqués injustement |
Extraits chez les enseignants. Traditionnellement, ceux-ci sont discrets sur leurs activités privées, craignant d'être désignés comme des cumulards. Bien qu'ils soient fonctionnaires, la loi les y autorise pourtant, à titre dérogatoire. Mais depuis les déclarations de Ségolène Royal, ajoutées aux réformes du ministre Gilles de Robien, les enseignants se sentent injustement attaqués. A l'exception de quelques enseignants à la tête de véritables PME, pour la plupart d'entre eux il s'agit d'appoint à leur salaire, à raison de quelques heures de cours par semaine. Ils ont d'ailleurs lieu le soir, le mercredi ou le samedi. Le temps de travail des enseignants est régi par des règles spécifiques. Un professeur certifié doit dix-huit heures de cours devant les élèves chaque semaine, un agrégé quinze heures leur «temps de service». Il organise le reste de son temps de travail comme il veut. Généralement, il rentre chez lui. C'est aussi une pratique obligée. A la différence de certains pays européens, les établissements en France ne sont pas conçus pour que les enseignants y restent travailler. Libé 08/01/07 Enseigner au noir Libé 08/01/07 |
La double qualification des professeurs se heurte à de fortes réticences syndicales
|
Extraits La bivalence désigne la compétence d'un professeur à enseigner deux matières différentes : un rêve de gestionnaire, mais aussi un moyen, dans les petites classes des collèges, de ménager une transition entre le maître unique de l'école primaire et les onze enseignants différents que découvrent les élèves à l'entrée en sixième. Cette bivalence est inscrite dans quatre mesures, dont une seule, à ce jour, est adoptée : le nouveau cahier des charges des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), qui a fait l'objet d'un arrêté fin décembre 2006, prévoit d'"inciter" les futurs enseignants à passer des "mentions complémentaires" lors du concours du Capes (certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire) en vue d'enseigner une deuxième matière. Le ministère envisage également un décret permettant l'acquisition de mentions complémentaires par la validation des acquis professionnels. Une troisième mesure prévoit l'instauration de Capes bivalents dans des disciplines proches. Une quatrième mesure est dans le projet de décret soumis au Conseil d'Etat : réformant les obligations de service et les décharges horaires, il permettra aux chefs d'établissement d'organiser les services en tenant compte des bivalences. Le principe du volontariat a été affirmé et réaffirmé par le ministère. Mais le ministre a indiqué que les professeurs bivalents bénéficieraient d'une allocation supplémentaire de 1 000 euros. Les enseignants et leurs organisations se répartissent entre ceux qui n'y croient pas du tout et ceux qui n'y croient qu'à demi. Le Monde 07/01/07 En Europe, la polyvalence est la règle Le Monde 07/01/07Robien en quête de profs à deux casquettes Libé 09/01/07 |
|
Il est temps de sortir des clichés misérabilistes qui collent à cette voie de formation et de cesser de valoriser le privé à ses dépens. L'enseignement professionnel public, un atout Denis Baudequin secrétaire général de l'Unsen-CGT, Luc Bérille secrétaire général du SE-Unsa, Jean-Claude Duchamp cosecrétaire national du SNUEP-FSU et Jean-Luc Villeneuve secrétaire général du SGEN-CFDT |
Extraits En contradiction avec les objectifs proclamés par la loi d'orientation, la scolarité, obligatoire jusqu'à 16 ans pour tous, ne le serait plus que jusqu'à 14 ans pour les jeunes en difficulté. Aux jeunes de nos banlieues vivant au jour le jour la relégation sociale, le gouvernement répondait en rétablissant une voie de relégation scolaire abandonnée depuis trente ans. Ajouter la relégation à la relégation était un premier contresens politique et social. Mais c'était commettre un second contresens, éducatif celui-là, que de fixer comme solution pour des jeunes en difficulté scolaire, la voie professionnelle, enfermant un peu plus cette dernière dans un stéréotype dévalorisant. Au flagrant délit de méconnaissance s'est rajoutée une survalorisation de l'apprentissage, dont il faut rappeler qu'il relève à plus de 80 % du secteur privé, promu modèle miracle contre le chômage des jeunes. Le plan Borloo, en fixant à 500 000 l'effectif d'apprentis à atteindre en France, a choisi la concurrence avec l'enseignement professionnel initial. Il est grand temps, là encore, de sortir des stéréotypes souvent misérabilistes qui collent à cette voie de formation initiale [l'enseignement professionnel public]. Depuis près de vingt ans, on y lie formations générale et professionnelle par le biais de l'alternance sous statut scolaire. On y travaille en relation permanente avec les entreprises. On y met en oeuvre des pédagogies ouvertes pour répondre aux besoins des élèves et les motiver. On y pratique des passerelles visant à élargir les parcours scolaires des jeunes. En relation étroite avec les professionnels, on a su y faire évoluer les formations et les diplômes, à commencer par les bacs professionnels qui sont pour beaucoup dans l'accroissement du nombre des diplômés de niveau 4 qu'a connu notre pays. On a su s'y adapter aux nouvelles technologies, y introduire les nouvelles techniques et on y dispose souvent de plateaux techniques performants. Libé 04/01/07 |
|
Pour mettre du neuf dans le système, les enseignants doivent devenir aussi des chercheurs. Idée folle pour réinventer l'école Par Jean-Pierre BENICHOU, Elisabeth BOURGAIN, Henry CHAILLIE, Jean FOUCAMBERT, Bruno MATTEI Tous ont participé à des innovations et des recherches-actions dans le domaine de l'éducation, de la petite enfance à la formation d'adultes |
Extraits La crise des banlieues, mais aussi la vie quotidienne dans les établissements scolaires, et surtout la désaffection de tous pour un savoir devenu utilitaire pour les uns, excluant pour les autres, sont des signaux d'alarme auxquels ne peuvent répondre des annonces aussi démagogiques que dérisoires : restaurer «l'autorité», dénoncer la méthode «globale», dépister les comportements délinquants dès le plus jeune âge, mettre les récalcitrants en apprentissage et au passage supprimer le «collège unique»... Pour faire face aux exigences des temps présents et aux difficultés extrêmes d'enseigner aujourd'hui, il faut redéfinir la fonction et la mission des enseignants. Une opportunité exceptionnelle pourrait le permettre. En effet, d'ici à 2011 et pour le seul second degré, 145 000 professeurs vont entrer dans le métier. Aussi proposons-nous une construction méthodique de ce nouveau contrat, en mettant les enseignants en situation de recherche. Pour ce faire, il faudrait impulser des «recherches-actions» conduites collectivement et ayant pour objet de s'attaquer aux contradictions qui paralysent l'institution, de lutter contre l'exclusion, de (re)donner à tous adultes comme enfants le goût d'apprendre et de s'investir dans la vie collective de l'établissement, du quartier, de la ville. Les formateurs de formateurs, y compris les corps d'inspection et les universitaires, auraient pour mission de s'impliquer dans ces recherches-actions avec leurs étudiants. Des équipes doivent se constituer sur la base d'un «projet pédagogique de recherche», concernant l'ensemble des cycles pour ce qui est du primaire et, pour le collège, d'un ou plusieurs «minicollèges» regroupant une équipe pluridisciplinaire autour de cohortes de 100 élèves. Les projets doivent viser la réussite et la promotion collective de tous les élèves, et non la compétition de chacun contre chacun ; ces équipes doivent avoir la maîtrise de la mise en oeuvre du projet, du recueil des résultats, de leur analyse, avec des chefs d'établissement fédérateurs d'une vraie «communauté éducative» qui intègre les parents, mais aussi les acteurs socioculturels. Libé 29/12/06 |
|
Trois priorités pour sortir de la crise du système éducatif: un projet de société lisible, un aménagement du territoire démocratique et une réforme en profondeur . Après le drame du collège de Meaux Pierre FRACKOWIAK Inspecteur de l'Education nationale, secrétaire à l'éducation de la fédération socialiste du Pas-de-Calais |
Extraits Face au drame, les uns protestent contre l'insuffisance des moyens: postes de surveillants, d'assistants, de conseillers d'éducation, d'aides éducateurs, effectifs trop chargés, etc. Ils sont sans doute raison. Les autres démontrent que les moyens n'ont cessé de croître dans les établissements les plus difficiles. Ils n'ont pas tort. Le drame de Meaux montre les germes d'une société de l'indifférence et de l'individualisme. Les gosses qui n'interviennent pas, qui ne courent pas pour aller chercher l'aide de l'adulte le plus proche sont prêts à se taire et à se détourner quand une personne sera agressée dans le métro ou dans la rue. Les gosses qui se battent avec une violence inouïe parfois déjà dans les cours des écoles maternelles imitent les images qui inondent les écrans de leurs jeux et de leurs téléviseurs. Il faudra du temps, du courage, un peu d'utopie, une véritable mobilisation collective transcendant les alternances politiques pour enrayer la dégradation Le drame de Meaux montre que le zonage qui a pu contribuer un temps à réduire les inégalités est désormais usé. On ajoute des dispositifs aux dispositifs, des instances aux structures, de l'administration partout, des évaluations et des dossiers, des moyens aux moyens, sans améliorer en profondeur la mixité sociale indispensable à l'épanouissement individuel des citoyens et à la qualité de la vie dans la cité. Ainsi si l'on défend, à juste titre dans l'état actuel des choses, le principe de la carte scolaire comme facteur de cohésion sociale, on sait bien que ce principe est trop souvent détourné par ceux qui le peuvent, aggravant du coup les risques d'exclusion et de ghettoïsation, et que la solution ne peut se trouver qu'en dehors du système scolaire, dans des politiques d'aménagement du territoire et de l'habitat . Dans l'immédiat, il ne peut pas être exclu de réduire l'inflation de dispositifs et d'administration de ces dispositifs (ZEP, CEL, Ambition réussite…), voire même de supprimer les ZEP, et d'envisager une nouvelle politique de financement du fonctionnement des établissements scolaires, publics et privés, et sociaux, et une nouvelle politique d'affectation des moyens humains. [La société] ne peut pas aujourd'hui prendre en charge correctement ce que Jacques Delors dans un rapport à l'Unesco définissait comme les quatre piliers de l'école du futur: savoir apprendre, savoir faire, savoir être, savoir vivre ensemble. Le courage politique a manqué jusqu'alors pour s'engager à long terme. Si l'on te touche pas aux programmes, aux missions des enseignants, à la place de l'école et du collège dans la cité, si l'on se contente de ravaler, d'ajuster, de corriger, d'ajouter des évaluations, du soutien, de la remédiation, on se dirige inéluctablement vers de nouvelles déceptions et vers des crises. L'absence de ce sens est un des facteurs majeurs du désintérêt et de la démobilisation des élèves. Les professeurs de l'école fondamentale à construire, de 3 à 16 ans, ne peuvent plus être essentiellement des transmetteurs de savoirs. Ils devront devenir quels que soient leur discipline et leur niveau d'intervention, en même temps, des professeurs d'intelligence, de maîtrise de la langue et de citoyenneté, engagés dans un véritable projet d'établissement. Libé 26/12/06 |
|
«Républicains», disent-ils... Jacques Rancière Philosophe
|
Extraits En vingt ans le discours « républicain », tel que Jean-Claude Milner l'avait résumé en 1984 dans « De l'école », s'est transformé en dénonciation de l'individualisme, de l'abandon de la transmission des valeurs « transcendantes », etc. Les discours progressistes, depuis le XIXe siècle, ont absorbé une bonne part de la pensée contre-révolutionnaire pour laquelle les Lumières, et la Révolution à sa suite, avaient signifié la ruine de toutes les institutions traditionnelles qui encadraient les individus, les formaient et les protégeaient. Cette thématique du « lien social » perdu s'est insinuée au cœur des différents progressismes comme leur doublure secrète. Le marxisme, sans emploi, s'est recyclé en critique morose de l'équivalence entre marchandise et démocratie, et Tocqueville, sacré comme l'anti-Marx, a été ramené à quelques platitudes sur la tyrannie de l'individu démocratique. L'intelligentsia dite républicaine joue sur les deux tableaux. Elle reprend l'hymne aux affiliations collectives, et elle prône l'universalisme des Lumières contre le fanatisme islamique. Finkielkraut expliquait les révoltes des banlieues à la fois comme le résultat de l'endoctrinement religieux et comme le fait de jeunes n'ayant comme idéal que la consommation. Ce qui unit ces jugements contradictoires, c'est un même mépris pour le jeune « sauvage ». Le républicanisme s'est mué en guerre de « civilisation Les « républicains » ont centré le combat laïque sur le voile parce qu'il pouvait fonctionner comme le symbole visible de l'arriération globale d'une civilisation. Ainsi les Lumières devenaient notre patrimoine, et il fallait seulement choisir entre la civilisation ou la barbarie. Mais les Lumières n'appartiennent à personne. Chacun a à en prouver l'exercice dans chaque circonstance, et nul n'en est exempt. Ainsi la défense du droit à la libre expression perd tout sens quand les défenseurs de Robert Redeker refusent que l'on associe à la défense de son droit d'expression le droit de juger ses propos. Nel Obs hebdo 21/12/06 |
|
Comprendre n’est possible que dans la complexité Comment apprendre la grammaire à l’école ?
Marie Serpereau, enseignante en IUFM et responsable nationale du GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle)
|
Extraits Si « réformer l’apprentissage de la grammaire » signifie revenir aux leçons suivies d’exercices, il semble qu’il n’y ait pas de réforme à faire : la majorité des pratiques répondent à ce modèle : on fait encore de la grammaire à la grand-papa, et l’on se lamente du peu d’effet : « Les exercices sont justes, mais après ils n’appliquent pas. » Depuis 2002, avec l’ORL (observation réfléchie de la langue) est proposé un autre modèle d’apprentissage. Introduire un nouveau terme ne suffit pas et nécessite un accompagnement. Réformer l’apprentissage de la grammaire, c’était le but des excellents textes de 2002, mettons-les en oeuvre. La grammaire doit être enseignée de - façon explicite pour que chacun puisse maîtriser les variations langagières et échapper à la manipulation d’une élite. On étudie la physique ou la biologie, la langue aussi doit être un objet d’étude scientifique. La question sous-jacente et cruciale est de savoir ce qu’on entend par « apprendre ». D’un côté, il y a ceux qui souhaitent revenir à une conception nostalgique de l’école où le maître était écouté, imité et où réussir à l’école signifiait répéter, restituer la pensée d’autrui, sans pour autant en percevoir l’intelligence. Dans tous les domaines on a perçu les limites de cette méthode. Elle ne réussissait qu’à mettre à l’écart 60 % de la population qui pensait alors que l’école n’était pas pour elle. Pour les autres la véritable intelligence des choses commençait au lycée, voire à la fac. La plupart de ceux qui pensent ainsi ne sont ni enseignants, ni éducateurs, ni chercheurs. Ce sont eux qui disent qu’il faut faire simple. De l’autre, il y a ceux qui pensent que la démocratisation de l’école est à la fois une exigence éthique de notre société, et qu’elle est possible pour peu qu’on s’adresse à l’intelligence des élèves. Pour peu qu’on ne leur assène pas les règles avant qu’ils aient eu le temps d’interroger la langue. Dans des ZEP où les élèves découvrent les règles de fonctionnement de la langue, en exerçant sur des textes la démarche scientifique faite d’observation et de comparaison, on voit que, s’ils ne sont pas d’abord soumis à l’injonction d’appliquer une règle qu’ils perçoivent comme arbitraire, les élèves sont prêts à utiliser des savoirs qu’ils ont compris. L'Humanité 16/12/06 Retrouver une logique de l’apprentissage A. Bentolila L'Humanité 16/12/06 NB Sur le site de L’Humanité, il y a eu inversion des signatures |
|
Le PS doit prendre clairement position contre les décisions rétrogrades de la droite. Education : du courage! Pierre FRACKOWIAK inspecteur de l'Education nationale, secrétaire à l'éducation de la fédération socialiste du Pas-de-Calais
|
Extraits Gilles de Robien a affirmé, avec l'assurance qu'on lui connaît, qu'aucun ministre, de gauche ou de droite, ne remettrait en cause, au lendemain des élections, les décisions qu'il a prises. Il évoquait sans doute le b.a.-ba, la grammaire (pour laquelle les décisions étaient prises et annoncées avant la publication du rapport Bentolila, qui n'a été commandé que pour les justifier) et probablement, dans la continuité et la cohérence de son action, les projets relatifs au calcul... Pas de réaction à gauche. On a voulu convaincre une opinion mal informée sur ces questions, que tout ce qui se fait à l'école aujourd'hui est mauvais, que les enseignants du premier degré sont coupables, qu'avant c'était mieux, qu'il faut revenir à cet âge d'or de l'école qui n'a pourtant jamais existé et dont la faiblesse des performances au regard des évolutions et des besoins avait justifié un vaste effort de rénovation pédagogique du début des années 70, jusqu'en 2002. On joue sur les cordes sensibles et sur la nostalgie. Sur la polémique récente, à propos du b.a.-ba, aucun des candidats à la candidature du PS ne s'est exprimé. 'en privilégiant la mécanique comme préalable, au détriment du sens, en accréditant l'idée que les méthodes anciennes auraient fait leurs preuves, on se mentirait à soi-même, on sacrifierait la place de l'intelligence et de son développement dans l'apprentissage de la lecture, comme dans tous les apprentissages, l'importance de la fonction émancipatrice de l'école. Le retour à la grammaire de grand-mère epose exactement sur les mêmes fondements que le b.a.-ba, participe à la destruction des programmes de 2002. Ceux-ci n'étaient pas parfaits, mais ils avaient obtenu un large consensus et commençaient seulement à se mettre en place, car il faut du temps pour faire évoluer des pratiques pédagogiques. D'autres questions de fond ne sont pas non plus vraiment traitées à gauche : le problème du collège qui souffre toujours de l'erreur historique d'en avoir fait le «petit lycée» plutôt qu'une partie de l'école fondamentale de 3 à 16 ans ; le problème des pratiques pédagogiques toujours occulté par le développement du cercle macabre «évaluationremédiation», qui ne remet jamais en cause ce qui se passe réellement dans la classe en amont ; le problème des contenus et du sens des programmes scolaires toujours massivement orientés par la sédimentation de connaissances sans se préoccuper du développement de l'intelligence, de l'esprit d'initiative, de la stratégie, de l'apprentissage de la responsabilité et du vivre ensemble ; le problème des missions des profs, avant celle de leurs horaires, de la continuité et de la transversalité des enseignements... Gilles de Robien fait preuve, lui, de courage politique. Il veut le retour à l'école de grand-père. Tout le discours est fondé sur le mot «retour», sur la mythification du passé, sur le conservatisme. Il y parvient, sans grande réaction de la gauche. Libé 13/12/06 |
Éducation : un vrai débat ?Jean-Michel Djian Professeur associé à l'université de Paris VIII |
Extraits Aujourd'hui, la question de la restauration de l'autorité, du respect de la laïcité ou de la maîtrise du langage (pour ne citer que les sujets les plus visibles) vient avant celle des moyens. Du coup, des sujets perçus comme tabous sont mis sur la place publique, avec plus ou moins de bonheur. L'hypocrisie de la carte scolaire ; le retour à des règles simples de respect et de politesse dans les établissements; l'utilité d'impliquer les jeunes du futur service civil dans un soutien scolaire gratuit ; l'impossibilité de passer en sixième si l'élève ne sait pas lire et écrire ; restaurer l'excellence et l'autorité ; faire en sorte que la mission des enseignants soit d'éduquer et pas seulement d'instruire ; organiser une véritable orientation après le bac... La Ligue de l'enseignement ne s'y trompe pas. En lançant, au début de 2007, une campagne nationale sur le thème « Pas d'école, pas d'avenir », ce grand mouvement laïc, représentant quelque deux millions d'adhérents, veut mettre la classe politique devant ses responsabilités. La superposition des réformes, les contradictions et les effets négatifs qu'elles ont engendrés ont dénaturé, en profondeur, l'objet même de la République scolaire. L'OCDE a récemment publié des statistiques très instructives sur l'état de notre système éducatif. Les dépenses consacrées par la France au collège et au lycée sont de 24 % supérieures à la moyenne des trente pays membres de l'organisation ; la charge horaire des élèves est largement supérieure aux autres États sans qu'elle ne produise pour autant de meilleurs résultats. Ouest-France 13/12/06 |
|
Depuis la rentrée, les professeurs sont censés évaluer le comportement des collégiens. Tohu-bahut contre la «note de vie scolaire» Libé 07/12/06
|
Extraits L'une des nouveautés de la rentrée se met en place dans la cacophonie. Officiellement tout se passe bien. «J'attends avec impatience les résultats d'un rapport de l'inspection générale début 2007 mais je peux vous dire dès à présent que les retours sont très positifs», assurait mardi le ministre de l'Education, Gilles de Robien. En réalité, cette note pose problème, notamment dans les quartiers défavorisés où l'on se refuse à instaurer ce qui ressemble à une «double peine», en sanctionnant des élèves difficiles déjà punis par des avertissements ou des heures de colle. Dès le début, le projet a suscité des réserves : précipité, trop flou sur les critères de notation, davantage un affichage qu'une réforme de fond. Consulté en mars, le Conseil supérieur de l'éducation (représentant les acteurs de l'enseignement) a rendu un avis négatif. Le principal syndicat enseignant du secondaire, le Snes, ainsi que la première fédération de parents d'élèves, la FCPE, réclament son abandon. [La] PEEP, qui réclame un bilan dans un an, se demande comment noter l'engagement civique : «L'assiduité et le respect du règlement intérieur vont de soi et ne sont pas négociables.» La Société des agrégés est outrée que cette note compte pour le brevet, diplôme qui sanctionne des connaissances. Même reproche du syndicat de l'enseignement privé CFE-CGC, qui juge le brevet «dévoyé» et lance : «A quand la prime de bonne bouille ?» Libé 07/12/06 Gilles de Robien assure que la note de vie scolaire se met "bien" en place AP 06/12/06 La polémique enfle autour de la note de vie scolaire dans les collèges Le Figaro 07/12/06Chahut autour de la note de vie scolaire Ouest-France 18/12/06 |
|
Le soutien aux élèves en difficulté ne relève pas d'une réforme simpliste. Le «bon sens», mauvais conseiller d'éducation Jean-Michel Zakhartchouk enseignant de collège en ZEP, animateur d'une association bénévole d'aide aux devoirs, rédacteur aux Cahiers pédagogiques. Dernier ouvrage paru : Enseigner, un métier à réinventer, éd. Yves Michel, 2002. |
Extraits Le ministre Robien, une fois de plus, lors de la remise du rapport d'Alain Bentolila sur l'enseignement de la grammaire, exalte le «bon sens» qu'on aurait oublié et oppose à la prétention des experts une sagesse éternelle, à coups de proverbes tels que «Ne pas mettre la charrue avant les boeufs». Il se gausse au passage de notions comme «l'observation réfléchie de la langue» qui sont pourtant dans les textes officiels, signés par ses prédécesseurs et non des élucubrations de «pédagogistes» . On est en fait en pleine idéologie, sous couvert du fameux «bon sens». A l'époque de Copernic auquel le début du rapport Bentolila fait allusion , le bon sens trouvait absurde de penser que le soleil ne bouge pas. L'observation réfléchie des planètes était-elle une élucubration ? il est bien plus difficile de penser la complexité et de trouver des solutions que de chercher des boucs émissaires et de se réfugier dans les «yaka». Exemple, le soutien scolaire et la politique en faveur des élèves les plus en difficulté Nicolas Sarkozy, en particulier, dans son récent discours d'Angers en fait une espèce de panacée. On pourra développer une conception très libérale de l'école (choix des établissements, homogénéisation des classes) parce que, en contrepartie, nous dit-il en substance, il y aura un développement important des études du soir, assurées par des enseignants voulant gagner plus d'argent. Or un tel système ne pourra améliorer qu'à la marge la situation actuelle, alors que la ségrégation accrue de par la suppression de la carte scolaire sera, elle, nettement néfaste aux plus faibles. Ce fameux «soutien» est souvent inefficace s'il est complètement coupé du travail en classe, d'où la nécessité du travail d'équipe, lequel est contradictoire avec une vision individualiste et marchande du métier d'enseignant. Aider un élève en difficulté est difficile, contrairement à ce que prétend le «bon sens». Tout cela demande du professionnalisme, de la patience, mais aussi de l'enthousiasme et une passion qui font et devraient faire la noblesse du métier d'enseignant. Il serait bon que ceux qui s'opposent aux projets d'école libérale et rétrograde sortent, eux aussi, d'une logique quantitative et des idées simples. Seule une mobilisation collective des acteurs de l'école, au nom d'idéaux que nombre d'entre eux partagent sincèrement, peut permettre la «réussite de tous», à condition de viser des objectifs réalistes, progressifs, en évitant les déclarations à l'emporte-pièce comme «faire qu'en trois ans il n'y ait plus de difficultés en lecture», etc. Libé 06/12/06 |
|
Oui, les enseignants doivent travailler collectivement à l'élaboration de démarches pédagogiques. Plus longtemps ensemble à l'école Nestor Romero ancien enseignant. Auteur de : l'Ecole des riches, l'école des pauvres, éd. Syros, 2001
|
Extraits Bien sûr que les professeurs devraient passer plus de temps dans leur établissement ! Non pas pour y corriger leurs copies, mais pour y travailler ensemble à mettre en oeuvre des démarches pédagogiques cohérentes à l'intention des enfants les plus démunis, les plus éperdus ! Ou alors, s'ils ne le font pas, qu'ils ne parlent plus d'égalité, de démocratie, de la même école pour tous, et qu'ils ne se plaignent pas ! Qu'ils continuent à compter leur quinze ou dix-huit heures d'ennui, selon le modèle du quatre-quarts (une classe, une matière, une heure, un professeur) dans le cadre duquel ils ne veulent (ne savent, trop souvent) développer d'autre démarche que celle de l'antédiluvien «je parle, tu écoutes!». En 1983 le rapport de Louis Legrand proposait, entre autres mesures, le travail collectif des enseignants de collège. Ce fut un tollé et, comme d'habitude, la plupart des syndicats brandirent l'étendard effiloché des «moyens». Ce qui permit aux prétendus républicains ralliés à Jean-Pierre Chevènement de prendre les choses en main : ils décidèrent de faire chanter la Marseillaise aux gamins. Las, ils ne parvinrent même pas à les mettre en rang ! Il est urgent que le caractère collectif de la fonction enseignante soit affirmé par la loi, car ce mode d'intervention est la condition, non pas suffisante, mais absolument nécessaire, d'une véritable démocratisation de l'école. Démocratisation dont ne veulent pas certains «instructeurs» qui se disent républicains, sauveurs des belles lettres et du b.a.-ba, mais dont je sais bien que d'autres sont prêts à y travailler... collectivement. Libé 06/12/06 |
Education : Robien règle ses comptes avec les candidats à la présidentielle |
Extraits "Je voudrais remettre un peu d'ordre dans ce débat, de l'ordre juste bien sûr, en rappelant quelques vérités de bon sens", a déclaré Gilles de Robien
Sans les nommer, il a cité les récentes déclarations en matière
d'éducation des trois candidats déclarés: la socialiste Ségolène Royal,
le président de l'UMP Nicolas Sarkozy et le centriste François Bayrou
(UDF).
|
Snes et FCPE : Robien "doit renoncer à la note de vie scolaire"
|
Extraits La note de vie scolaire, prévue dans la loi Fillon sur l'Ecole, "mesure l'assiduité de l'élève, son respect du règlement intérieur" et "prend en compte sa participation à la vie de l'établissement", selon un décret du 12 mai 2006."A l'approche des premiers conseils de classe, la confusion règne dans les collèges au sujet de la note de vie scolaire", selon le communiqué.
"Elle ne peut que s'avérer inefficace pour les élèves les plus en
difficulté sur le plan du comportement. Son caractère subjectif risque
même de générer dans les collèges des tensions supplémentaires entre les
élèves, les enseignants et les familles", ajoutent les deux
organisations.
|
Le projet musclé de Sarkozy pour l'écoleÀ Angers, le président de l'UMP a planté des jalons pour « faire du progrès scolaire le moteur du progrès social »
|
Extraits Nicolas Sarkozy s'est dit décidé, devant 5 500 personnes, à assigner un « devoir de réussite » à l'école. Le président de l'UMP a déclaré vouloir faire de l'école, « un lieu de protection, de sécurité et de respect ». « À nous d'agir pour que le progrès scolaire redevienne le moteur du progrès social », a déclaré le président de l'UMP. Il a sonné l'heure pour la droite « d'assumer son ambition » en matière d'éducation : « On ne peut plus longtemps abandonner l'éducation à ceux qui en font le terrain de jeu de leurs idéologies dépassées. »
Sarkozy propose "un nouvel avenir pour l'école de la République" AFP 01/12/06Sarkozy lance sa campagne sous le signe de l'éducation AP 01/12/06 Les principales propositions de Sarkozy sur l'éducation AP 01/12/06 Sarkozy prend position contre le port du string à l'école AP 01/12/06 Nicolas Sarkozy voit l'école comme une arme anti-communautarisme Reuters 01/12/06 |
||||||||
|
La grammaire, nouvel attribut pour Robien Comme le préconise le rapport Bentolila remis hier, le ministre de l'Education veut rétablir la leçon de grammaire dès la rentrée 2007 |
Extraits A peine la polémique sur la lecture retombée, Gilles de Robien enchaîne avec la grammaire, avant de s'attaquer bientôt au calcul mental. Marginalisé au sein de son parti, l'UDF, le ministre entend bien marquer son ère à la tête de l'Education. Pour cela, il s'emploie à séduire les parents en les rassurant sur la baisse, réelle ou supposée, du niveau scolaire, et parodie Ségolène Royal, promettant un «ordre juste» qui passerait, lui, par la grammaire. Gilles de Robien emploie ainsi un vocabulaire paternaliste et consensuel qui tranche avec les dérives des «pédagogistes» et leur jargon «ésotérique». «On n'apprend pas sans effort», rappelle le docte ministre, sûr ici de faire l'unanimité. Comme pour la lecture, poursuit-il, «il faut partir du plus simple pour aller au plus complexe». Ce que contestent les pédagogues, pour qui la démarche inverse est plus logique. En prônant haut et fort le retour au b.a.-ba en début de CP, il avait heurté de front les enseignants. Il s'était targué du soutien de nombreux scientifiques, qui, soucieux de ne pas être instrumentalisés, avaient pris leurs distances les uns après les autres. Pour la grammaire, il a fait appel à un chercheur reconnu. Libé 30/11/06 Un rapport prône plus de simplicité et de vrais cours de grammaire en classe AFP 29/11/06 La grammaire devrait bientôt devenir "une chanson douce" à l'école AFP 29/11/06 Enseignement de la grammaire: plus de simplicité et plus de rigueur AP 29/11/06 Mais où est donc la grammaire ? L'Humanité 30/11/06 La Peep satisfaite du retour de "la leçon de grammaire" à l'école AFP 02/12/06 RAPPORT DE MISSION SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE Alain BENTOLILA, Linguiste (téléchargeable) Remise du rapport sur la grammaire du Professeur Bentolila Discours - Gilles de Robien 29/11/2006 |
||||||||
Après la lecture, Gilles de Robien s'attaque à l'enseignement de la grammaire
|
Extraits Gilles de Robien indique, dans un entretien publié le 29 novembre dans Le Parisien/Aujourd'hui en France, que pour lui,"il suffit de lire un manuel de français pour s'apercevoir que ce que l'on demande aux élèves, notamment en primaire, est inutilement jargonnant et complexe... en tout cas incompréhensible. Si l'on veut vraiment noyer les élèves, continuons ainsi !". Pour lui,"comme la lecture ou l'écriture, la grammaire fait partie des savoirs de base. Elle structure l'esprit, donne une logique". "Mais même si certains la jugent rébarbative, c'est une étape obligée, comme le solfège pour la musique. C'est comme cela que l'on suscitera chez les enfants les plaisirs de la langue et la capacité de produire des phrases. Je ne suis pas un nostalgique de l'école d'autrefois, mais il y a des recettes de bon sens éternelles qu'on a peut-être un peu oubliées ces derniers temps." Alain Bentolila devait remettre ce matin au ministre un rapport sur l'enseignement de la grammaire, dans lequel ce spécialiste réputé prône un enseignement de la grammaire simplifié, sans pour autant "revenir à la grammaire de papa". Roland Goigoux – qui avait vu son cours un temps supprimé après avoir défendu des positions opposées aux orientations ministérielles au sujet de l'apprentissage de la lecture –, il y a déjà "beaucoup de leçons de grammaire à l'école". "Je ne suis pas sûr que cet enseignement soit si sinistré" Le Monde 29/11/06 |
||||||||
|
Les violences scolaires ne sont plus recensées
|
Extraits La publication d’un classement des lycées et collèges « les plus dangereux » de France dans le magazine Le Point du 31 août a fait une victime : le logiciel informatique Signa. Chaque année, le ministère publiait un état statistique anonyme (sans citer les établissements) de la violence scolaire. On imagine le choc provoqué par la publication du palmarès… Depuis lors, la plupart des chefs d’établissement ne transmettent plus au ministère les fiches de signalement administratives. Ce système, basé sur la déclaration des chefs d’établissement, laissait une place importante à l’appréciation subjective de la gravité des faits. Les défauts de Signa ont été identifiés : une nomenclature complexe et la difficulté de cerner la notion de « violence », compte tenu des différents degrés de gravité des faits répertoriés. Il paraît en effet peu pertinent de classer dans la même rubrique des incidents aussi divers que le déclenchement d’une alarme, le trafic de stupéfiants et une agression avec arme.
L’universitaire
Sébastian Roché propose de distinguer dorénavant les deux approches : «
Il faut d’une part donner un outil de recensement très simple à chaque
chef d’établissement, car ce qui l’intéresse n’est pas d’être comparé
aux autres mais de mesurer l’évolution de la situation chez lui. » |
La grammaire, nouveau chantier de Gilles de Robien |
Extraits M. Bentolila, professeur à l'université Paris-V et membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de la lecture (ONL), s'est assuré la collaboration de l'académicien Erik Orsenna, président de l'ONL, et de Dominique Desmarchelier, linguiste à Paris-V et spécialiste en terminologie grammaticale. "L'enseignement de la grammaire fait partie intégrante de l'apprentissage de la lecture." Autrement dit, le b. a.-ba ne saurait être le seul objectif du cours préparatoire. "Identifier les mots n'est pas suffisant, explique Alain Bentolila. Il faut aussi savoir leur rôle dans la phrase, savoir les mettre en relation, donc acquérir, dès le début, des notions de syntaxe", grâce à des mots-outils (articles, prépositions...). Un deuxième principe affirme que la "leçon de grammaire" - qu'il entend réhabiliter - doit laisser "toute sa place à l'observation, la manipulation et la réflexion", dans l'esprit de l'ancienne "leçon de choses". Elle ne doit donc pas consister à réciter des règles mais à fabriquer des phrases, en acceptant que l'élève tâtonne, qu'il formule des hypothèses, voire qu'il s'arrête sur des conclusions provisoires. M. Bentolila s'oppose à l'idée que la grammaire soit abordée au fil des textes plutôt que par des leçons spécifiques. Mais il concède qu'un enseignant puisse "choisir un matériau ad hoc", comme des énoncés simples surgis de la vie de la classe ("Kevin a pêché un poisson."). Il admet également qu'à l'occasion de la lecture d'un texte des "arrêts sur phrase" viennent "éclairer la compréhension". D'une façon générale, explique-t-il, "la progression ne saurait être liée à la rencontre aléatoire des textes, elle doit obéir à la logique interne du système grammatical". Le linguiste privilégie la "grammaire de phrase" - qui analyse la nature et la fonction des mots à l'intérieur de la phrase et qui est la plus proche de ce que la plupart connaissent -, contre la "grammaire de texte" - analyse de la cohérence thématique et sémantique du texte. Le Monde 24/11/06 Les programmes de grammaire au pilori Le Figaro 25/11/06Gilles de Robien veut rétablir des cours de grammaire à part entière AFP 28/11/06Gilles de Robien veut "rétablir" en cours une grammaire simple et sans jargon AP 28/11/06 La grammaire à l'école Nel Obs 29/11/06 |
|
La note de vie scolaire suscite des inquiétudes syndicales |
Extraits Les deux principales fédérations de parents d'élèves, la Peep et la FCPE appellent à la vigilance, à l'approche des premiers conseils de classe au collège, lors desquels les élèves se verront attribuer leur nouvelle note de vie scolaire. Les syndicats d'enseignants et de proviseurs se disent également « très embarrassés » par la mise en place de cette évaluation. cette note est censée mesurer l'assiduité du collégien et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle doit prendre aussi en compte sa participation à la vie de l'établissement. Les fédérations de parents d'élèves critiquent le flou qui règne, selon eux, autour de cette note. Elle présente « un risque de double peine, de confusion entre sanction du comportement et évaluation des acquis, de notation arbitraire », estime la FCPE. L'autre grande fédération de parents, la Peep, craint que cette note soit attribuée « sur des critères aléatoires ». Le Figaro 22/11/06 La discipline, nouvelle matière ? L'Humanité 22/11/06 Robien: la mise en place de la note de vie scolaire "se passe très bien" AFP 23/11/06 |
|
N'en déplaise à Monsieur Sarkozy, faire découvrir la littérature aux jeunes est une des missions de l'école. La Princesse de Clèves au Kärcher Christine Lapostolle écrivain et enseignante |
Extraits «[Nicolas Sarkozy] Meeting de Lyon. 23 février 2006. La princesse de Clèves ! Voilà ce que donne l'Education nationale pour épreuve d'examen ! Etonnez-vous que ça aille si mal. Si c'est ce qu'on enseigne à nos enfants.» Ces propos, peut-être déformés, sont plausibles. On peut se représenter le raisonnement qui les sous-tend : qu'est-ce que les jeunes (sous-entendu à plus forte raison des banlieues) peuvent comprendre à cette vieille élucubration XVIIe ? Quel intérêt y a-t-il à leur faire connaître un tel roman ? A quoi cela servira-il sur le marché du travail ? Les gens, qui vivent avec au coeur de leur existence des livres, des oeuvres d'art, des choses produites par l'imaginaire de leurs prédécesseurs, que ce soit hier ou il y a 5 000 ans, ont la tâche de servir pour d'autres de passeurs, vers ces textes ces musiques, ces tableaux qui font vivre. C'est une des tâches de l'école, ce n'est pas la seule, elle n'incombe pas qu'à l'école. Mais beaucoup d'adolescents n'entendront jamais parler de la Princesse de Clèves, de Rastignac ou de littérature si on ne leur en parle pas à l'école. Alors aujourd'hui, remettre en question l'intérêt d'enseigner Shakespeare ou la Princesse de Clèves à la jeunesse française, c'est-à-dire maghrébine, turque, portugaise, thaïlandaise, une offense pour l'humain, un renoncement grave. Si de telles oeuvres sont l'émanation de la culture occidentale dans ce qu'elle a de plus français ou anglais ou latin ou germanique ou polonais, ou portugais, nous sommes chargés de les faire découvrir à ceux qui vivent parmi ces Européens si empreints eux-mêmes des valeurs occidentales. Comment se comprendre autrement ? Et à ceux dont les parents ou les grands-parents sont nés au loin et qui sont là, dans les mêmes écoles que les petits Français en France, Anglais en Angleterre etc., nous devons la réciproque, apprendre avec des enseignants de culture arabe, ou chinoise, ou togolaise, les choses spirituelles, sensibles, visuelles, qui viennent de leur culture. «Citoyen spirituel de l'univers» écrivait Baudelaire en 1860. Libé 21/11/06 |
|
Le Haut comité éducation-emploi présente ses idées pour arriver à 50% de diplômés
|
Extraits Le HCEEE, créé en 2000, présente lundi au ministère de l'Enseignement supérieur son rapport, qui rappelle que "plus de 80.000 jeunes sortent chaque année de l'enseignement supérieur sans avoir obtenu de diplôme, soit 10% d'une génération". La loi sur l'école de 2005 ayant fixé comme objectif 50% d'une génération diplômée de l'enseignement supérieur, le rapport formule plusieurs propositions. Le HCEEE préconise d'améliorer "l'articulation entre l'enseignement secondaire et supérieur" à travers des horaires de "découverte professionnelle" pour les lycéens, en intégrant également à la formation et aux horaires des ensignants "une meilleure connaissance de l'entreprise et du monde économique". Il propose aussi "d'encourager le tutorat d'élèves volontaires par des étudiants avancés issus de filières de formation attractives pour ces élèves". Afin de diminuer les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur, le rapport conseille de faire "systématiquement" après le premier semestre un "bilan du choix d'orientation des bacheliers", en leur donnant les moyens d'une "réelle réorientation" vers toutes les filières sans exclusive. Il convient aussi d'améliorer "les conditions de l'insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail" en développant la formation aux "techniques de recherche d'emploi, d'élaboration de CV", qui pourrait faire l'objet d'unités de valeur. AFP 20/11/06 |
|
Vous avez le pouvoir d'arrêter ce mouvement d'ethnicisation qui gangrène la République. Lettre à un jeune Maghrébin Philippe Meirieu professeur à l'université Lumière- Lyon-II |
Extraits L'opinion publique désigne sous l'expression générique de «jeunes Maghrébins» des enfants issus aussi bien du Maghreb que d'Afrique noire, de Turquie ou du Moyen-Orient. Et, dans un amalgame invraisemblable au nom d'une conception bien-pensante de la laïcité et de l'ordre public, fait d'eux les boucs émissaires de tous nos maux... C'est qu'en réalité le «jeune Maghrébin» est devenu un mythe : il incarne le nouveau barbare... y compris pour ceux et celles qui n'en rencontrent jamais le moindre spécimen. Vous faites peur et rien n'est pire que cette peur. Elle justifie les propositions politiques les plus extravagantes sur lesquelles beaucoup de nos compatriotes perdent tout esprit critique : étiquetage précoce des enfants qu'on condamne ainsi à devenir ce qu'on voudrait éviter ; sanction des parents les plus fragiles au prétexte qu'ils seraient démissionnaires ; punition réduite à l'emprisonnement criminogène ; confusion entre fermeté envers les coupables et humiliation des vaincus. Je crois que vous avez, plus que jamais, votre destin entre vos mains. Que quelques-uns d'entre vous s'enferrent dans une surenchère de provocations, que les banlieues s'enflamment, même fugacement, que des services publics soient à nouveau pris pour cibles, et nous verrons triompher une terrible politique de ségrégation. Notre pays tournera le dos à la véritable solidarité, qui, en donnant enfin plus et mieux à ceux qui ont moins, peut seule nous sortir de la crise et de la désespérance. Je suis convaincu qu'il faut lutter d'arrache-pied contre toutes les injustices qui vous poussent parfois dans des comportements de desperados. Mais il faut, en même temps, interpeller vigoureusement votre liberté. Ce qui est, finalement, la seule manière de la faire advenir. Vous avez le pouvoir : exercez-le. Vous avez le pouvoir d'arrêter ce mouvement d'ethnicisation des problèmes sociaux qui gangrène dangereusement la République. N'écoutez pas ceux qui me traiteront de «belle âme» et moqueront mon «angélisme». Ce sont les mêmes qui vous condamnent à l'échec. D'autres, autour de vous, croient encore à l'éducation : parmi vos parents, vos éducateurs, vos professeurs, mais aussi dans la police et la justice, chez les élus et tous les citoyens... Libé 16/11/06 |
|
La socialiste a raison de poser la question du temps de présence des professeurs dans les établissements. Enseignants : le courage de Ségolène Royal Gabriel Cohn-Bendit ancien enseignant, militant de l'éducation |
Extraits Il y a plus d'un an, le Parti socialiste, m'avait invité à un débat sur l'école. J'avais commencé mon intervention en disant : «En parodiant la formule entre boire ou conduire, il faut choisir, je dirais : entre poser les problèmes de l'école et garder l'électorat enseignant, il faut choisir. Ou le PS veut garder son électorat enseignant, et il ne posera pas les problèmes de l'école, ou il les pose et risque de perdre une partie de son électorat enseignant.» Sur le fond, je dirais donc : premièrement, que le temps de travail des enseignants du secondaire, collèges et lycées, est bien calculé sur la base de 36 heures. Les certifiés font 18 heures de cours qui sont évaluées à deux heures de travail en tenant compte des préparations et des corrections. Deuxièmement, qu'il y a longtemps que des pédagogues et certains syndicalistes, dont ceux du SGEN, proposent des changements en diminuant les heures de cours, les ramener de 18 à 15 par exemple, et d'augmenter par contre les heures de présence. Le 27 février 1996, nous avons signé à plusieurs, Antoine Prost, Louis Legrand, Jean-Claude Guérin, Marie Danièle Pierrelée, entre autres, un Rebond, toujours dans Libération, intitulé «Des équipes pour travailler autrement», où nous disions déjà : «Le service des enseignants, traditionnellement compté en heures de cours, sera forcément à redéfinir ; on comprendra donc aisément qu'on ne peut faire partie d'équipes ayant de tels objectifs que sur la base du volontariat.» Oui, c'est bien sûr la base du volontariat et non en imposant à tous les enseignants des changements qu'ils n'acceptent pas qu'il faudra commencer. Faire la preuve qu'une présence plus importante peut réduire les tensions et donc rendre le travail des enseignants plus agréable donc moins fatigant et stressant. Rappelons qu'en Allemagne, les enseignants doivent 25 heures de cours et en Suède ils doivent 35 heures de présence dont 20 à 22 heures de cours et ce pays a, avec la Finlande, les taux de réussite les meilleurs. Libé 15/11/06 Présence des profs : ce que font nos voisins Ouest-France 15/11/06 |
|
Violences, échecs... La remise en cause du fonctionnement du système scolaire est absente de la campagne du Parti socialiste. L'éducation, une matière pas au programme Suzanne Citron historienne |
Extraits L'émiettement et la spécialisation des connaissances, les horaires mal fichus et surchargés, inquiètent de nombreux parents étrangers au monde des cités, qui, face à la démotivation de leur enfant, se battent pour qu'il «tienne le coup». Que dire alors des jeunes dont les parents n'ont pas les outils pour les soutenir et les aider ? En France, le système centralisé et uniformisateur, hérité des lycées napoléoniens, balisé par des corporatismes, s'est monstrueusement gonflé de rajouts sans être restructuré. D'où, dans les collèges surtout, un empilement de matières obligatoires, plus nombreuses que dans la plupart des autres pays européens. L'éducation, affirme-t-on à gauche, doit être au centre de la future campagne présidentielle. Le «petit Livre rouge du PS», dont les suggestions, à côté de la rituelle augmentation des moyens, concernent le nombre d'élèves par classe, le soutien scolaire, reste muet sur les contenus et les programmes. L'absence de réflexion sur les interactions entre la crise sociale et la crise scolaire y est flagrante. Crainte des réflexes défensifs du milieu enseignant et surtout de ses représentants ? L'invraisemblable enveloppe jargonnante des programmes de français, qui détourne les élèves du vrai plaisir de la lecture, vient pourtant d'être dénoncée dans le consensus. Un débat plus large, sans tabou, mené avec intelligence et sérénité, fondé sur l'analyse des racines historiques de notre système scolaire, de ses contenus, des modalités de leur transmission, devrait être possible, tant la crise est grave. Libé 13/11/06 |
Scolarité : l'avenir des enfants se joue avant 6 ansSelon l'Insee, les élèves entrent au CP avec des niveaux de connaissance déjà très différents. L'école ne parvient pas à réduire l'écart.
|
Extraits Premier constat : les dés sont jetés très tôt. Les écarts de connaissances des enfants qui entrent en CP sont déjà très marqués par leur milieu familial, les diplômes de leurs parents (celui de la mère notamment est très important) et leur niveau culturel. Ce qui n'est pas franchement une découverte est désormais étayé chaque année par les évaluations nationales menées lors de l'entrée en CP. Un élève qui fait partie des 10 % d'écoliers les plus faibles au CP n'a qu'une chance sur trois d'arriver en sixième sans redoubler. Les différences se creusent, toujours selon le milieu social, de 10 % par an, entre le CP et la sixième, autre année scolaire où les aptitudes en français et en mathématiques de tous les collégiens sont passées au scalpel. Cette première année de collège, seuls 24 % des enfants d'ouvriers l'atteignent sans avoir redoublé contre 65 % d'enfants de cadres, de chefs d'entreprise ou d'enseignants. Faut-il alors faire entrer plus tôt à l'école les enfants de milieux défavorisés ? Pas sûr, observent les statisticiens pour qui « à long terme, les élèves entrés en maternelle à deux ans ont des résultats peu différents des autres ». Peut-être faut-il faire redoubler les plus fragiles pour mieux les encadrer ? Pas le moins du monde, tranchent encore les chercheurs. « Car, écrivent-ils, dans la majorité des cas, le redoublement ne permet pas un rétablissement suffisant. » Autrement dit, à brève échéance, les élèves replongent. Les enseignants ont dû en prendre conscience car cette pratique diminue. En vingt ans, la proportion d'élèves qui ont redoublé à l'école primaire a été divisée par deux. Le Figaro 09/11/06 La réussite scolaire se joue sur les acquis de maternelle (enquête Insee) AFP 09/11/06 Pour faire une bonne scolarité, mieux vaut avoir réussi... sa maternelle Libé 09/11/06 À l'école, l'essentiel se joue avant six ans Ouest-France 21/11/06 |
Vers un Etat-providence centré sur l'enfanceGosta Esping-Andersen sociologue |
Extraits Le credo de la droite se heurte à un dilemme majeur si les chances des individus dépendent systématiquement de leurs origines sociales. La question de l'héritage social pose un problème tout aussi sérieux à la tradition sociale-démocrate, principalement parce qu'elle fait obstacle à la réalisation de la promesse d'égalité. Comment expliquer la rigidité des héritages sociaux dans les sociétés développées ? Tout d'abord, nous savons que les mécanismes se mettent en place dans les premières années de l'enfance. Et comme les évolutions futures dépendent largement des expériences faites au cours des premières années de la vie, il est également clair que les remèdes sociaux mis en œuvre plus tardivement, comme l'enseignement pour adultes, les remises à niveau, les politiques actives du marché du travail, deviennent inefficaces. Phénomène avéré, la pauvreté pendant l'enfance a des effets très négatifs à long terme. La recherche américaine montre, par exemple, qu'un enfant grandissant dans un univers de pauvreté aura, en moyenne, deux années de scolarisation en moins que celui qui n'a jamais connu la pauvreté. A l'âge adulte, il gagnera 30 % de moins, en moyenne, que les autres. Et pire que tout, la probabilité qu'il devienne lui aussi un parent pauvre est très élevée. Plus encore que les ressources c'est le niveau de connaissance de la famille qui compte. Mon analyse de l'enquête internationale PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves dans les pays de l'OCDE) montre que le "capital culturel" des familles pèse deux fois plus dans l'acquisition de la lecture que les revenus. Il existe des solutions très efficaces pour égaliser le développement intellectuel. Il s'agit du développement des crèches et autres formes de gardes d'enfants, qui permettent accessoirement de réconcilier vie familiale et carrière professionnelle. S'il s'agit d'appartenir à une économie du savoir compétitive, il faut maximiser le capital-savoir. En France, 20 % des élèves quittent actuellement le système scolaire prématurément, 7 % n'ont même pas le niveau de connaissances minimum. En d'autres termes, c'est un groupe qui restera sur le carreau dans la société de demain. Le Monde 08/11/06 |
|
Ancré dans notre imaginaire politique, ce concept pervers bloque toute réforme scolaire ou sociétale. L'imposture de l'égalité des chances Bruno Mattéi, philosophe |
Extraits «l'égalité des chances», grande attraction idéologique, [est] aujourd'hui quasiment érigée en cause nationale. dans le domaine de l'éducation c'est en son nom qu'on entend démocratiser l'école depuis les années 60. Ladite égalité des chances n'est en réalité qu'un pseudo-concept, véritable obstacle épistémologique et politique à tout ce qui s'avance comme réformes, voire refondation du système scolaire et sociétal. Le concept d'égalité renvoie, lui à l'effectivité de droits, les mêmes pour tous, tandis que celui de chance se meut dans une logique contraire de l'aléatoire et des probabilités. Les dommages collatéraux de l'égalité des chances (l'échec des plus vulnérables, antichambre de leur exclusion, la violence scolaire grandissante et la désertion accrue du sens de l'école) devraient au moins donner lieu à quelques interrogations, sinon à une drastique prise de conscience et catharsis collective. Car le vieux mythe construit sur une faute de logique est devenu à la longue une imposture politique. Les jeunes les plus démunis, tous les «malchanceux» de l'égalité, n'ont pas vraiment besoin qu'on aille leur expliquer que l'égalité des chances est un serment d'ivrogne, et que dans l'idéal républicain, il fallait qu'ils entendent «chance» (c'est-à-dire «pas de chance» pour eux) plutôt qu'égalité ! Chacun peut comprendre que l'égalité des chances est un jeu à somme nulle où ce que l'un gagne, l'autre le perd, et surtout qu'il ne peut gagner qu'à condition que l'autre ait perdu. A la différence de l'égalité des droits qui s'applique uniment à toutes les personnes sans exception, l'égalité des chances est incrustée dans une anthropologie de l'individu individualiste, de la compétition et concurrence de chacun contre tous où comme le dit Albert Jacquard : «Les gagnants sont des fabricants de perdants.» Libé 07/11/06 |
Education prioritaire : un rapport pointe des moyens "trop dispersés" (Igen)
|
Extraits
"Après une naissance (en 1982, ndlr) très volontariste, on est passé par
des phases successives de repli et de relance jusqu'à la mise en place
récente des réseaux ambition réussite", note le rapport de l'Inspection
générale de l'éducation nationale (Igen).
|
|
Des punitions bêtes et méchantes A quoi tient la percée médiatico-ministérielle des antipédagogues de l’éducation ?
Sylvain Grandserre, maître d’école, militant pédagogique et syndicaliste |
Extraits Une vision archaïque de l’éducation encombre blogs, forums, livres, journaux, télés, radios, magazines ou simples réunions publiques. Cette rhétorique simpliste hérisse le poil des uns mais fait se tendre l’oreille des autres. À quoi tient la percée de ces antipédagogues auprès de parents déboussolés, d’animateurs en mal d’audimat ou d’enseignants parfois dépassés ? Il y a d’abord une troublante complaisance médiatique. Quand Françoise Laborde reçoit Jean-Paul Brighelli aux Quatre vérités (27 avril 2006 et 19 octobre 2006 !), elle ne précise pas que « Jean-Paul » la remercie... à la fin de son livre. Anne Guéry, elle aussi de France 2, filme les classes de Rachel Boutonnet (Sauver les lettres) et de Françoise Candelier (Savoir lire, écrire, compter, calculer), puis affirme : « quand je vais voir un enseignant, je ne connais pas son profil » Ensuite, ces rustiques aux gros sabots se présentent comme d’honorables et courageux « résistants ». Ils se conduisent surtout en zélés collaborateurs du pouvoir, exerçant leur lobbying auprès d’un ministère perméable à leurs arguments. Ainsi, J-P. Brighelli après une émission où on fit semblant de l’opposer au ministre (l’Arène de France, France 2 le 6 septembre 2006) déclare : « Il y avait un jeu assez complice entre moi et de Robien, plus ou moins planifié d’avance. Le fait de nous mettre dans des camps opposés n’était que de la frime ». Jamais n’est affiché le prix à payer par les élèves pour supporter dressage et gavage. On se contentera de citer Rachel Boutonnet « Je demande à mes élèves de rester immobiles et attentifs en classe (...) Je ne crains pas qu’ils s’ennuient (...) Mes punitions sont bêtes et méchantes » L'Humanité 28/10/06 Voir une version intégrale de ce texte sur le Forum |
|
Banlieues: les habitants craignent logiquement que demain soit pire Charles Pellegrini et Laurent Mucchielli. Un ancien policier et un sociologue confrontent leurs points de vue sur l'évolution de la situation dans les quartiers après les violences de l'année dernière et explorent ensemble des pistes possibles pour l'avenir. |
Extraits Charles Pellegrini. Pour moi, les émeutes, c'est la faillite totale de l'école dans son modèle unique, cartésien. Elle n'a pas réussi à faire le minimum, que les jeunes sachent lire, écrire, compter. Beaucoup de jeunes sont inadaptés aux horaires, à la vie publique. Laurent Mucchielli. Sur l'école, nous vivons sur un mythe républicain qui consiste à croire que le traitement égal des enfants dans les classes fabrique ipso facto l'égalité des chances. Le premier problème c'est que, dans la réalité, les enfants et leurs familles n'arrivent pas égaux à l'école. L'Education nationale n'en faisant pas une priorité, on entérine l'inégalité de départ au lieu de la combattre d'emblée. Par ailleurs, on continue à vivre avec une forte déconnexion entre monde scolaire, société globale et monde du travail. L'école est un système un peu à part, qui perpétue son modèle élitiste, qui note dès le plus jeune âge, qui hiérarchise les enfants, qui regroupe les bons entre eux et les mauvais entre eux, reproduisant ainsi les inégalités. Il y a toujours des exceptions individuelles, mais les constats statistiques sont accablants. Libé 28/10/06 |
Éducation : la facture flambe, les notes stagnentEn quinze ans, le coût annuel moyen d'un collégien a grimpé de 33 %, et celui d'un lycéen de 50 %, indiquent les deux rapports des audits de modernisation consacrés aux grilles horaires du collège et du lycée. Mais le niveau des élèves patine. |
Extraits Le coût annuel moyen d'un collégien a grimpé de 33 % entre 1990 et 2004, atteignant 7 401 euros. « Sans une action volontaire sur la masse salariale des personnels et sans réforme pédagogique majeure (par exemple le plafonnement du redoublement), le coût moyen du collégien devrait continuer de progresser entre 2006 et 2010 et dépasser 8 200 euros par an en 2010 hors inflation. » Le taux de réussite au brevet des collèges « plafonne à moins de 80 % ». Seul un quart des élèves atteint le niveau requis en fin de collège et « un élève sur six est en grande difficulté ». Ce qui, selon les auteurs, « témoigne bien de la difficulté du collège à combler les lacunes des élèves qu'il accueille ». Le nombre de collégiens a baissé de 5,7 % entre 1995 et 2004. Pour maintenir un taux identique d'encadrement des collégiens, le ministère « aurait pu supprimer 8 946 emplois entre 1995 et 2005, souligne une des annexes du rapport. Il a en fait créé 2 204 emplois ». Si le coût moyen par collégien est élevé, c'est aussi parce qu'ils reçoivent un enseignement beaucoup plus lourd que leurs camarades étrangers. Entre 12 et 14 ans, chaque petit Français absorbe chaque année en moyenne 56 heures de cours de plus que ses camarades européens. La facture s'est aussi considérablement alourdie au lycée : la dépense moyenne par lycéen a augmenté de 50 % entre 1990 et 2004 pour frôler 10 000 euros par élève et par an. Soit 30 % de plus que la moyenne de l'OCDE. Comme au collège, les résultats ne suivent pas : le taux d'accès au bac stagne à 70 % depuis dix ans. Le Figaro 17/10/06 Deux audits pour « dégraisser le mammouth » L'Humanité 19/10/06 L'heure de vérité Le Point 02/11/06 |
|
Carte
scolaire : |
Extraits Parmi les suggestions de Faride Hamana, [Président de la FCPE] dont il espère "qu'au moins une sera retenue", figurent un "état des lieux des établissements" touchés par le contournement de la carte scolaire et, si besoin, la fermeture des "établissements ghettos" et la répartition "de leurs élèves dans les autres établissements du bassin". La FCPE a aussi renouvelé sa demande que l'enseignement privé soit concerné par la carte scolaire car, "à partir du moment où il bénéficie du financement public, il n'y a pas de raison de ne pas respecter la sectorisation" "Mettre en place des transports scolaires gratuits, définir des indicateurs de la réussite scolaire, ouvrir des options recherchées dans les établissements qui perdent des élèves" sont d'autres recettes plébiscitées par la fédération Nel Obs 13/10/06 Sectorisation : 16 propositions de la FCPE au ministre (téléchargeable) Rappels historiques sur la sectorisation par Claude Lelièvre Conseil scientifique de la FCPE |
|
Quel avenir pour l'école ?
|
Extraits
Contre les idées
reçues. Contrairement à ce qu'on croit, une majorité de Français pensent
que l’école marche bien. Et même plutôt mieux qu’avant. Contrairement à
ce qu'on croit, ils ne regrettent pas l'école de papa. L’école a donc plutôt la cote : 77% des parents et 74% des enseignants estiment qu’elle fonctionne bien. Et qu’elle a progressé depuis cinquante ans. On n’observe pas de raz-de-marée nostalgique. En revanche, ils estiment que la situation s’est dégradée depuis dix ans.
Ce qui va très mal ?
L’école ne sait plus ni éduquer. 84% des sondés déplorent que l’autorité
du maître se soit perdue, et que la transmission des valeurs morales et
civiques se fasse moins bien. Les jeunes [enseignants] abordent le métier avec plus de confiance que leurs aînés : 31% des professeurs de moins de 35 ans estiment que l’école fonctionne mieux, mais seulement 19% de ceux qui ont plus de 50 ans. Quant à l’école de demain, outre l’instruction et l’éducation à la vie en société, qui restent des priorités, 48% des parents et 35% des professeurs pensent qu’elle doit préparer à la vie professionnelle. Ils souhaitent des élèves moins nombreux par classe, le développement du soutien individuel, une pédagogie plus concrète, une meilleure place aux nouvelles technologies….Enfin, dans cette école idéale, ils y réclament davantage d’adultes, de surveillance…et de sanctions. 75% des parents en redemandent, contre 59% des enseignants. Quant à l’épanouissement des élèves, ils s’en soucient peu, les parents encore moins que les enseignants. Nel Obs 11/10/06 LA PERCEPTION DE L'ÉCOLE D'HIER ET DE DEMAIN Regards croisés Parents / Enseignants TNS Sofres Sondage téléchargeable *.pdf |
|
Marco Oberti Sociologue, chercheur au CNRS, auteur de "L'Ecole dans la ville ", à paraître prochainement aux Presses de Sciences Po La fréquentation des collèges dépend des enseignements offerts. En concentrant dans certains établissements le soutien aux élèves en difficulté et dans d'autres les filières d'excellence, l'éducation nationale favorise la ségrégation recherchée par les classes supérieures Le jeu faussé de la carte scolaire
|
Extraits [La carte scolaire] ne garantit plus la mixité dans certains secteurs, mais elle ne s'applique pas de façon équitable à tous. Elle enferme les catégories les plus précaires dans des lieux déjà très stigmatisés, alors que les classes supérieures font leur choix. Il faut revoir le découpage des secteurs, l'appliquer au secteur privé sous contrat et garantir la même offre dans tous les collèges. Je me suis toujours méfié du discours ambiant, qui présente les classes moyennes comme les principales responsables de l'évitement scolaire. En effet, une analyse fine du terrain réfute cette thèse, soutenue aussi bien par certains responsables politiques que par certains chercheurs en sciences sociales. Même lorsqu'elles résident dans des communes favorisées. Dans ces quartiers, le pourcentage des enfants de cadres qui fréquentent un autre collège que celui de leur commune peut aller jusqu'à 60 %. Il est de 28 % au maximum pour les enfants de professions intermédiaires, 21 % pour ceux d'employés et 18 % pour ceux d'ouvriers. C'est une erreur de penser que tous les parents s'inscrivent dans une quête de l'élitisme. Tout le monde ne vise pas Centrale ou Polytechnique ! La plupart recherchent avant tout un milieu sûr et serein. La grande majorité de la population n'est pas porteuse d'une vision de la société sans immigrés, sans classe populaire. En revanche, lorsque ces ménages, et en particulier ceux qui appartiennent aux classes moyennes, ont le sentiment, pas toujours fondé, qu'un "déséquilibre" s'instaure, dès que leur école ne reflète plus l'idée qu'ils se font de la mixité sociale, ils tentent d'échapper à la carte scolaire. Plus qu'un refus de la mixité, c'est un refus de la ségrégation. La ségrégation la plus forte concerne les classes supérieures. Ce sont celles qui se sont le plus concentrées et le plus éloignées des classes populaires et des immigrés au cours des années 1990. La tendance est particulièrement marquée chez les cadres d'entreprise, les ingénieurs du privé et les professions libérales. A l'autre bout du spectre, il existe aussi un nombre limité de quartiers très populaires, caractérisés par une augmentation de la précarité et du chômage, qui ont en quelque sorte "décroché" du reste du tissu social et urbain. Mais ils sont loin d'être la norme. La majorité des quartiers ouvriers n'a pas vu le niveau de ségrégation augmenter. L'offre d'excellence que constituent les options de langues rares, les classes à horaires aménagés, les classes européennes avec différentes langues, ou encore les classes préparatoires pour les lycées, est concentrée dans les communes riches. A l'inverse, les établissements des communes les plus populaires se sont en quelque sorte spécialisés dans les dispositifs de soutien scolaire. L'éducation nationale s'est souvent contentée de répondre au coup par coup à une pression parentale réelle dans certaines communes favorisées. Le Monde 08/10/06 |
|
Gilles de Robien ne plaisante pas avec le b.a.ba |
La croisade du ministre de l'Education nationale pour la méthode syllabique vient de faire une victime : un inspecteur de l'Education nationale en butte à une «procédure disciplinaire». L'homme, qui veut rester anonyme, a osé expliquer dans la presse régionale que la question était complexe et que, outre le déchiffrage, il fallait travailler simultanément à la compréhension du texte avec l'élève. Il s'exprimait par ailleurs en tant que responsable syndical, a annoncé vendredi l'Unsa, qui dénonce l'atteinte à la liberté de parole syndicale. Dans un courrier au ministre et au Premier ministre, l'Unsa-Education réclame l'abandon de la procédure et menace, sinon, d'une «riposte extrêmement forte». Libé 07/10/06 Voir aussi le dossier de presse Lecture |
Apprentissage à 14 ans : ça ne prend pas
|
Extraits Où sont les nouveaux apprentis junior, inventés par le gouvernement en pleine crise des banlieues ? Pas dans l'Ouest, en tout cas. Gilles de Robien promettait « au moins 15 000 apprentis junior » dès la rentrée 2006. On est loin du compte. En Bretagne, Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie, les rectorats concèdent qu'une seule classe a été créée, dans un lycée privé du Morbihan ! Au ministère, un conseiller arrondit le chiffre à 2000 apprentis junior dans l'Hexagone. le frein n'est pas seulement politique. Les enseignants de lycées professionnels rechignent. Certains responsables de centres de formation des apprentis (CFA) aussi : « À partir du moment où l'apprenti est payé 20 % du smic, les employeurs risquent de demander un certain rendement au jeune de 14 ans », déplore un directeur de CFA breton. « Pour un apprentissage réussi, il faut travailler sur le parcours du jeune, bien identifier ses aptitudes, ses souhaits. Ce n'est pas simple à 16 ans, encore moins à 14 ans » Ouest-France 04/10/06 |
|
L'école et ses bonnes vieilles méthodes |
Extraits Désormais, le mot d’ordre est de recentrer l’école sur les fondamentaux, le célèbre triptyque lire-compter-écrire. Le socle commun proposé par la commission Thélot à l’issue du grand débat sur l’école de 2004 reposait sur «deux piliers», la langue et les mathématiques. Septembre 2004 : François Fillon effectue sa première rentrée comme ministre de l’éducation. Il annonce alors sans détour : « Sur la maîtrise du Français en sixième, je prépare une circulaire qui vise à remettre fortement au goût du jour les exercices traditionnels qui ont fait la preuve de leur efficacité. » Le ministre énumère : dictées, récitations, rédactions… Après les méthodes de lecture l’an dernier, la grammaire est le prochain chantier de Gilles de Robien qui a confié une mission au linguiste Alain Bentolila. La grammaire est devenue très jargonnante ; un jargon lié au fait que les programmes ont tenté une transposition entre les savoirs universitaires et l’enseignement scolaire. Il faut désormais distinguer clairement « le cadre conceptuel destiné aux enseignants et les notions que les élèves doivent apprendre », écrivait en mars dernier le Haut Conseil de l’éducation (HCE) En réveillant la vieille querelle des méthodes [d’apprentissage de la lecture], l’intervention du ministre a troublé le monde des chercheurs et des enseignants. En mars, l’arrêté qui modifie les programmes scolaires a toutefois retrouvé le sens de la mesure. Oubliées les références aux méthodes. Le texte précise simplement que dès le début du cours préparatoire, un « entraînement systématique à la relation entre graphèmes et phonèmes », autrement dit le décodage, doit être assuré. Le HCE recommande l’apprentissage des quatre opérations le plus tôt possible. Il cite aussi expressément la « règle de trois » qui, depuis les années 1970, s’est dissoute dans l’étude des problèmes de « proportionnalité ». Les études internationales prouvent que la France est championne du monde du redoublement. 38 % des élèves de moins de 15 ans ont redoublé au moins une fois selon l’OCDE. Or, toutes les études scientifiques prouvent que faire recommencer à l’identique une année scolaire ne donne pas de bons résultats. [Cependant] la loi sur l’avenir de l’école de 2005 a renforcé [la] marge de manœuvre [des enseignants]: « Il appartient aux enseignants d’apprécier, au terme de chaque année scolaire, si les élèves ont acquis les connaissances et les compétences leur permettant de suivre l’enseignement dispensé au niveau supérieur. » Les parents d’élèves avaient obtenu, sous le ministère de Jack Lang, l’interdiction des punitions collectives. Pourtant, en octobre 2004, une circulaire de François Fillon les ont rétablies. Tous les collégiens vont désormais recevoir une note de vie scolaire inscrite sur leur bulletin. Mais beaucoup de professionnels jugent le concept de « note » mal adapté à une telle évaluation.La Croix 04/10/06 |
Robien: "passer les programmes scolaires au crible du socle commun" |
Extraits
Gilles de Robien annonce dans une interview à paraître mercredi dans La
Croix son intention de "passer les programmes scolaires au crible du
socle commun", notamment les programmes de grammaire.
|
Tant qu'il y aura des livres sur l'école
TANT QU'IL Y AURA DES ÉLÈVES d'Hervé Hamon. Points, 360 p., 7 €.
ALLEZ LES FILLES ! Une révolution silencieuse de Christian Baudelot et Roger Establet. Points, 282 p., 7 € |
Extraits "Le débat sur la question scolaire se porte très mal. La décision publique, en la matière, est incohérente. La versatilité de l'information est confondante. L'opinion se règle sur la rumeur, jamais sur l'examen. La calomnie ou le trémolo l'emportent sur le souci de la connaissance, de la connaissance scrupuleuse. Les chercheurs ne sont guère écoutés. Les professionnels de terrain non plus. Et nombre d'intellectuels généralistes s'alignent sur les polémistes les plus médiocres", indique [Hervé Hamon] qui a siégé plusieurs années au sein du Haut Conseil de l'évaluation de l'école. Des trois ministres qu'il a vu défiler depuis 2002, il dresse des portraits sévères : Luc Ferry, le philosophe, aveugle aux réalités du terrain, embarqué dans des débats idéologiques ; François Fillon, à l'origine de la loi qui porte son nom, pressé de ne rien changer ; Gilles de Robien, enfin, "le seul des trois à entrer dans l'histoire" parce qu'il a mis à mal le "collège unique", où l'idéal de conduire les élèves le plus loin possible dans leur scolarité. A l'issue de son voyage ethnologique, Hervé Hamon a acquis la conviction que l'école changera par ses marges, ces établissements "sensibles" où sont concentrées les difficultés. Pourquoi les marges ? Parce que le centre - le ministère, les syndicats, les hommes politiques et les experts - est englué dans le conservatisme, les non-dits, les traditions. Parce que les périphéries, au sens propre comme figuré, sont aujourd'hui les plus inventives, les plus réactives face à des publics scolaires qui évoluent. L'école est loin d'être un monolithe, insensible aux transformations sociales et culturelles. Un seul exemple, témoin de l'extraordinaire plasticité du système : la "révolution silencieuse" de la prise de pouvoir des filles dans le monde scolaire que racontent Christian Baudelot et Roger Establet dans une réédition, mise à jour, de leur célèbre enquête, parue en 1992, Allez les filles ! Au primaire, au collège, au lycée et à l'université, elles réussissent mieux que leurs camarades masculins. C'est aussi une évolution mondiale : en 1985, les filles ne l'emportent (en matière d'accès à l'université) que dans 28 pays sur 109 recensés ; en 2002, elles dominent dans 84 des 145 pays. Malgré l'excellence de leurs parcours scolaires, [les filles] subissent toujours une orientation défavorable et une ségrégation sur le marché du travail. Le Monde 29/09/06 |
|
Parents-profs la déchirure
|
Extraits D'un côté les profs, mi-victimes, mi-héros. Ils supportent à longueur d'année des élèves remuants, des programmes intenables et des méthodes discutables. De l'autre, les parents d'élèves, une espèce indisciplinée et hétéroclite, réunie par une seule obsession : la réussite de leurs rejetons. Les enseignants les accueillent en traînant les pieds. Un signe ? Une circulaire ministérielle du 31 août les oblige à organiser trois rencontres par an avec les parents. Selon un sondage Sofres réalisé au lendemain de la rentrée scolaire, 80% des parents d'élèves la trouvent «utile». Côté enseignants, ils ne sont que 53%. Jean-Louis Jutant, médiateur de l'Education nationale, témoigne : «En 2005, 60% des 5500saisines émanent de parents qui demandent des comptes aux professeurs.» Une suspicion qui peut «dégénérer en agressivité si le professeur ne donne pas de réponse», poursuit-il. «Il y a une exigence accrue de qualité, un droit au questionnement, dans l'intérêt de l'enfant», tranche Faride Hamana, président de la FCPE. «L'attitude du cadre diplômé vis-à-vis de l'école est à peu près la même que celle qu'il a adoptée à l'égard de la Poste: ça doit mieux fonctionner», analysait il y a quelque temps Claude Thélot. Les absences ? Le sujet est explosif. Qu'il soit en formation, malade, en grève ou juste négligent, le résultat est le même : la chaise du prof est vide. «Il n'y a aucune sanction pour le professeur qui fait mal son boulot. Pour quelques moutons noirs, que l'institution néglige, c'est un voile de discrédit jeté sur tous les professeurs», regrette Anne Kerkhove, présidente de la Peep. «Aujourd'hui, où le seul capital qui tienne, c'est le diplôme, explique le sociologue François de Singly, il faut réussir à l'école pour avoir une chance d'entrer dans la compétition sur le marché du travail. Alors les parents interviennent à tout bout de champ.» La Fédération des Autonomes de Solidarité (FAS), qui fournit une aide juridique aux professeurs en cas de conflit, relève une augmentation sensible des contentieux. Quadrature du cercle, de la maternelle à la terminale, les parents veulent tout et son contraire : le prof est sommé d'aider leur enfant à s'épanouir, à prendre confiance en lui, et en même temps il doit évaluer, noter et classer. Sans traumatiser les chérubins. «On veut que les professeurs fassent respecter par les élèves des interdictions que les parents ne sont plus capables d'imposer», analyse l'historien Antoine Prost. Nel Obs hebdo 28/09/06 |
|
Un "prof" sanctionné après avoir exprimé sa position |
Extraits
"Le professeur Roland
Goigoux est exclu de la formation des inspecteurs de l'Education
nationale, on lui reproche des positions non conformes à la pensée
d'Etat", s'est indigné le secrétaire général du SE-Unsa Luc Bérille. "Le directeur de l'ESEN m'a téléphoné pour m'informer qu'il mettait un terme à notre collaboration. Je devais intervenir dans la formation des inspecteurs sur la lecture à partir du 29 novembre, comme chaque année depuis dix ans" avait expliqué Roland Goigoux. Le directeur de l'ESEN, Jean David, a confirmé cette décision: "A la lecture de son dernier ouvrage j'ai estimé que certains passages allaient à l'encontre des propos du ministre de l'Education" Nel Obs 26/09/06 Interdit de former des inspecteurs après avoir écrit un livre sur la lecture Vousnousils 26/09/06 |
|
|
Carte (scolaire) sur table (ronde) |
Extraits La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) propose que la carte scolaire et les dérogations soient décidées lors de commissions communales et départementales. Elles réuniraient des représentants des familles, de l’éducation nationale et des élus territoriaux. « Les décisions ne doivent plus dépendre d’une seule personne, le maire pour l’école primaire et l’inspecteur académique pour le collège », explique Farid Hamana son Présdent. La vocation de la sectorisation est d’assurer une mixité sociale - et ethnique - des élèves, en rattachant à un même établissement les enfants de quartiers socialement hétéroclites. Pourtant, certains découpages renforcent la ghettoïsation. D’où l’idée de réactualiser le découpage des secteurs. Les politiques d’hier sont parfois celles d’aujourd’hui : les mauvaises, mais décisives, volontés de certains élus ou établissements « bien cotés » persistent. Par ailleurs, les quartiers « populaires » et « bourgeois » ne sont pas forcément mitoyens. La ségrégation scolaire commence avec la ghettoïsation urbaine... Sur le thème de la contrainte, une autre piste est avancée par la FSU : pénaliser les établissements « bien cotés » qui jouent la concurrence [en ne tenant pas] compte des élèves hors secteurs dans l’attribution de leurs dotations. alors qu’il scolarise 20 % des élèves, le secteur privé est un sas de contournement important. Et le demeurera en dépit de toute amélioration si rien n’est fait pour le soumettre, lui aussi, à la carte scolaire. Tant que le collège du quartier n’inspirera pas confiance, rien ne pourra empêcher les parents d’en sortir leurs gamins. Renforcer l’encadrement, développer les options et les heures de soutien, stabiliser les équipes éducatives sont autant de revendications émises depuis longtemps. L'Humanité 23/09/06 Réforme de la carte scolaire : le gouvernement presse le pas Le Figaro 20/09/06 |
|
|
Au-delà de la carte scolaire, faut-il casser l'Education nationale ? |
Extraits Le débat qui s'est amorcé autour de la carte scolaire risque de tourner court. En effet, une fois passés les effets de manche de candidats aux présidentielles en quête d'idées originales, un consensus se profile déjà. Oui, notre système de carte scolaire est contestable. Il est détourné par un nombre non négligeable de parents de l'enseignement public, et il est, en tout état de cause, détourné par tous les parents qui choisissent de mettre leurs enfants dans un établissement privé plutôt que dans le collège ou le lycée du secteur. On pourrait songer à réformer la carte scolaire en supprimant carrément les établissements à problèmes. Cette proposition n'a rien d'absurde ; elle consiste à transporter vers des établissements mieux dotés les élèves actuellement confinés dans les ghettos (l'inverse paraissant difficile à faire passer). Cela conduirait à diversifier les origines sociales au sein des établissements, ce qui est considéré généralement comme un facteur important d'égalité des chances. Ceux qui entretiennent un doute radical sur les capacités de notre système éducatif à remonter la pente pourraient être tentés d'aller au-delà de cette proposition. On peut très bien concevoir que les parents soient laissés entièrement libres du choix de l'école. En contrepartie de l'obligation scolaire, ils recevraient de l'Etat chaque année un chèque par enfant, valable uniquement pour payer la scolarité de cet enfant. Malgré ses avantages, le système que nous venons de décrire n'existe nulle part. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'idée de donner la liberté aux parents de décider quelle éducation convient le mieux à leurs enfants fait aussi peur. L'éducation est destinée à former des citoyens éclairés, aptes à se gouverner eux-mêmes et à participer aux affaires publiques. Les choix en matière éducative sont donc déterminants, aussi bien pour l'avenir des enfants que pour le bon fonctionnement de la société. Or, tous les parents ne sont pas eux-mêmes des citoyens éclairés. dans les zones à problème, on retrouve grosso modo les mêmes tares : création d'écoles-ghettos et fuite des enfants des milieux aisés soit vers le secteur privé, soit - au mépris de la carte scolaire - vers des établissements publics plus performants. Sans aller jusqu'à adopter " l'éducation de marché ", conduire la décentralisation à son terme, enterrer le mammouth, rapprocher les instances décisionnelles des utilisateurs serait certainement un progrès. A défaut, on pourrait, au moins, d'une part " casser " tous les établissements actuellement en perdition, tous ceux où les équipes éducatives s'épuisent à faire régner un minimum d'ordre et ont renoncé, par la force des choses, à respecter les programmes fixés par le ministère, et d'autre part, réformer la carte scolaire, comme indiqué plus haut. gora Vox 22/09/06 |
|
|
La sectorisation, une méthode éprouvée Dans les pays d'Europe où il est appliqué, le libre choix de l'école a accentué les inégalités
|
Extraits Dans les pays d'Europe où il est appliqué, le libre choix de l'école a accentué les inégalités. En Grande-Bretagne, la sectorisation scolaire, combinée à la publication d'un classement national des lycées, a eu pour conséquence une flambée de l'immobilier. L'attribution des places en primaire et au lycée se fait en fonction du secteur scolaire auquel appartient l'enfant. Une loi votée par les conservateurs en 1988 permet en outre aux parents de signaler l'établissement de leur choix, qui peut se trouver en dehors de leur secteur. La priorité est donnée aux enfants habitant le quartier, le reste des places s'il y en a étant attribué aux parents qui ont cité cet établissement en «préférence».. il existe 6 500 établissements primaires et 600 lycées confessionnels (anglicans, catholiques, juifs, et depuis 1997 musulmans et sikhs) qui recrutent leurs élèves en fonction de la religion et non du secteur. Trois des enfants Blair ont ainsi étudié à l'Oratoire, un excellent lycée public catholique. Aux Pays-Bas, les parents ont toute liberté pour inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. Dans les années 80, ce choix s'est largement fait en fonction des préférences religieuses, entre les écoles laïques (31 % des élèves du primaire), protestantes (27,5 %) et catholiques (34 %), avec une part marginale d'écoles islamiques, juives ou hindoues (7,4 %). «Dans la pratique, la Constitution rend possible la ségrégation scolaire aux Pays-Bas», déplore Ahmed Aboutaleb, le maire adjoint d'Amsterdam, d'origine marocaine. Cette ségrégation a donné naissance à une distinction de plus en plus nette entre «écoles noires» et «écoles blanches». Une école primaire située à l'est du port d'Amsterdam a instauré une entrée séparée, l'une pour les petites têtes blondes des autochtones, l'autre pour les petites têtes brunes des «allochtones». La Suède a adopté une série de réformes : transfert de l'Etat aux communes de la responsabilité des établissements scolaires, de leur personnel et de l'organisation des cours, subvention des établissements privés au même titre que les écoles, collèges et lycées publics, et pour finir liberté de choix de l'établissement. «Nous sommes forcés de constater une augmentation des inégalités entre les différentes écoles, en termes de résultats scolaires», observe Anita Wester, conseillère à la Direction nationale de l'enseignement scolaire. Selon le système espagnol, les parents d'élèves sollicitent l'admission de leur enfant dans tel ou tel établissement. Puis, le conseil scolaire répartit les élèves dans les écoles publiques ou concertadas en fonction de trois critères : la présence d'un frère (ou soeur) dans l'établissement, la proximité du domicile, puis celle du lieu de travail des parents. Idéalement, ce système doit permettre une répartition équitable des élèves étrangers. Dans la pratique, cela ne fonctionne pas. Chaque année, le nombre d'élèves immigrés croît dans le public et diminue dans les institutions privées et concertadas (privées avec subventions publiques). Libé 20/09/06 |
|
Pourquoi empêcherait-on totalement le choix des établissements ? Georges Felouzis, professeur de sociologie à l’université de Bordeaux-II |
Extraits« Il ne faut pas supprimer la carte scolaire. Ce serait une erreur parce qu’on laisserait un choix total aux parents. Même s’il serait positif de voir accroître la liberté individuelle de chacun, on remarque tout de même que dans les pays où la carte scolaire n’existe pas la ségrégation est bien plus forte. Sans carte, les ghettos scolaires se développent.Lorsqu’elle a été créée dans les années 1960, la carte scolaire n’avait pas pour but de réguler la mixité sociale mais de planifier les effectifs.Ensuite, la carte scolaire a changé de sens. On lui a attribué la fonction de garantir la mixité sociale. Aujourd’hui, le problème concerne les effets pervers du fonctionnement de la carte scolaire dans la mesure où seules les familles plus aisées peuvent choisir leur établis- sement.Si assouplir veut dire que tout le monde peut choisir son établissement, cela aurait plus d’inconvénients que d’avantages. Cela renforcerait la nature ségrégative de l’offre scolaire ainsi que les inégalités entre établissements. Cela donnerait aux collèges et aux lycées les plus attractifs le monopole de la régulation des flux.Si on assouplit la carte il faut le faire dans l’intérêt des plus faibles et non pas des plus forts. Cela signifie donner la possibilité aux élèves les plus défavorisés, et notamment à ceux qui sont dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP), d’être les seuls à pouvoir choisir leur établissement. Par contre, les autres ne choisiront pas. L'Humanité 16/09/06 |
La carte scolaire est devenue l'instrument de la ségrégation sociale
N. Sarkozy |
Extraits La carte scolaire a été créée en 1963. Elle part du principe que la meilleure manière de garantir l'égalité des chances est d'uniformiser les établissements et d'y répartir les élèves de manière autoritaire afin de créer de la mixité sociale. La première idée ne correspond plus aux besoins de l'école aujourd'hui. L'école accueille des publics plus nombreux, plus divers, qu'elle mène à des niveaux de qualification plus élevés. Elle ne peut plus le faire dans les mêmes conditions qu'à l'époque où une sélection sévère, parfois brutale, se chargeait d'écarter ceux qui semblaient inadaptés. La seconde idée est juste et elle n'a pas pris une ride. Toutes les études sérieuses le démontrent : les principaux facteurs de réussite des élèves sont, dans l'ordre, la qualité pédagogique des enseignants et la mixité sociale, loin devant le nombre d'élèves par classe. Mais la carte scolaire, qui était effectivement autrefois l'outil de la mixité, est devenue l'instrument de la ségrégation. les établissements situés dans les quartiers les plus défavorisés sont devenus de véritables ghettos où le seul effet de la carte scolaire est d'y concentrer les élèves le plus en difficulté quand il faudrait au contraire les répartir dans d'autres établissements. 30% des enfants sont scolarisés en dehors de leur collège de rattachement La première [proposition] est de donner de l'autonomie aux établissements scolaires pour leur permettre de mettre en œuvre des projets éducatifs spécifiques. Qui dit autonomie dit évaluation. Je propose que nous nous dotions d'un organisme d'évaluation de chaque établissement scolaire. Enfin, qui dit évaluation dit engagement de l'Etat à aider les établissements qui ont des difficultés à améliorer leurs performances. La conséquence logique de ces propositions, c'est le libre choix par les parents de l'établissement scolaire de leur enfant. Le Monde 16/09/06 |
|
Pour sortir les quartiers de l'apartheid, lutter contre la carte scolaire ne suffit pas. L'école recentrée par la ville Yazid Sabeg président du Comité d'évaluation et de suivi de l'Agence de rénovation urbaine.
|
Extraits La carte scolaire, telle qu'elle a été conçue il y a plus de trente ans pour assurer la mixité sociale, nourrit aujourd'hui l'apartheid qui gangrène nos quartiers les plus défavorisés. Un tiers des parents parmi les plus favorisés la contournent, près de la moitié des enfants de l'immigration sont scolarisés dans moins d'un dixième des collèges. Le niveau des écoles d'un quartier est plus bas que celui-ci concentre des populations qui cumulent les inégalités et/ou immigrées, et inversement, ce quartier devient un ghetto en raison justement du départ des familles de classes moyennes qui le quittent pour échapper au diktat de la carte scolaire. Au cercle vicieux de l'exclusion, il faut encore ajouter la répartition territoriale inéquitable de l'offre scolaire. On recense dans les quartiers sensibles seulement cinq lycées d'enseignement strictement général, contre 99 lycées professionnels et 5,5 % des classes préparatoires ! Combien d'élèves qui auraient la capacité d'accéder à un bac général n'y pensent même pas, et sont mécaniquement orientés vers un bac technique ? Il faut que les habitants des quartiers puissent accéder à tous les services d'éducation, mais aussi d'emploi, de logement, de santé ou encore de loisirs, dans les mêmes conditions que dans les centres-villes. Une carte scolaire qui comporte une offre scolaire et éducative diversifiée et qui permette le brassage des populations devrait s'organiser autour du regroupement d'établissements y compris privés de niveaux divers ; étant entendu que les établissements les plus défavorisés bénéficieraient de ressources exceptionnelles, au titre de l'équité de l'offre et de l'égalité des moyens. Pour créer des zones d'excellence pédagogique, les ressources affectées par élève ne devraient pas être inférieures comme c'est le cas aujourd'hui à celles qui bénéficient aux établissements de centre-ville. La réforme de la carte scolaire ne peut être envisagée indépendamment d'une vaste politique d'équité territoriale. Ségrégation urbaine, ségrégation scolaire L’école au cœur des enjeux urbains Actes du colloque Agence Nationale pour la rénovation Urbaine |
|
En calquant la sectorisation sur le plan des lignes de transport collectif, les objectifs de mixité sociale et de proximité peuvent être atteints. Le métro et le bus au secours de la carte scolaire Chantal Duchêne
|
Extraits Il a été largement souligné que les mieux armés et les mieux informés se débrouillent pour contourner le système et que l'on assiste à la ghettoïsation des établissements des zones les plus difficiles dans les grandes agglomérations. En revanche, il a moins été mis en évidence que la ghettoïsation des quartiers est accentuée par la carte scolaire. En effet, pour éviter que leurs enfants soient scolarisés dans un établissement réputé difficile, des familles renoncent à venir s'installer dans les quartiers «difficiles», La sectorisation le long des lignes de transport collectif permettrait d'atteindre à la fois les objectifs de proximité et de mixité sociale. En effet, la plupart des lignes traversent des quartiers diversifiés : dans les grandes villes où se pose principalement la question de la carte scolaire, les lignes de métro et de tramway, notamment, mais aussi les lignes de bus structurantes vont ainsi de la périphérie au centre des villes. Cette méthode de sectorisation est déjà appliquée avec succès en Suisse. Libé 14/09/06 |
|
La carte scolaire et le programme unique obsolètes, c'est toute l'institution qu'il faut repenser. De l'école républicaine à l'école sociale François Asher |
Extraits Aujourd'hui, l'école fonctionne de fait comme un facteur d'aggravation des inégalités sociales. Les chiffres sont connus, mais l'un des plus spectaculaires est certainement le fait qu'un enfant d'ouvrier agricole a moins de 0,5 % de chances d'intégrer une grande école ; un fils d'ouvrier qualifié moins de 1,2 % ; un enfant d'employé 4 %, tandis que ce chiffre est de 21 % et plus pour les enfants des chefs d'entreprise, des professeurs, des ingénieurs, des membres des professions scientifiques et libérales. La carte scolaire accentue la ségrégation sociale dans l'espace et favorise la privatisation de l'éducation. Le programme unique joue de la même façon, doublement. D'une part, il est inadapté aux enfants de groupes sociaux très modestes, qui vivent dans des conditions matérielles, familiales, culturelles et économiques peu propices aux études. D'autre part, les couches plus aisées trouvent que ce programme prépare mal leurs enfants à une compétition scolaire et universitaire qui semble de plus en plus décisive pour leur avenir. Le premier axe d'une nouvelle politique est évidemment de mettre beaucoup plus de moyens au service de cette nouvelle politique éducative sociale : il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de rendre l'école plus payante qu'aujourd'hui. Le deuxième axe de cette nouvelle politique serait de modifier les programmes de façon à les adapter à l'éducation d'enfants de milieux socioculturels peu familiers de l'école ou insuffisamment mobilisés par l'enjeu scolaire. Libé 14/09/06 |
|
Pire que la discrimination par la carte scolaire, l'obligation d'accepter une éducation formatée. Pour des pédagogies différenciées Bernard Collot essayiste, ancien instituteur. Auteur de: Une école du 3e type ou la pédagogie de la mouche, éd. l'Harmattan ; Du taylorisme scolaire à un système éducatif vivant, éd. Odilon. |
Extraits Dispenser de «l'instruction» à chaque enfant est obligatoire depuis Jules Ferry. Personne ne conteste cette formidable avancée sociétale. cette obligation d'instruction pour le citoyen parent et cette obligation de lui en fournir les moyens par l'Etat et les communes s'est métamorphosée en obligation scolaire... Et c'est du coup l'Etat qui se substitue au citoyen quant à la responsabilité et au devoir d'instruction. Tout se passe donc comme si, à partir de 5 ans, l'enfant était «enlevé» aux familles, sans qu'elles n'aient rien à dire, les fonctions habituelles de la parenté étant alors assurées par des fonctionnaires. Quand les échecs de l'école deviennent de plus en plus apparents et gênants, bizarrement les mêmes qui excluent totalement les parents de ce qui peut se passer à l'école les montrent alors du doigt en se gargarisant du mot «parentalité» qui serait mal assumé. L'incroyable déni de démocratie se trouve bien là : non seulement les parents citoyens sont obligés de «laisser» leurs enfants là où l'Etat le leur dit, mais en plus, ils n'ont rien à dire sur ce qui s'y passe, les fonctionnaires qui opèrent dans un lieu que l'on peut qualifier de «carcéral» disposant d'un pouvoir absolu qui n'est que vaguement contrôlé par sa propre hiérarchie. Chacun sait que la façon d'aborder les apprentissages, autrement dit la pédagogie ou les stratégies éducatives, n'est pas neutre. Les polémiques entre traditionnels et modernes, particulièrement ravivées par un ministre irresponsable, démontrent au moins qu'il y a aussi d'autres enjeux derrière de prétendues batailles d'experts. Le vrai problème soigneusement dissimulé n'est pas celui de la discrimination sociale par la carte scolaire, c'est l'obligation d'accepter les pédagogies décidées selon le seul bon vouloir des enseignants. Dans la ville de Gand, en Belgique, plus d'un tiers de la quarantaine d'écoles communales sont officiellement des écoles de type Freinet. La mixité sociale y est parfaite dans toutes ! Seul problème, les listes d'attente pour y inscrire les enfants sont très longues... Libe 12/09/06 |
Carte scolaire : la fin d'un tabouFrançois Dubet est directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Marie Duru-Bellat est chercheur à l'Institut de recherche sur l'éducation (Iredu/CNRS).
|
Extraits Pour une grande partie du territoire, cela ne se pose guère. En revanche, dans les grandes villes, la carte scolaire ne contribue certainement pas à l'égalité des chances devant l'école. Pour deux grandes raisons. La première vient du fait que les inégalités sociales entre les territoires se sont creusées et que la carte scolaire les reflète et les cristallise. La seconde tient au fait que tous ceux qui le peuvent, dans le privé ou dans le public, fuient les établissements jugés "difficiles". Il est vain de reprocher à ces parents "stratèges" leur égoïsme et leur absence de civisme dès lors qu'ils désirent légitimement que leurs enfants accèdent à la meilleure école possible et qu'il est vrai que la qualité des établissements pèse lourdement sur la réussite des élèves. La seule suppression de la carte scolaire serait probablement un remède pire que le mal. En effet, on imagine aisément que, comme sur n'importe quel marché, les acteurs ayant le plus de ressources et d'informations s'en tireront nettement mieux que les autres et que, une fois encore, les plus démunis auront moins de choix, moins d'opportunités et moins encore de chances de réussir dans l'école. D'ailleurs les pays qui ont choisi cette solution de "rupture" ont vu les inégalités s'accroître, et s'accroître aussi la délinquance, la marginalité, les fossés entre les groupes sociaux et les cultures. Les familles qui ont le choix accepteront les contraintes des secteurs scolaires quand elles n'auront plus le sentiment que certains établissements pénalisent la scolarité de leurs enfants parce que les équipes enseignantes y sont moins stables, souvent moins expérimentées, parce que les exigences scolaires y sont plus faibles, parce que les désordres scolaires y sont plus grands, parce que les options "prestigieuses" y sont absentes... Les familles reléguées dans les établissements les plus difficiles se sentiront moins captives, moins maltraitées par l'école quand celle-ci leur offrira la même qualité d'éducation qu'à tous. Ceci suppose que l'abandon des obligations de la carte scolaire soit compensé par un effort considérable en faveur des établissements aujourd'hui les plus défavorisés. Le Monde 08/09/06 |
|
Mme Royal et M. Sarkozy réclament un assouplissement ou une suppression de la sectorisation Haro sur la "carte scolaire", mais sans alternative
|
Extraits "L'idéal" serait de "supprimer la carte scolaire" ou à tout le moins de "desserrer ses contraintes" afin de "mettre en place une forme de choix entre deux ou trois établissements, à condition que les établissements les plus délaissés soient renforcés avec des activités scolaires de haut niveau", considère Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy plaide, quant à lui, pour "le libre choix des établissements par les parents". Pour le futur candidat à l'élection présidentielle, cette possibilité "crée de l'émulation entre les établissements". Instituée en 1963, lors de la création des collèges d'enseignement secondaire (CES), la sectorisation permet de répartir le nombre d'élèves dans les établissements en fonction de leur capacité d'accueil. Elle a aussi comme objectif de promouvoir la mixité sociale. De ce point de vue, l'objectif n'est pas atteint. Nombre de parents, souvent issus de classes aisées ou moyennes, déploient des stratégies d'"évitement". Selon une étude publiée en août 2001, trois ans après leur entrée dans le secondaire, 10 % des enfants fréquentaient un établissement public en dehors de leur secteur et 20 % étaient inscrits dans le privé. Les enseignants sont deux fois plus nombreux que la moyenne à inscrire leur enfant dans un établissement public hors de leur secteur géographique. En revanche, la scolarisation dans un collège privé est plus fréquente chez les enfants de chefs d'entreprise, d'agriculteurs et de cadres. Pour les différents syndicats de l'éducation nationale, la suppression de la sectorisation apparaît "irréaliste", voire "dangereuse". "Faire ce que préconise Nicolas Sarkozy revient à détruire l'éducation nationale et à mettre en place un système concurrentiel à l'instar de ce que font les Anglais", estime Philippe Guittet, président du SNPDEN. Bernard Kuntz, président du Snalc, un syndicat d'enseignant classé à droite, n'est pas plus favorable à une telle suppression. Offensive générale contre la carte scolaire Libé 06/09/06 Robien: "supprimer" la carte scolaire "déstabilisera" l'Education nationale AFP 06/09/06Voir aussi le point de vue de Georges Felouzis dans notre Tribune |
Gilles de Robien présente un plan de lutte contre les violences scolaires
|
Extraits M. de Robien est venu à Etampes expliquer aux enseignants et au chef d'établissement le contenu d'une circulaire parue au bulletin officiel jeudi et qui définit, selon lui, "une nouvelle pierre angulaire de notre action de lutte contre les violences scolaires". Sont visées le racket, le bizutage ou le "happy slapping" – le fait de filmer des agressions à l'aide d'un téléphone portable. Le drame d'Etampes et le tabassage filmé, en avril, d'une enseignante à Porcheville, dans les Yvelines, ont poussé l'éducation nationale à se saisir de ces pratiques longtemps taboues. La circulaire met l'accent sur la prévention et souligne qu'il est "indispensable que les recteurs mettent tout en œuvre pour que les personnels bénéficient de la protection juridique prévue". En outre, un "accompagnement est mis en place pour les victimes", et une "permanence téléphonique [SOS Violences] est obligatoirement mise en place dans les académies". le ministre a annoncé le lancement de deux guides destinés aux enseignants. L'un, intitulé Réagir face aux violences en milieu scolaire et diffusé à 150 000 exemplaires, indique aux personnels de l'éducation la conduite à tenir en cas de bizutage, de violences sexuelles, de violences entre élèves ou comment prendre en compte le "happy slapping" , qualifié de "phénomène de plus en plus répandu et banalisé par les élèves dans les établissements scolaires". L'autre guide,Mémento, dédié aux chefs d'établissement et rédigé conjointement par les ministères de l'intérieur, de la justice et de l'éducation, donne des repères précis pour réagir en cas de violences, notamment les articles de loi et la qualification pénale des actes concernés. Le Monde 05/09/06 Un plan contre les violences scolaires La Croix 05/09/06 Vers des permanences policières à l'école AP 05/09/06 |
|
Ecole : ce qu'il faut apprendre
|
Extraits Du grand débat national sur l’école à la loi Fillon d’avril 1995, des travaux du Haut Conseil de l’éducation (HCE) à la publication du décret le 11 juillet dernier, on mesure l’énergie dépensée pour parvenir à dresser l’inventaire, en une trentaine de pages, de « l’ensemble des connaissances et compétences » que l’éducation nationale s’engage à apporter à 100 % des élèves. Sur le fond, les professeurs se désespèrent de l’écart qui se creuse entre l’ambition des programmes et les possibilités effectives de les enseigner. La logique qui préside à leur élaboration consiste à partir des savoirs universitaires, pour tenter de les adapter aux collégiens. « Chaque discipline évolue dans son coin, sans se soucier de ce qui se passe chez la voisine (…) Les quelques tentatives d’harmonisation qui ont été tentées ont échoué », écrit E. Davidenkoff. Dépassés par l’ambition encyclopédique, les enseignants reconnaissent, au mieux, qu’ils n’ont « pas le temps de tout faire ». Et pendant ce temps, le système navigue à vue : « Curieusement, on ne dispose pas actuellement d’un véritable suivi scientifique sur la façon dont les programmes sont reçus et traités par les enseignants », avoue Dominique Raulin, ancien secrétaire général du Conseil national des programmes Dans un rapport cinglant publié en juillet 2005, l’Inspection générale considérait que ni les grilles d’évaluation de primaire, ni le brevet des collèges ne permettent de mesurer les acquis. Trente ans après la création du collège unique, le système n’a pas su redéfinir des nouveaux champs de connaissances. À travers la lecture du socle, il est clair que plusieurs orientations se dessinent. Tout d’abord, un recentrage sur les apprentissages de base en primaire. En définissant sept piliers de compétences, qui incluent des champs aussi larges que la « culture humaniste », le HCE a volontairement refusé de caler le socle sur l’actuel découpage disciplinaire. La Croix 01/09/06 Une rentrée scolaire pleine de nouveautés Le Figaro 04/09/06 Soutien, discipline, lecture : ça bouge à la rentrée Ouest-France 04/09/06 |
|
Gilles de Robien veut croire à une rentrée scolaire "tout à fait satisfaisante" |
Extraits "Il y aura forcément ici ou là des problèmes très localisés. Mais il y a 520 000 classes en France et les ajustements si nécessaire seront faits le plus rapidement possible", a-t-il assuré. our lui, "le temps des querelles est du temps perdu". "J'ai conscience des besoins des professeurs, de l'attention que je dois leur porter". Mais "je sais faire le distinguo entre la situation réelle et les postures". Il a insisté sur la réforme de l'apprentissage de la lecture, qui scellera le retour à la méthode syllabique, et sur l'entrée en vigueur du "socle commun de connaissances et de compétences", qualifié de "texte refondateur de l'école". Cette rentrée marquera le coup d'envoi de "l'apprentissage junior", un parcours de formation ouvert dès 14 ans qui s'adresse aux élèves en grande difficulté, et de la "note de vie scolaire" au brevet des collèges qui prend en compte entre autres l'assiduité et l'engagement dans la vie de l'établissement. Le Monde 01/09/06 Robien se décerne une mention très bien Libé 01/09/06Les nouveautés de l'année scolaire 2006-2007 Le Monde 01/09/06Les chiffres clés de la rentrée Nel Obs 01/09/06 Le retour de la note de conduite satisfait plutôt les professeurs Le Figaro 01/09/06Pour Robien, tout va bien... L'Humanité 04/09/06 Rentrée scolaire : la bataille sur les moyens Le Monde 05/09/06Le système éducatif français comparé à ses voisins Le Monde 05/09/06 |
Les 7 plaies de l'Education nationale
|
Extraits 1. Les profs sont mal préparés à la complexité de leur mission. Les critiques pleuvent sur les IUFM, ces instituts créés en 1989 pour former les professeurs du primaire et du secondaire, et promis à l'intégration aux universités d'ici à trois ans. Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, plaide pour une «formation en alternance articulée autour du stage, qui permette de répondre aux questions des futurs enseignants quand ils se les posent» et, surtout, pour une «spécialisation» des profs sur une tranche d'âge: «A l'école élémentaire, enseigner aux 2-6 ans ou aux 7-11 ans, ce n'est pas la même chose. Pas plus que faire cours, au collège, à des 11-15 ans ou à des 16-20 ans.» 2. On envoie les débutants au feu des collèges difficiles. «Un bizutage institutionnel pas très sain.» «Le choc est terrible pour eux, renchérit Bernard Toulemonde, inspecteur général de l'Education nationale. Et c'est un frein aux vocations. Sachant que les nouveaux certifiés ont 1 chance sur 2 d'atterrir dans les académies de Créteil ou de Versailles, qui concentrent les établissements difficiles, beaucoup de candidats préfèrent se présenter au concours de professeurs des écoles pour rester dans leur académie d'origine.» Moyennant quoi le turnover atteint des sommets dans les académies peu prisées, déstabilisant à chaque rentrée les équipes pédagogiques. 3. La gestion du personnel est antédiluvienne. Le diagnostic de Pierre-Yves Duwoye, le super-DRH des profs, est lapidaire: «Notre système est trop égalitaire et pas assez équitable.» «Il faut que l'on puisse mieux récompenser le mérite.» Mérite. Le mot effraie. «Il est juste d'aider dans leur carrière ceux qui se démènent plus que les autres, estime Bernard Toulemonde. Mais ce n'est qu'un début. On est obligé d'y aller mollo dans l'Education nationale!» «N'importe qui ne peut pas occuper n'importe quel poste, tranche Pierre Lussiana, DRH de l'académie de Toulouse. Voilà pourquoi nous élaborons une cartographie des postes “à profil”, qui requièrent des compétences particulières ou présentent des contraintes spéciales. Il n'est écrit nulle part que la notation et l'avancement doivent se faire à l'ancienneté, ni qu'il est interdit de licencier un prof pour insuffisance professionnelle!» 4. Les syndicats entravent toute réforme. «Un tiers des profs sont syndiqués, évalue Bertrand Geay, maître de conférences à l'université de Poitiers et spécialiste du sujet. Mais ils l'ont été bien plus dans le passé: c'était le cas de plus de 80% des instituteurs dans les années 1970.» «Mettre ces gens-là, divisés, prompts à la surenchère, autour d'une table est compliqué, explique Bertrand Geay. Le plus souvent, ils sont en position défensive. Contre Allègre, Fillon, les suppressions d'emplois, etc.» Hervé Hamon est encore moins tendre. «Le Snes a gagné parce qu'il s'est révélé la meilleure machine à dire non. Non à tout ce qui pourrait entamer le statut libéral de l'enseignant. Non à une transformation de l'évaluation des maîtres. Non à une quelconque autonomie des établissements. Et une machine à réclamer toujours plus de moyens.» 5. Le temps de travail est un sujet tabou. Astreints à quinze heures hebdomadaires de classe (les agrégés) ou à dix-huit heures (les certifiés) - leur fameuse «obligation de service» - les profs refusent de passer pour des tire-au-flanc. Le métier est dur, plaident-ils. Ils ne veulent pas entendre parler d'un temps de présence accru dans l'établissement. «Idéologiquement, la majorité d'entre eux sont contre - même si beaucoup font des heures supplémentaires», observe Bernard Toulemonde. 6. Entre les enseignants et les parents, la méfiance règne. «Historiquement, l'école publique a été conçue comme un creuset républicain, explique le sociologue Patrick Rayou. A charge pour elle de confisquer les enfants à leur famille pour en faire des citoyens, à l'abri des influences extérieures. Mais, quand l'école n'a plus été vue comme un outil de promotion sociale, les parents se sont mis à lui demander des comptes.» Ou les géniteurs sont trop présents, et les enseignants les jugent envahissants. Ou ils sont trop absents, et les voilà accusés de démission. 7. L'ancienneté pèse plus lourd que la compétence. «Aux derniers échelons, persifle Hervé Hamon, il faut avoir agressé sexuellement un collègue ou giflé la présidente des parents d'élèves pour ne pas avoir 40 sur 40 à la note administrative !» Quelques chefs d'établissement prennent pourtant des libertés avec le système. «Même s'ils n'en ont pas le droit, ils reçoivent individuellement chaque enseignant pour dresser avec lui un bilan de son activité, raconte Bernard Toulemonde. Les intéressés sont assez satisfaits de trouver quelqu'un avec qui parler de leur travail.» L'Express 31/08/06 |
|
Une étude dévoile l'ampleur de la violence à l'école |
Extraits L'Education nationale a recensé 82.007 faits graves en 2005-2006 dans 7.924 collèges et lycées. Les violences physiques avec armes (29,7%) sont les événements les plus nombreux, suivis des insultes et menaces graves (26%). Viennent ensuite bizutage, dommages aux biens, fausses alarmes, jets de projectiles, suicides et tentatives, trafics divers. Les violences sexuelles (1.050 événements recensés) sont relativement rares. Ces données proviennent d'une base de données officielle du ministère de l'Education, baptisée Signa, que le Point a obtenu de consulter après un an et demi de démarches et un recours à la commission d'accès aux documents administratifs (Cada). les violences ont donné suite à des procédures internes aux établissements dans 88% des cas et à des plaintes pénales dans 23% des cas. Eric Debardieux, estime que le phénomène est en expansion depuis une dizaine d'années en France, avec un durcissement du types de violences. "Nous sommes face à une délinquance identificatrice, territoriale selon l'origine, le quartier, très anti-institutionnelle et anti-scolaire. on s'attaque aux locaux, aux enseignants mais aussi aux pompiers, aux médecins, aux transports publics", dit-il. Reuters 31/08/06 (cité par Libé) Parution du premier classement de la violence scolaire en France AFP 31/08/06 (cité par La Croix) Violence à l'école: la FCPE dénonce la "vision caricaturale" que donne le classement publié dans "Le Point" AP 31/08/06 Le classement de la violence scolaire indigne le monde éducatif AFP 31/08/06 Violence à l'école: Gilles de Robien déplore la publication d'un classement AP 31/08/06 |
Pour ou contre l'école à 2 ans
|
Extraits Faut-il scolariser les enfants dès 2 ans ? A l'heure de la rentrée des classes, le sujet - controversé - refait surface à l'occasion de la parution d'un ouvrage collectif, codirigé par Claire Brisset, qui vient de quitter ses fonctions de défenseure des enfants, et Bernard Golse, pédopsychiatre, hostile à cette pratique. De leur point de vue, elle néglige le développement psychoaffectif des enfants, qui ont besoin, jusqu'à 3 ans, d'un environnement adapté à leurs besoins, en petits groupes et non pas dans des classes d'une vingtaine d'élèves mettre son enfant dès 2 ans à l'école apporte un avantage faible du point de vue des acquisitions scolaires par rapport à une scolarisation à 3 ans, sauf pour les enfants étrangers et issus de l'immigration ainsi que pour les enfants de cadres. Du point de vue du langage, les tout-petits n'auraient rien à gagner non plus à fréquenter très tôt l'école. "L'acquisition du langage dépend de la médiation bienveillante et exigeante dont va bénéficier l'enfant, explique Alain Bentolila, professeur de linguistique à l'université Paris-V-Sorbonne. A cet âge, il a besoin d'un rapport quasi individuel avec l'adulte et, de ce point de vue, l'école ne propose pas une solution honorable." Et pourtant, l'école accueille environ un quart des enfants de 2 ans à 3 ans. Seule une étude sur la qualité de l'attachement menée auprès de 173 enfants (Agnès Florin et Solène Macé) montre que les tout-petits se sentent autant sécurisés par l'adulte, qu'ils soient en crèche ou à l'école maternelle. Le Monde 30/08/06 |
Faire réussir les lycéens sans grande réformeJean-François Bourdon, proviseur du lycée Feyder d'Epinay, Richard Descoings, directeur de Sciences Po, Geneviève Gallot, directrice de l'Institut national du patrimoine, Catherine Kuhnmunch, proviseur de l'Ecole Estienne, Alain Neuman, président de l'université Paris-XIII, Daniel Peltier, proviseur du lycée Nobel de Clichy-sous-Bois, Marc Peyrade, directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, Jean-Robert Pitte, président de l'université Paris-IV, Jean-Charles Pomerol, président de l'université Paris-VI, Jacques Prost, directeur de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris, Jean-Louis Tetrel, proviseur du lycée Renoir de Bondy, Henri Theodet, proviseur du lycée Blanqui de Saint-Ouen.
|
Extraits Quatre lycées : Jean-Renoir à Bondy, Alfred-Nobel à Clichy-sous-Bois, Jacques-Feyder à Epinay-sur-Seine, Auguste- Blanqui à Saint-Ouen. Huit établissements d'enseignement supérieur. Dix-neuf entreprises. Un objectif : mobiliser des acteurs représentant toutes les forces de notre pays pour donner l'envie et les moyens de réussir aux lycéens de Seine-Saint-Denis, pour leur montrer que la société est prête à leur reconnaître toute la place à laquelle leur volonté et leurs mérites intellectuels leur donnent droit. Qu'y a-t-il d'expérimental dans ce projet ? Des professeurs volontaires, soudés en équipe. Des emplois du temps permettant aux élèves et professeurs de travailler ensemble pas seulement dans la salle de classe. Des liens forts entre filières générales, technologiques et professionnelles noués grâce à des enseignements et des projets communs, des passages facilités d'une filière à l'autre permettant des choix d'orientation positifs et non par défaut ou relégation. Un tutorat proposé à chaque élève et assuré par un adulte (étudiant, cadre d'entreprise, fonctionnaire, professeur). Un accompagnement scolaire obligatoire organisé le soir, le samedi, pendant les congés scolaires. Des bilans de compétence en début d'année scolaire et des évaluations qui permettent de valider les connaissances et d'identifier celles qui restent à acquérir. Que vont apporter les établissements d'enseignement supérieur ? En appui des professionnels de l'orientation au sein des lycées, ils vont proposer, dès le début de la classe de seconde, des informations précises, concrètes, actuelles sur les cursus post-bac et la réalité des ouvertures professionnelles auxquels ils conduisent. Que demandent les équipes enseignantes aux entreprises ? qu'elles mobilisent leurs cadres pour venir parler avec passion de leurs parcours ou se proposer comme tuteurs ; qu'elles participent à des forums de présentation des secteurs d'activité économique, des métiers, des opportunités d'emploi, des rémunérations ; qu'elles organisent des visites de sites, proposent des stages de longue durée et rémunérés.
L'expérimentation
n'apporte pas de révolution pédagogique. Mais elle vise la mutualisation
des progrès.
Le Monde
29/08/06 Lycées expérimentaux dans 93: les acteurs tablent sur "effet d'entraînement" AFP 28/08/06 |
|
On connaît les pistes pour une école de l'égalité des chances, de la réussite de la promotion sociale. Aux candidats à la présidentielle d'en débattre. Une rentrée idéale Mehdi Ouraoui et Pierre Singaravelou animateurs de la conférence Périclès, cercle de promotion de l'égalité dans l'enseignement.
|
Extraits Une rentrée idéale ne laisserait aucun enfant, aucun jeune sur le bord du chemin de l'école, a fortiori après les émeutes de banlieue et les contestations anti-CPE. Les 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme seraient accueillis dans des «écoles de la deuxième chance» ou en service civique pour recevoir une formation diplômante. Une rentrée idéale serait véritablement gratuite et égalitaire. Aucun enfant ne serait absent ni n'arriverait le ventre vide en classe. Chaque enfant aurait accès à un service public de soutien scolaire et à des activités périscolaires. La carte scolaire serait maintenue, mais comprendrait des objectifs précis de mixité sociale au sein des établissements. Chaque classe à faible réussite éducative, en ZEP ou hors ZEP, serait limitée à quinze élèves. Aucun enfant n'arriverait au collège sans maîtriser parfaitement la lecture, grâce à un nouveau plan national pour la lecture. Une rentrée idéale serait citoyenne, mixte et laïque. L'année scolaire débuterait par l'étude de la «Déclaration des droits de l'homme et du citoyen», affichée sur les murs de la classe. Dans les «ateliers du respect», un accompagnement pédagogique compléterait des sanctions sévères contre tous les comportements discriminatoires et les violences scolaires. La lutte contre les discriminations seraient au coeur de la vie scolaire. Libé 23/08/06 |
|
Les archives du dossier de presse "débat sur l'école" sont consultables (document word téléchargeable) |
ossier de presse créé et mis à jour par Jean-François Launay